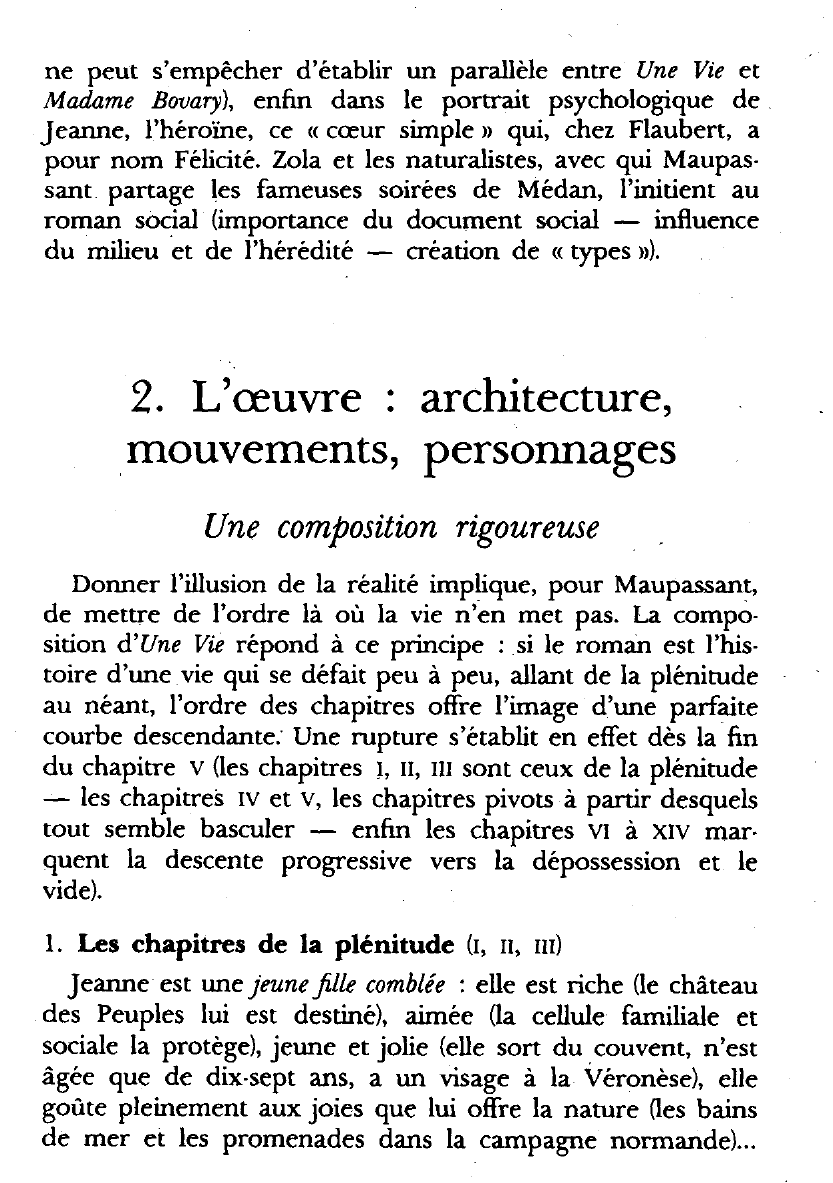Analyse d'Une Vie de Maupassant
Publié le 25/07/2010

Extrait du document

Intérêt de l'action Ce premier roman de Maupassant fut celui dont la maturation et la genèse furent les plus longues. Vraisemblablement entreprise au printemps 1878, la rédaction initiale prévoyait une intrigue plus complexe, des personnages plus nombreux. Mais il se rendit très vite compte de la difficulté à « mettre en place quelque chose « et à ménager « les transitions «. Peut-être était-il aussi gêné par le sujet qui touchait à de douloureux souvenirs d'enfance, le destin de Jeanne de Lamare étant similaire à celui de sa propre mère. Il ne pouvait du premier coup prendre le recul sans quoi il n'est pas de bonne création romanesque. Aussi, après une phase d'abandon du projet (fin 1878-début 1881), concentra-t-il plus rigoureusement l'action autour du seul personnage de Jeanne, évinçant tout ce qui pouvait nuire à l'unité de son roman. À partir du printemps de 1881, la rédaction se fit en parallèle avec celles de nouvelles qu'il essaimait dans les journaux et dont les sujets, voire la forme même, apparaissent comme des « brouillons « de chapitres d'''Une vie'' : ‘'Par un soir de printemps'' (7 mai 1881 dans ‘'Le Gaulois'', repris dans ‘'Le père Milon'', 1899) évoque la promenade de Jeanne et de Julien au chapitre 4 ; ‘'Histoire corse'', (1er décembre 1881 dans ‘'Le Gaulois'') contracte le récit de Paoli Palabretti au chapitre 5 ; ‘'Le saut du berger'' (9 mars 1882 dans ‘'Gil Blas'', repris dans ‘'Le père Milon'') présente « un jeune prêtre austère et violent «, véritable préfiguration de l'abbé Tolbiac, qui accomplit à la fois le meurtre des amants confié au comte de Fourville et le massacre de la chienne en gésine par l'ecclésiastique dans le roman (chapitre 10) ; ‘'Vieux objets'' (29 mars 1882 dans ‘'Gil Blas'') apparaît comme une esquisse de la rêverie de Jeanne au chapitre 12, de même que ‘'La veillée'' (7 juin 1882 dans ‘'Gil Blas'', repris dans ‘'Le père Milon'') annonce celle du chapitre 10. Des nouvelles au roman (ou vice versa) l'échange fut constant, traduction à la fois de l'unité d'inspiration de l'écrivain et de sa volonté de parvenir à une parfaite adéquation de la forme et du fond. Un tel « chantier « n'est d'ailleurs pas le seul chez Maupassant : on en retrouve un dans le cas du ‘'Horla''. D'autre part, il supprima des épisodes dont certains trahissaient la présence trop marquée de Flaubert, le maître, qui lui avait prodigué ses conseils, avait encouragé son projet d'un «livre sur rien«, d'« une tranche de vie «, d'une œuvre en grisaille où le ressassement du temps et le vide de la conscience chez le personnage principal mettent en cause la notion même d'intrigue et celle d'héroïne romanesque. Le titre indique que le livre est une biographie et marque bien le passage de Maupassant de la nouvelle (sorte d'instantané de la vie) au roman (qui s'inscrit dans la durée, couvre une trentaine d'années). Mais, cette vie n'étant même pas qualifiée, il annonce une platitude extrême, une banalité que renforce l'épigraphe «L'humble vérité«, qui est tout à fait dans l'esprit des romanciers réalistes. Le personnage n'est pas nommé alors qu'à la même époque on trouve des titres tels que “Madame Bovary”, “Germinie Lacerteux”, “Thérèse Raquin”, etc.. Mais ces femmes sont des héroïnes au sens dynamique du terme, qui agissent, qui mènent combat, alors que Jeanne est une anti-héroïne. En fait, le mot « vie « est à prendre comme une antiphrase, car la vie de Jeanne de Lamare n'est pas une vie. Sa destinée suit une courbe en creux que marque bien l'ordre des chapitres. Fondé sur une inaptitude de l'être à sentir le présent, ‘'Une vie'' est le roman du non-vécu et (qui sait?) peut-être de l'impossibilité de vivre. En effet, dans ce roman en quatorze chapitres numérotés mais non titrés, l'intrigue s'efface au profit d'une série d'expériences : de l'amour, du mariage, de l'adultère, de la maternité. La trame narrative linéaire est, selon la technique romanesque de Flaubert, une succession de tableaux qui joue sur les effets de contraste. Elle s'ouvre sur les douceurs de la vie de château, des promenades en mer, les éblouissements illusoires des fiançailles, la promesse d'un avenir radieux, les chapitres I, II et III étant ceux de la plénitude, les chapitres IV et V étant les pivots à partir desquels tout semble basculer. Dès le lendemain de son mariage dont elle supposait qu'il marquerait une nouveauté absolue, Jeanne est désabusée : «Et la journée s'écoula ainsi qu'à l'ordinaire comme si rien de nouveau n'était survenu. Il n'y avait qu'un homme de plus dans la maison.« Une rupture s'établit à la fin du chapitre V et, peu après son voyage de noces, elle se répète : «Et la journée s'écoula comme celle de la veille, froide, au lieu d'être humide. Et les autres jours de la semaine ressemblèrent à ces deux-là ; et toutes les semaines du mois ressemblèrent à la première.« Puis son existence ne cesse plus de déraper le long d'une pente où s'accumulent les déceptions, les épreuves, les désillusions, les humiliations, les malheurs, les drames, les catastrophes : trois adultères, un bâtard et un mort-né, un fils et une petite-fille, un double assassinat, c'est loin d'être négligeable. Cependant, malgré l'accumulation de ces drames, la seconde partie du roman laisse une impression totale de monotonie : d'abord parce que les événements ne cessent de se répéter, ensuite parce que chaque événement, bien marqué temporellement dans le texte, («un soir«, «un matin«...) est immédiatement noyé dans la monotonie de l'habitude et de la durée («deux années passèrent« - «alors commença une série d'années monotones et douces«). Cette monotonie apparaît aussi dans le rythme du récit : alors que les cinq premiers chapitres couvrent environ six mois, les chapitres XI à XIV environ vingt-cinq. Cette accélération progressive du rythme romanesque est un signe supplémentaire que «rien n'arrive plus« dans la vie de Jeanne. Tout ce qu'elle avait rêvé dans son enfance et son adolescence ne s'accomplit malheureusement pas à l'âge adulte. “Une vie” montre un impossible bonheur, une existence gâchée. Elle ne connaît qu'une lente et corrosive dégradation. La fin d'un malheur introduit le suivant. Cependant, en dépit des rebondissements de l'intrigue, le lecteur (exactement comme l'héroïne d'ailleurs) a toujours l'impression qu'il ne se passe rien dans cette vie qui, bien qu'agitée et même mouvementée, s'enlise inexorablement dans la monotonie du quotidien et la banalité des habitudes. Car tout ce qui a lieu s'étire dans le temps et se distend, s'effiloche et s'émousse, les faits ne parvenant jamais à contrarier durablement l'engourdissement de la répétition des mêmes situations : deux retours aux Peuples, deux promenades en bateau, deux accouchements, trois voyages en calèche, trois noces, quatre rêveries à la fenêtre, quatre promenades dans «le petit bois«, la préfiguration du mariage de Jeanne par le baptême de la barque. Rien n'est jamais unique et singulier dans cette vie dont tout événement en décalque fatalement un autre. Mais quoi qu'il arrive, rien ne change vraiment. Car tel est bien le défi littéraire Iancé par ce roman de Maupassant qui déréalise tout à force de sembler réaliste, telle est bien son originalité extrêmement paradoxale dans sa dimension proprement négative : ne raconter les événements que pour les amortir et les résorber, ne narrer chaque circonstance que comme symptôme d'une perte, réduire la succession des faits à une vertigineuse viduité. Quelle que soit l'intensité affective des événements qui ont «meublé« l'existence de Jeanne jusqu'à la rendre déserte, sa vie engourdie, affaissée, implacablement de plus en plus apathique et léthargique, n'en demeure pas moins profondément désaffectée : une vie en lambeaux, une destinée incomplète et lacunaire, une somme de vides, et en perspective toute une vie, ses nostalgies, ses renoncements, ce «bonheur dans la soustraction« à quoi se réduit, précisément, «une vie«. Cependant, au terme de cette vie où, selon toute vraisemblance, Jeanne ne doit plus connaître que la solitude, le dénuement et la mort, au moment où l'on s'y attend le moins, la courbe se relève pour la laisser survivre dans une vieillesse qui apparemment s'annonce sereine. Elle trouve du réconfort auprès de Rosalie, et, aux toutes dernières pages, auprès de la petite fille dont l'arrivée dans les bras de la servante annonce, avec le retour du fils prodigue, la reconquête d'une sorte de bonheur. Les dernières lignes : «La vie, voyez-vous, ça n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on croit«, manifestent, dans une discrétion de bon aloi, l'art parfait de finir sur un attentisme inquiet et un fatalisme qui n'exclut pas une lueur d'espoir, le feuilletonniste mondain qu'était Maupassant sachant terminer par quelques mots qui laissent le dénouement ouvert. «Le romancier n'a pas à conclure«, écrivit-il quelque part. C'est un roman de la dépossession, de la désappropriation. Mais ce n'est pas une tragédie, même si l'action de la fatalité est invoquée par Jeanne : «Je n'ai pas eu de chance. Tout a mal tourné pour moi« - «La fatalité s'est acharnée sur ma vie« - «Elle se demandait naïvement pourquoi la destinée la frappait ainsi« - «C'est moi qui n'ai pas eu de chance dans la vie«. Et, si elle subit les méchancetés du destin, elle bénéficie aussi de leur envers, des compensations qui rééquilibrent la logique du mal. À son «Ça n'est pas toujours gai, la vie« répond, à la fin, le «La vie, voyez-vous, ça n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on croit.« de Rosalie. Ainsi, à cet égard, “Une vie” refuse le modèle naturaliste donné par Zola qui, lui, n'a jamais fait un tel cadeau à aucun de ses personnages. Mais Maupassant respecte l'esthétique naturaliste en se donnant pour objectif de décrire la vie telle qu'elle est (celle de tout le monde), de dire «l'humble vérité«. Le corps, dans sa dimension physiologique, élément typiquement naturaliste, est très présent. On découvre lors d'un accouchement une «larve« qui pousse des «vagissements«, un «avorton fripé« ; à la suite de la chute brutale de la cabane de berger dans un ravin, on nous montre les corps disloqués ; et le récit s'attarde sur la façon dont est transportée la dépouille de la baronne. Le roman est chronologiquement linéaire, mais c'est pour mieux raconter l'histoire d'une décadence. Les événements se font de plus en plus rares dans la vie de Jeanne, l'intrigue s'amenuise. Le temps se dilue : les repères temporels du personnage s'effacent. Sa vie semble se figer, s'immobiliser. L'esthétique réaliste veut que l'auteur s'en tienne strictement à l'impersonnalité, ne prenne jamais la parole, s'efface totalement derrière le personnage focalisateur, décrive l'univers (décor et personnages) en adoptant exclusivement le point de vue de celui-ci (sauf quand on suit le comte de Fourville alors qu'il a échappé au regard de Jeanne). Tout est vécu à travers la perception particulière des événements et la sensibilité de Jeanne. Pourtant, la présence de Maupassant se dissimule derrière des aphorismes moraux et des définitions rapides. Intérêt littéraire Au moment d'écrire ce premier roman, Maupassant possédait déjà toute la maîtrise d'un style dont la justesse, le poids et la vigueur sont exceptionnels. Pourtant son écriture s'est faite le plus neutre possible afin de traduire fidèlement la platitude et l'immobilisme d'une existence végétative dont elle mima, en quelque sorte, la terne vacuité : « Alors elle ne sortit plus, elle ne remua plus. Elle se levait chaque matin à la même heure, regardait le temps par sa fenêtre, puis descendait s'asseoir devant le feu dans la salle. « Le texte s'organise sur des répétitions de mots ou thèmes : «pluie«, «larmes«, «engourdissement«, «vide«, «souvenir«, «rêve«, la néantisation de cette vie étant rendue par la récurrence de l'image du «trou« (ce n'est donc peut-être pas par hasard que le nom de l'héroïne est « Le Perthuis «). Elle apparaîtt dans maints passages : «soudain, par un trou qu'on ne voyait point, un long rayon de soleil oblique descendit« - «profitant du trou fait dans la verdure, une averse de lumière tombait là«. L'image revient quand Jeanne n'a d'autre ressource que le souvenir : «une vision la traversa, une vision rapide de ce trou ensoleillé au milieu des sombres feuillages«. S'ouvre aussi le trou financier que sont les dommages causés au budget par la générosité de ses parents : leur «revenu aurait suffi s'il n'y avait eu dans la maison un trou sans fond toujours ouvert, la bonté«. Au sein de cet interminable évidement qu'effectue obstinément le roman, le mariage de Jeanne qui éprouve «seulement une grande sensation de vide en tout son corps« le jour de la cérémonie, devient lui-même un trou : «Pourquoi tomber si vite dans le mariage comme dans un trou ouvert sous vos pas?« - «elle était tombée dans ce mariage, dans ce trou sans bords«. Le trou, c'est aussi le temps dans lequel s'abîme sa vie : «Décembre s'écoulait lentement, ce mois noir, trou sombre au fond de l'année«. C'est encore la faillite de sa mémoire : «Elle raisonnait péniblement, cherchant des choses qui lui échappaient, comme si elle avait eu des trous dans sa mémoire, de grandes places blanches et vides où les événements ne s'étaient point marqués«. Déjà son accouchement avait été une façon de faire le vide dans son propre corps : «Il lui semblait soudain que tout son ventre se vidait brusquement.« Comment ne pas reconnaître dans cette obsessionnelle insistance du trou sous toutes ses formes la figure exemplaire de ce que (n') a (pas) été la vie de Jeanne? Autres exemples de la redondance généralisée : de nombreuses phrases ressassent une même idée, reprennent inlassablement un même substantif ou un même adjectif, remâchent une même sensation en multipliant les reprise synonymiques. Des motifs récurrents permettent de mesurrer l'écoulement du temps : la tapisserie, l'abeille, le calendrier, les sillons, le banc, etc.. Les mêmes gestes se répètent. Le roman aligne les scènes à la fenêtre : «Jeanne [...] s'approcha de la fenêtre« - «Elle se leva [...] ouvrit la fenêtre et regarda« - «Alors Lison à son tour se leva [...] vint s'accouder à la fenêtre et contempla la nuit« - «Les jeunes gens accoudés à la fenêtre ouverte regardaient le jardin« - «Elle se leva et vint coller son front aux vitres« - «S'enveloppant d'un grand peignoir, elle courut à sa fenêtre et l'ouvrit« - «Elle [...] s'asseyait près de la fenêtre, levait les yeux et contemplait au loin la mer« - «Elle resta des journées entières assise contre la fenêtre« - «Jeanne ferma la porte, puis alla ouvrir toutes grandes les deux fenêtres« - «Elle se leva et courut à la fenêtre pour se rafraîchir« - «Elle retourna s'asseoir auprès de la fenêtre ouverte« - «Et le souvenir saisit Jeanne de cette nuit passée à la fenêtre lors de son arrivée« - «Elle se mit à la fenêtre et regarda la rue« - «Elle se levait chaque matin à la même heure, regardait le temps par sa fenêtre« - «Ayant ouvert une fenêtre, elle demeura remuée jusqu'au fond de sa chair«. Dans ce style intensément psalmodique, la phrase est marquée du «et« de Flaubert qui prolonge plus qu'il ne coordonne : «Et leur vie restait lamentable« - «Et rien de nouveau n'arriva plus jusqu'aux derniers jours de juillet«. Par contre, pour évoquer la nature, qu'il personnifia, qu'il sensualisa, Maupassant déploya tout un vocabulaire de la vie, de la fécondité, du «fourmillement«. Les odeurs se firent «haleines«, les vents, «souffles« ou «caresses«, les mouvements, «frémissements« et «frissons«. Les descriptions de paysages ont quelque chose de la peinture impressionniste : Maupassant y est sensible aux jeux de lumière, aux éléments mobiles, l'air et l'eau, de même qu'aux subtiles variations de l'heure et de la saison. Il rend les couleurs pâles et voilées, les contours flous et imprécis, gommés par la pluie ou la brume, du paysage normand. Intérêt documentaire La propriété des Peuples reproduisait le château de Grainville-Ymauville. “Une vie” est d'abord une peinture précise de la Normandie dont Maupassant reconstitua une géographie réelle : monotonie de ses plaines et présence de la mer. Les tableaux de la campagne, qu'on sent et touche, sont remarquables : il y pleut, il y neige, il y fait froid. Maupassant, dont les descriptions transforment systématiquement ce qu'elles représentent en une grisaille, fait surgir des visions de chemins détrempés, gorgés d'eau et de boue, d'hiver dégoulinant, d'espaces de neige, de temps de brouillard, de moments de brume, de rideaux d'averses, de ciel «crevé, se vidant sur la terre, la délayant en bouillie, la fondant comme du sucre«. Pourtant, il y a de belles éclaircies sur la mer, lorsque «lisse comme une glace«, elle miroite «dans la lumière«. Mais cette nature ne joue pas seulement le rôle d'un cadre : elle reçoit, de la part de l'auteur, une charge d'énergie, une dynamique qui en font la compagne de Jeanne : son existence est déterminée par les couleurs et les atmosphères de sa terre ; au vide et à la passivité du personnage, elle répond par sa plénitude et sa vitalité. Chaque printemps provoque en elle un réveil. Elle y connaît la grande révélation érotique. Jeanne échappe moins que d'autres héroïnes des romans du XIXe siècle à cette sorte d'absorption de l'être par son milieu naturel qui est le miroir fidèle de ses émotions : elle est lumineuse et gaie dans les cinq premiers chapitres ; elle est engluée dans le brouillard ou la boue dans les moments de tristesse et d'ennui. Jeanne n'échappe pas davantage aux contraintes qui règlent les manières de vivre, les moeurs, de son milieu social qui porte des responsabilités dans la catastrophe de sa vie. Maupassant suit en cela les préceptes du naturalisme. Il a situé le début de ce roman de la vie en province, plus spécialement à la campagne, en 1819. L'action se passe donc sous la Restauration et la Monarchie de Juillet. Ce recul dans le temps lui permet, à travers quatre familles, de dresser un tableau absolument sans indulgence de la petite noblesse provinciale en pleine décadence, de ces hobereaux normands qui vivent selon des normes qui n'ont plus cours, dont les occupations sont gratuites et insignifiantes (problèmes d'armoiries, de généalogies, de mariages). Mais le petit peuple est constamment présent aussi : domestiques, paysans mal éduqués et grossiers (l'inévitable repas de noces avec convives gloutons), pauvres pêcheurs d'Yport, foules saines et joyeuses, liberté sexuelle («À tout moment on apprenait une grossesse nouvelle, ou bien quelque fredaine d'une fille, d'une paysanne mariée et mère de famille ou de quelque riche fermier respecté«). C'est une société cloisonnée et égoïste, qui ne réagit ni à la révolution de 1830, ni à celle de 1848. L'hypocrisie des moeurs est générale (adultère, prostitution). Les valeurs chrétiennes sont en totale déroute ; la pratique religieuse est une simple façade. La religion fanatique du curé Tolbiac est celle de la haine et de la vengeance. Quel salut Jeanne peut-elle attendre de lui? L'abbé Picot, qui fut inspiré à Maupassant par l'abbé Aubourg de sa jeunesse, est le raccommodeur de porcelaine conjugale ; mais «avec sa nature grivoise de prêtre campagnard prêt à fouiller dans ces mystères du lit qui lui rendaient plaisant le confessionnal«, il n'est pas moins dangereux. Cette vie de province a sans doute évidé un peu plus la vie de la jeune fille, mais le sort de Jeanne eût-il été meilleur à Paris? Humiliée par son mari, par ses parents, par son fils, par sa servante, par les prêtres, elle est la victime d'un code familial et social dont les règles ne laissent aucune place à la liberté individuelle, surtout pas à la liberté d'une femme. Tout est programmé par un jeu de conventions et de droits qui perpétuent la prééminence du titre, du rang, de la propriété, de l'argent et de la domination masculine. Pendant cinq années, elle a subi la réclusion conventuelle, qui interdit aux jeunes filles de faire l'expérience de la vie : elle a été «sévèrement enfermée, cloîtrée, ignorée et ignorante des choses humaines«. Ce roman de la condition féminine est un réquisitoire contre le mariage arrangé pour les besoins de la respectabilité, contre l'aliénation de la femme qui n'est jamais maîtresse de son destin. Rosalie, plus brutalement asservie au droit de cuissage d'un mâle titré et nanti, se tire mieux d'affaire finalement : elle doit sa chance relative aux libéralités du père de Jeanne, mais aussi et surtout à une extraction populaire qui la préserve des ligotages de caste. Le roman, remarquable par la richesse de l'observation ethnographique et sociologique, est donc aussi un reportage très dur sur la vie en Normandie, sur le statut de la femme en province, sur la condition féminine au XIXe siècle, sur la société française dans la première moitié du XIXe siècle. Intérêt psychologique Le roman est conduit avec la rigueur d'une véritable étude psychologique, mais sans explications, avec cette force et cette impassibilité que prônait Flaubert. Par contre, le rôle donné à l'hérédité, Maupassant le tenait du naturalisme de Zola. Il faut donc d'abord considérer l'influence qu'ont eue sur Jeanne ses géniteurs. La baronne Adélaïde se complaît dans des mièvreries et refuse donc d'être explicite dans le domaine de l'éducation sexuelle. Elle a bien eu des relations secrètes avec Paul d'Ennemare, mais la passion de la lignée est le seul sujet qui puisse lui faire momentanément oublier son hypertrophie : elle fait «des tours de force de mémoire, rétablissant les ascendances et les descendances d'autres familles, circulant sans jamais se perdre dans le labyrinthe compliqué des généalogies«. Aussi trouve-t-elle Julien de Lamare «très comme il faut«. Par son immobilisme final, elle annonce le comportement de Jeanne. Le baron a adopté un rousseauisme qui a pu favoriser les malheurs de sa fille. Il croit au progrès ; il veut «laisser faire la vie« ; dans un XIXe siècle dépourvu de tendresse, il voit dans le monde entier une force bonne et généreuse «produisant sans but, sans raison et sans fin dans tous les sens et dans toutes les formes à travers l'espace infini, suivant les nécessités du hasard et le voisinage des soleils chauffant le monde«. Sa générosité le conduit à mourir ruiné. Force est de constater pourtant qu'il a, en toute bonne foi, aidé le loup à entrer dans la bergerie car, avant le mariage, il dit de Julien : «il sera pour nous comme un fils«. Il se permet évidemment des amours ancillaires : «Qui sait même si vous n'avez jamais tâté d'une petite bobonne comme celle-là. Je vous dis que tout le monde en fait autant«, lui déclare l'abbé Picot qui ne s'en formalise pas ! Paul, dont le portrait rappelle étrangement celui de son père, a été conditionné par lui, et les déceptions multiples qu'il cause à sa mère ne sont que la répétition de celles qu'elle a connues avec Julien. Rosalie n'est pas seulement la servante au grand coeur : elle est la figure inversée de Jeanne, car, si elle est aussi victime de Julien, elle parvient néanmoins à donner à sa vie une trajectoire ascendante, et c'est elle qui, avec son bon sens paysan, souffle à sa maîtresse ses derniers sursauts d'énergie, prononçant d'ailleurs les derniers mots du livre. Julien, si, au moment des fiançailles, «se disait déjà dégoûté du monde, las de sa vie futile ; c'était toujours la même chose ; on n'y rencontrait rien de vrai, rien de sincère«, est en fait, comme le Rodolphe Boulanger de “Madame Bovary”, un hobereau brutal, cupide et coureur, un séducteur solide et efficace qui, après avoir fait la noce toute une nuit, ne déçoit au lit ni sa femme ni ses maîtresses. Et c'est d'être, à cet égard précisément, délaissée par Julien que Jeanne, jeume mariée livrée au Minotaure, souffre d'abord le plus après avoir connu l'éblouissement érotique au cours du voyage en Corse. Maupassant, en voyeur impénitent, n'évite pas la précision du tableau : «Il s'abattit sur elle, l'étreignant avec emportement. Elle haletait dans une attente énervée ; et tout à coup elle poussa un cri, frappée, comme de la foudre, par la sensation qu'elle appelait.« Cependant, le romancier le fait mourir victime de sa gourmandise du corps des autres femmes : l'adultère tue, la morale est sauve. Ce serait donc le curé Tolbiac, avec son sectarisme dément, qui aurait raison, lorsqu'il tonne contre «les liaisons indignes« et appelle à «porter le fer rouge dans les plaies«. Et l'on constate l'ambiguïté de Maupassant, qui, d'un côté, évoque avec complaisance et complicité les pulsions et les puissances du sexe, montre qu'il s'y connaît en amours adultères, mais qui, de l'autre côté, n'échappe pas aux interrogations victoriennes de son temps sur les taraudages du désir, est peut-être aussi mal à l'aise que les autres pour les vivre et les conter, fait de Julien une sorte de victime expiatoire pour toutes les fredaines de son propre monde, condamne la femme et le mari adultères à une mort aussi atroce que ridicule, dans des conditions narratives telles qu'à aucun moment le lecteur n'est conduit à plaindre les deux victimes. Au contraire, il se dit : bien fait pour cette brute de Julien ! et revient bien vite aux malheurs de Jeanne. Jeanne, jolie avec son visage à la Véronèse, riche, en bonne santé, bien élevée, peut sembler bien placée dans la chasse au bonheur. L'auteur a choisi de la présenter encore naïve et pressée de connaître toutes les joies de l'existence qu'elle a imaginées dans le couvent où se déroula une partie de son enfance et dont elle sort ; aussi en dépit de la tristesse du paysage normand soumis à la pluie, a-t-elle un avant-goût de la liberté et des plaisirs qu'elle se promet, le mouvement lui étant rendu, sa jeunesse faisant d'elle une «plante« jusqu'alors maintenue loin de l'air, et que l'eau tiède régénère, fait «revivre«. Ce bonheur, elle attend que le lui apporte celui qu'elle aimera. Elle est sensible à la beauté (à Étretat, en Corse) : «Trois seules choses étaient vraiment belles dans la création : la lumière, l'espace et l'eau«. Elle goûte les bains de mer et les promenades dans la campagne normande. Au départ, elle est, comme Emma Bovary avec laquelle la comparaison s'impose, victime de l'aliénation qui est produite par une éducation qui, aux filles, donnait de la vie une vision romanesque, naïve et stéréotypée. Elles ne réussissent pas à faire coïncider avec leurs rêves une réalité plate et monotone : telle est la raison de l'échec de ces deux vies. Ces rêves, Maupassant les traque avec ardeur. L'éducation de Jeanne se réduit à une «ignorance totale« et «une sorte de bain de poésie raisonnable« d'inspiration rousseauiste. En conséquence, elle appréhende le réel sur le mode de la rêverie et à travers un ensemble de clichés et d'idées reçues. À son arrivée aux Peuples, elle rêve de l'homme de sa vie. Il serait «Lui«. L'amour les unirait «dans un élan de son âme affolée, dans un transport de foi à l'impossible, aux hasards providentiels, aux pressentiments divins, aux romanesques combinaisons du sort«. Et, en effet, ils auront ce regard «où deux âmes croient se mêler«. Et voilà que celui qu'elle doit aimer et qui l'aimera se fait connaître. En fait, c'est l'homme que lui ont choisi son père et son curé, et elle n'en a approché aucun autre. Mais il fait aisément figure de prince charmant. Le viol légal est dérisoirement transformé en séduction. Elle l'épouse, non pas parce qu'elle est amoureuse de lui, mais parce qu'il arrive juste à propos pour combler ses rêveries. Mais, déterminée, conditionnée par la littérature, elle ne sera pas capable de s'adapter au réel qui l'attend à l'âge adulte. La littérature romantique aigrit ses lectrices quand elles ont à faire face à la nullité de leur vie quotidienne. L'échec est déjà inscrit dans le passage instantané du rêve à sa réalisation, et Jeanne en prend conscience, connaît sa première désillusion, le jour même de son mariage : «Pourquoi tomber si vite dans le mariage comme dans un trou ouvert sous vos pas?« Puis, aux questions angoissées qu'elle se pose sur son destin si vite scellé, répond l'horreur de la nuit de noces qui est vécue comme un viol. Pourtant, au cours du voyage de noces en Corse, à l'occasion d'une promenade, ses sens ont été «éveillés« et elle découvrit le plaisir sexuel. Mais, après ces quelques brefs moments de volupté, elle déchanta rapidement. Vite mutilée, anéantie par la goujaterie de son mari, elle ne peut plus connaître le plaisir dans le cadre conjugal, ne souffre pas beaucoup de n'être plus désirée, de n'être plus comblée, et l'évocation des premiers rêves amoureux ne servira plus que de contrepont à l'ennui de la vie conjugale. “Une vie” fonctionnerait comme un anti-manuel d'éducation à l'usage des jeunes filles auxquelles on ne disait rien sur les mystères d'une sexualité féminine sur laquelle Maupassant projetait un éclairage particulier, très nouveau pour un lecteur du XIXe siècle. Cependant, il laissait dans l'implicite la réflexion sur la castration des filles et des femmes dans cette société provinciale de hobereaux, d'ecclésiastiques et de paysans lourdauds. Ailleurs, dans un autre monde, selon un autre code, ou du moins selon les usages tacites d'un autre code, Jeanne aurait fini par rendre à Julien la monnaie de sa pièce. Ici, son abandon et sa frustration sont sans rémission. Cet échec sexuel est d'autant plus frappant que le roman tout entier baigne dans un climat de sensualité et de fécondation. Cette duperie initiale engage toutes les avanies ultérieures de cette vie saccagée. Après le voyage en Corse, elle «s'aperçut qu'elle n'avait plus rien à faire, plus jamais rien à faire... voilà que la douce réalité des premiers jours allait devenir la réalité quotidienne qui fermait la porte aux espoirs indéfinis, aux charmantes inquiétudes de l'inconnu. Oui, c'était fini d'attendre. Alors plus rien à faire, aujourd'hui, ni demain, ni jamais.« C'est la fin de l'attente, la fin du rêve, la fin de l'espoir, la fin de l'avenir, et c'est ce décalage ontologique qui fait qu'une vie devient une mort à petit feu. Une vie de femme, dans ce monde de préjugés et de pouvoirs archaïques, est en fait une mort à petit feu, par étouffement, par asphyxie progressive de la sensibilité, de la confiance, par mutilations successives de l'envie de créer, du désir de donner et de recevoir le plaisir, d'être heureux. Elle cherche d'abord à comprendre, à analyser son martyre : déjà, dans les heures qui suivirent son mariage, elle «songea ; elle se dit, désespérée, jusqu'au fond de son âme, dans la désillusion d'une ivresse rêvée si différente : voilà donc ce qu'il appelle être sa femme; c'est cela ! c'est cela !« Jeanne fait alors, rapidement, ses premiers apprentissages en forme de désillusions, de dépossessions et de trahisons. Elle est successivement trahie par sa bonne, par son mari à deux reprises au moins, par Gilberte qu'elle considérait comme une amie, par sa mère, par son père, par son fils. Elle perd enfin tous ses biens. Aussi, dans un débordement de sentimentalité, la voit-on «frémir«, «frissonner«, «se griser« au contact de la nature, aller de syncopes en évanouissements prolongés, de crises de nerfs en sanglots convulsifs. Hystériquement maternelle, elle est révulsée par la découverte de l'impureté de sa mère. Elle passe par des alternances : « Dans certains jours, […] un tel bien-être de vie la pénétrait qu'elle se reprenait à révasser, à espérer, à attendre […] Puis la dure sensation du réel tombait sur elle ; elle se retrouvait courbaturée comme sous la chute d'un poids qui lui aurait cassé les reins ; et elle reprenait plus lentement le chemin de sa demeure en murmurant : « Oh ! vieille folle ! vieille folle ! « (chapitre 14). Elle est donc plus neurasthénique qu'Emma, et moins exaltée. En fait, elle est plus léthargique que romantique. Car elle montre longtemps une incapacité totale à l'action, à la réaction : elle n'est pas d'accord avec les agissememnts de Julien, mais elle ne dit rien (chapitre V) ; elle surprend Rosalie dans le lit de son mari, mais elle s'enfuit « l'esprit perdu « (chapitre VII) ; elle découvre la liaison de Julien et de la comtesse de Fourville, mais « des larmes lui viennent aux yeux «. Nulle révolte chez elle, mais une résignation « pareille au revêtement de calcaire que certaines eaux déposent sur les objets « (chapitre VI) et qui va bien vite la réduire à une passivité totale, faisant d'elle un être végétatif : « Alors elle ne sortit plus, ne remua plus « (chapitre XIV). Une telle attitude n'est en fait que la traduction du refus du présent qui est d'abord ignoré au profit des rêves d'avenir : son mariage ne devait être, pour elle, qu'une « entrée dans l'Attendu « (chapitre IV) ; elle ne peut, une fois ses espoirs déçus, que se rappeler le passé, qu'il s'agisse des rares instants de bonheur comme celui du val d'Ota (chapitre V), contrepoint des nombreux moments douloureux ou déceptifs, ou de véritables strates temporelles, tels ces souvenirs qui affleurent lors des préparatifs du déménagement (chapitre XII), les uns et les autres s'associant in fine en un véritable syndrome névrotique dans lequel elle paraît définitivement installée : « Elle revivait surtout dans le passé, dans le vieux passé, hantée par les premiers temps de sa vie et par son voyage de noces, là-bas en Corse « (chapitre V). On constate alors que le bovarysme de Jeanne n'est en rien comparable à celui d'Emma : raison d'agir pour celle-ci dès lors qu'il s'agit de forcer le réel à prendre les couleurs du rêve, il pousse en revanche celle-là à la résignation dès la première déception venue : « Oui, c'était fini d'attendre. « (chapitre VI). Elle est finalement plus aliénée, plus inexistante, plus nulle. Elle ne trompe même pas son époux, comme le fait Emma qui est plus passionnée, plus lyrique, plus tragique et va jusqu'au suicide. Elle se contente très prosaïquement de vieillir dans une lente et inexorable décrépitude, ne se défendant plus contre l'adversité, subissant dans la passivité, sans autres réactions que celles, purement réflexes, de son corps contre toutes les méchancetés du destin. Elle vit un malheur discret, modeste et rentré, d'une médiocrité résignée : «L'habitude mettait sur sa vie une couche de résignation pareille au revêtement de calcaire que certaines eaux déposent sur les objets. Et une sorte d'intérêt pour les mille choses insignifiantes de l'existence quotidienne, un souci des simples et médiocres occupations régulières renaquit en son coeur.... Ainsi que les vieux fauteuils du salon ternis par les temps, tout se décolorait doucement à ses yeux, tout s'effaçait, prenait une nuance pâle et morne.« Le souvenir, en tant que relique, a pour elle une fonction sécurisante : «Une idée la saisit qui fut bientôt une obsession terrible, incessante, acharnée. Elle voulait retrouver presque jour par jour ce qu'ellle avait fait [...] elle parvenait parfois à retrouver un mois entier, reconstituant un à un, groupant, rattachant l'un à l'autre tous les petits faits qui avaient précédé ou suivi un événements important.« Elle parvient fort paradoxalement à revivre rétrospectivement ce qu'en fait elle n'a jamais vécu, faisant après coup le plein de son vide. Le roman devient progressivement une écriture du souvenir où la perte est oubliée à force d'être rituellement rappelée. Jeanne finit par faire de sa vie un reliquaire qui, même s'il ne contient que ce qu'elle a manqué, masque son néant. Se souvenir de ce qu'elle n'a pas été est sa façon d'être. La force des objets sur elle est telle qu'ils ajoutent à son calvaire : après la mort d'Adélaïde, «chaque rencontre de tout objet que maniait incessamment la morte« la crible de souffrance. Or, parmi ces reliques, des lettres que celle-ci a reçues lui livrent des secrets douloureux. La jeune femme est également sensible à la mémoire affective, involontaire. C'est le cas par exemple lorsque, à la fin du roman, revenue aux Peuples, elle reconnaît une «odeur qu'elle avait toujours gardée, qui grisait sa mémoire« au point de voir dans une hallucination sa mère et son père. Elle connaît un extrême dénuement existentiel, puisque démunie d'elle-même, elle ne peut plus qu'écrire dans le vide, qu'écrire le vide. Il n'est pas de scène plus significative que celle où, privée de son fils chéri, elle essaie désespérément d'écrire son nom dans le vide : «Et, tout bas, ses lèvres murmuraient : “Poulet, mon petit Poulet”, comme si elle lui eût parlé ; et, sa rêverie s'arrêtant sur ce mot, elle essayait parfois pendant des heures d'écrire dans le vide, de son doigt tendu, les lettres qui le composaient. Elle les traçait lentement, devant le feu, s'imaginant les voir, puis, croyant s'être trompée, elle recommençait le P d'un bras tremblant de fatigue, s'efforçant de dessiner le nom jusqu'au bout ; puis, quand elle avait fini, elle recommençait.« Au sein de cette vacuité généralisée que dispose ce roman hostile à toute plénitude, à toute consistance du sujet, on peut considérer que le personnage le plus typique est tante Lison à cause de son extrême discrétion. Elle est si modeste et réservée qu'elle en devient fantomatique : «C'était une petite femme qui parlait peu, s'effaçait toujours, apparaissait seulement aux heures des repas, et remontait ensuite dans sa chambre où elle restait enfermée sans cesse.« - «C'était quelque chose comme une ombre ou un objet familier, un meuble vivant qu'on est accoutumé à voir chaque jour, mais don on ne s'inquiète jamais« - «Elle ne tenait point de place ; c'était un de ces êtres qui demeurent inconnus même à leurs proches, comme inexplorés, et dont la mort ne fait ni trou ni vide dans une maison«. Elle fait partie de Ia grande communauté amorphe et silencieuse de ces êtres qui n'ont pas d'être, de ces êtres inexistants. Sa mort passe évidemment inaperçue, car comment remarquer la disparition du néant? Dans la mesure où “Une vie” est le récit de l'inexistence, tante Lison constitue la version la plus achevée de cette dissolution de l'identité qui dépossède d'eux-mêmes maints personnages de Maupassant. Dans ce roman de la perte d'identité, dont presque tous les personnages ne valent que négativement, tante Lison figure en quelque sorte une Jeanne de Lamare poussée à l'extrême, menée jusqu'à ses dernières conséquences, puisqu'aussi bien l'héroïne elle-même se définit plus par ce qu'elle n'est pas que par ce qu'elle devient. Les personnages d'”Une vie” sont donc complexes et ils demeurent opaques. En ce qui concerne ceux qui ont fauté, on ne sait jamais toute la vérité. Julien n'avoue jamais quoi que ce soit sur ses relations avec Rosalie, ni d'ailleurs avec Gilberte. Le baron non plus avec «les petites bobonnes«. On ne sait rien des amours d'Adélaïde avec Paul d'Ennemare. Quant au comte de Fourville, il a agi instinctivement, sans préméditation, et Tolbiac aussi. Ils ne sont donc pas tout à fait mauvais, car Maupassant refuse le manichéisme. Jeanne est présentée comme une victime, mais les autres sont-ils pour autant des bourreaux? D'ailleurs, si Julien était parfaitement odieux et justement puni, “Une vie” deviendrait le roman édifiant qu'il refuse absolument d'être. Intérêt philosophique Si le roman n'est pas édifiant n'a-t-il pas cependant une morale? Il reste que ce n'est pas Maupassant qui la tire, même s'il émet parfois des aphorismes moraux. Il n'eut d'autre vérité dernière à délivrer que celle que lui fournissait la sagesse populaire. D'autre part, il n'assigna pas, comme Zola, une mission politique au roman, car il ne croyait pas au progrès. Il se contenta de faire la satire de cette société en plein déclin, se moquant à la fois de ceux qui croient au progrès et de ceux qui s'enferment dans les conventions sociales, non sans ambiguïté car, d'une part, il dénonça les codes idéologiques de la société du XIXe siècle, satisfit le lecteur anticlérical ou paillard, et, d'autre part, condamna l'adultère, satisfit le lecteur bien-pensant qui pouvait se rassurer devant le châtiment du méchant et le triomphe ultime de la vertu, du sacrifice et de la maternité. En fait, Maupassant voulut surtout montrer le destin misérable des cœurs nobles et des âmes sensibles. Pour lui, l'être humain est faible et limité. L'effacement de l'identité de l'héroïne dans le titre offre la possibilité au lecteur d'y lire un peu la sienne, d'y découvrir à son tour la série de ses désillusions. L'existence de cette femme ressemble à celles de beaucoup d'autres. Son fiasco est celui qui guette tout être humain. Chacun peut reconnaître en lui-même cet écart entre ce qu'il croit et ce qui est, constater que l'amour et le bonheur conjugal sont des illusions, qu'on ne fait alors qu'obéir à un instinct aveugle, que le mariage et la famille font faillite, que les figures paternelle et maternelle ne sont pas toujours pures, que la maternité est un piège. Comme elle après la trahison de Gilberte, le lecteur peut penser : «Tout le monde était donc perfide, menteur et faux«. Comme elle après la mort de sa mère, il peut songer : «Tout trompait, tout mentait, tout faisait souffrir et pleurer«. “Une vie” montre le malheur inhérent à la condition humaine : la solitude intrinsèque. Dès la Corse, Jeanne s'est aperçue que «deux personnes ne se pénètrent jamais jusqu'à l'âme, jusqu'au fond des pensées, qu'elles marchent côte à côte, enlacées parfois, mais non mêlées et que l'être moral de chacun de nous reste éternellement seul par la vie«. Revenue aux Peuples, devant les lueurs des fermes dans la nuit, elle a «la sensation vive de l'isolement de tous les êtres que tout désunit, que tout sépare, que tout entraîne loin de ce qu'ils aimeraient«. Allant plus loin encore que Flaubert dans le désespoir philosophique, Maupassant avait une conception pessimiste de la vie, qu'il puisait dans celle du «plus grand saccageur de rêves qui ait passé sur la terre«, Schopenhauer. Il s'en prit à tout ce qui pouvait inspirer quelque confiance dans la vie : «La vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui«. Autrement dit, insatisfait, le désir engendre la souffrance ; assouvi, il engendre l'ennui. Tout se répète sans cesse et lamentablement. Attaquant la religion comme une duperie, il nia la Providence, considéra Dieu comme «ignorant de ce qu'il fait«, l'univers comme un déchaînement de forces aveugles et inconnaissables, l'être humain comme «une bête à peine supérieure aux autres«. Cependant, dans “Une vie”, ce pessimisme n'était pas encore intégral : Maupassant accordait encore une place à la vertu, à la bonté. Son fatalisme n'excluait pas l'espoir comme on le voit à la fin : « La vie, voyez-vous, ça n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on croit. « Destinée de l'oeuvre Achevé au début de 1883, le roman parut en feuilleton dans ‘'Gil Blas'' du 27 février au 6 avril et fut aussitôt publié chez Havard. Si quelques critiques reprochèrent à Maupassant son pessimisme, la plupart admirèrent son art de peindre la vie même. Le roman connut le succès : plus de vingt-cinq mille exemplaires en quelques mois. Ne fut sans doute pas étrangère à ce succès la censure qu'exerça la Librairie Hachette, titulaire de la distribution des livres dans les gares et qui refusa de diffuser un roman jugé scandaleux et immoral. Censure face à laquelle Maupassant lança une pétition adressée à la Chambre des députés et que signèrent notamment Huysmans, Mendès, Becque, Rochefort, Mirbeau, Janzé, pour réclamer la fin du monopole d'Hachette et protester contre l'interdiction d'''Une vie''. De nos jours encore, ce premier roman reste considéré comme le plus abouti des romans de Maupassant, au côté de ‘'Bel-Ami''. Le roman fut plusieurs fois adapté au cinéma : - En 1947, par le Finlandais Särkkä Toïvo. - En 1958, par le Français Alexandre Astruc, adaptation qui fut un modèle du genre, qui s'achevait par la mort de Julien et de Gilberte (première partie du roman), Maria Schell interprétant le rôle de Jeanne avec beaucoup de conviction (86 minutes). - En 2004, par Éllisabeth Rappeneau pour la télévision (90 minutes).

«
ne peut s'empêcher d'établir un parallèle entre Une Vie et
Madame Bovary), enfin dans le portrait psychologique de
Jeanne, l'héroïne, ce « cœur simple >> qui, chez Flaubert, a
pour nom Félicité.
Zola et les naturalistes, avec qui Maupas
sant partage les fameuses soirées de Médan, l'initient au
roman social (importance du document social -influence
du milieu et de l'hérédité -création de « types »).
2.
L'œuvre : architecture,
mouvements, personnages
Une composition rigoureuse
Donner l'illusion de la réalité implique, pour Maupassant,
de mettre de l'ordre là où la vie n'en met pas.
La compo
sition d'Une Vie répond à ce principe : si le roman est l'his
toire d'une vie qui se défait peu à peu, allant de la plénitude
au néant, l'ordre des chapitres offre l'image d'une parfaite
courbe descendante:
Une rupture s'établit en effet dès la fin
du chapitre v (les chapitres J, II, Ill sont ceux de la plénitude
- les chapitres
IV et v, les chapitres pivots à partir desquels
tout semble basculer -enfin les chapitres VI à XIV mar·
quent la descente progressive vers la dépossession et le
vide).
1.
Les chapitres de la plénitude (I, II, III)
Jeanne est une jeune fille comblée : elle est riche (le château
des Peuples lui est destiné), aimée
(la cellule familiale et
sociale la protège), jeune et jolie (elle sort du couvent, n'est
âgée
que de dix-sept ans, a un visage à la Véronèse), elle
goûte pleinement
aux joies que lui offre la nature (les bains
de mer et les promenades dans la campagne normande) ...
200.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- UNE VIE. Roman de Guy de Maupassant (résumé et analyse de l'oeuvre)
- Une vie de Maupassant (résumé & analyse)
- Analyse sur Une Vie de Maupassant.
- UNE VIE, MAUPASSANT (RÉSUMÉ ET ANALYSE)
- Guy de MAUPASSANT: Une Vie (Résumé & Analyse)