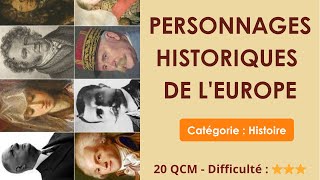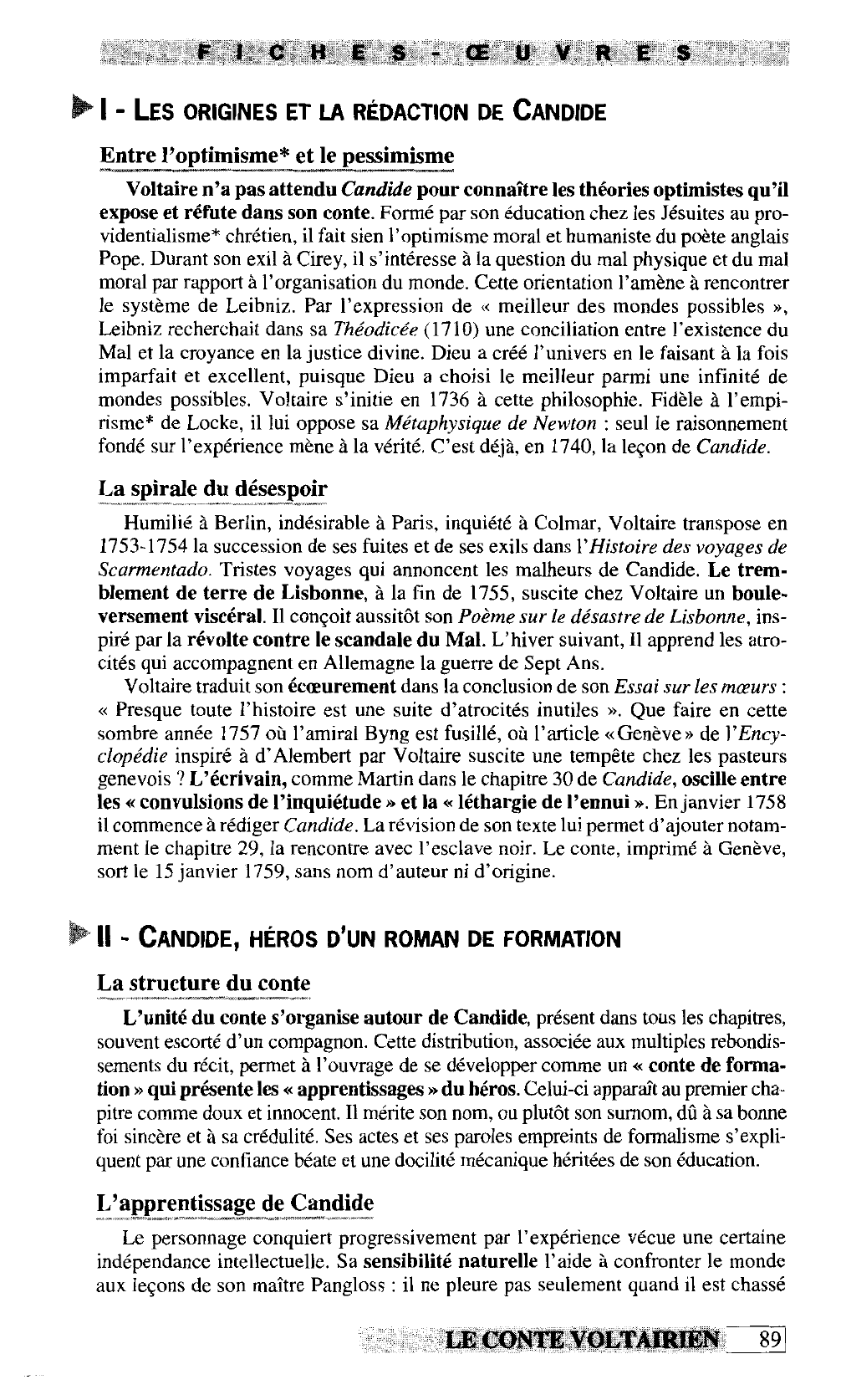Candide (1759) de Voltaire
Publié le 27/03/2015

Extrait du document


«
1 -LES ORIGINES ET LA RÉDACTION DE CANDIDE
Entre l'optimisme* et le pessimisme
Voltaire n'a pas attendu Candide pour connaître les théories optimistes qu'il
expose et réfute dans son conte.
Formé par son éducation chez les Jésuites au pro
videntialisme* chrétien, il fait sien l'optimisme moral et humaniste du poète anglais
Pope.
Durant son exil à Cirey, il s'intéresse à la question du mal physique et du mal
moral par rapport à l'organisation du monde.
Cette orientation l'amène à rencontrer
le système de Leibniz.
Par l'expression de « meilleur des mondes possibles »,
Leibniz recherchait dans sa Théodicée (1710) une conciliation entre !'existence du
Mal et la croyance en la justice divine.
Dieu a créé
! 'univers en le faisant à la fois
imparfait et excellent, puisque Dieu a choisi le meilleur parmi une infinité de
mondes possibles.
Voltaire s'initie en 1736 à cette philosophie.
Fidèle à l'empi
risme* de Locke, il lui oppose sa Métaphysique
de Newton : seul le raisonnement
fondé sur l'expérience mène à la vérité.
C'est déjà, en 1740, la leçon de Candide.
~~--~pir~I~-~~- dé~~~°-~
Humilié à Berlin, indésirable à Paris, inquiété à Colmar, Voltaire transpose en
1753-1754 la succession de ses fuites et de ses exils
dans!' Histoire des voyages de
Scarmentado.
Tristes voyages qui annoncent les malheurs de Candide.
Le trem
blement de terre de Lisbonne, à la fin de 1755, suscite chez Voltaire un boule
versement viscéral.
Il conçoit aussitôt son Poème sur le désastre de Lisbonne, ins
piré par la
révolte contre le scandale du Mal.
L'hiver suivant, Il apprend les atro
cités qui accompagnent en Allemagne la guerre de Sept Ans.
Voltaire traduit son
écœurement dans la conclusion de son Essai sur les mœurs :
« Presque toute l'histoire est une suite d'atrocités inutiles ».
Que faire en cette
sombre année 1757 où l'amiral Byng est fusillé, où l'article
«Genève» de !'Ency
clopédie inspiré à d'Alembert par Voltaire suscite une tempête chez les pasteurs
genevois?
L'écrivain, comme Martin dans le chapitre 30 de Candide, oscille entre
les« convulsions de l'inquiétude» et la« léthargie de l'ennui».
En janvier 1758 il commence à rédiger Candide.
La révision de son texte lui permet d'ajouter notam
ment le chapitre 29, la rencontre avec l'esclave noir.
Le conte, imprimé à Genève,
sort le
15 janvier 1759, sans nom d'auteur ni d'origine.
Il -CANDIDE, HÉROS D'UN ROMAN DE FORMATION
La structure du conte
L'unité du conte s'organise autour de Candide, présent dans tous les chapitres,
souvent escorté d'un compagnon.
Cette distribution, associée aux multiples rebondis
sements du récit, permet à !'ouvrage de se développer comme un
« conte de forma
tion»
qui présente les« apprentissages» du héros.
Celui-ci apparaît au premier cha
pitre comme doux et innocent.
Il mérite son nom, ou plutôt son surnom, dû à sa bonne
foi sincère et à sa crédulité.
Ses actes et ses paroles empreints de formalisme s'expli
quent par une confiance béate et une docilité mécanique héritées de son éducation.
~'.-~pp~e_nJ:!ssage ~~Çan~i~~
Le personnage conquiert progressivement par l'expérience vécue une certaine
indépendance intellectuelle.
Sa sensibilité naturelle l'aide à confronter le monde
aux leçons
de son maître Pangloss : il ne pleure pas seulement quand il est chassé.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Nègre de Surinam - de Candide ou l’optimiste, un conte philosophique écrit par Voltaire en 1759
- CANDIDE (1759) de Voltaire (résumé & analyse)
- PANGLOSS. Personnage de Candide (1759), conte de Voltaire
- Dans le texte l’esclave, un humain exploité et nié extrait de Candide, paru en 1759, Voltaire raconte la rencontre de Candide et son valet avec un esclave, qui lui, leur raconte sa vie misérable qui est du à un commerçant blanc.
- « Candide », Voltaire(1759)