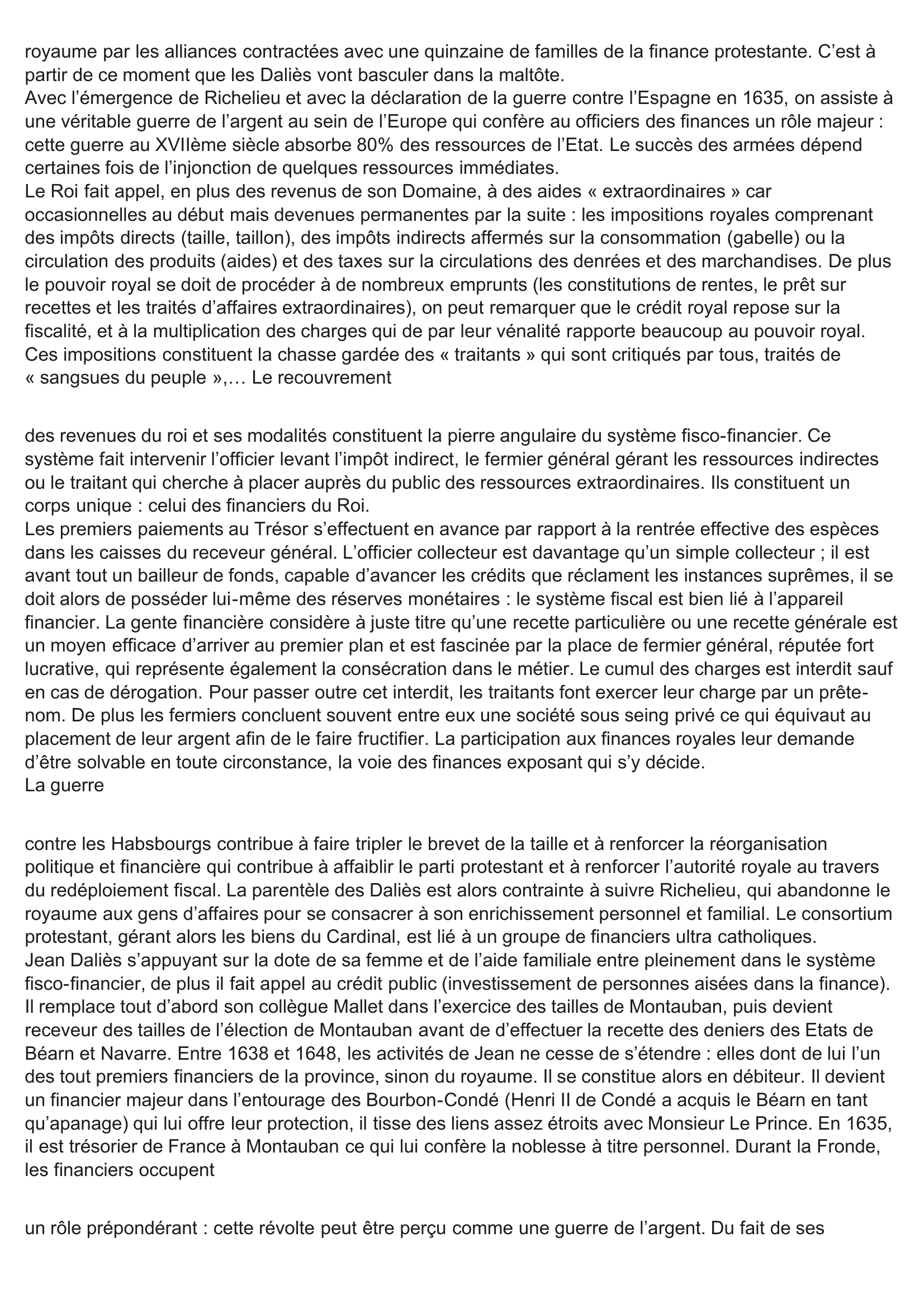Fiche De Lecture - Daliès De Montauban - D. Dessert
Publié le 10/11/2012

Extrait du document
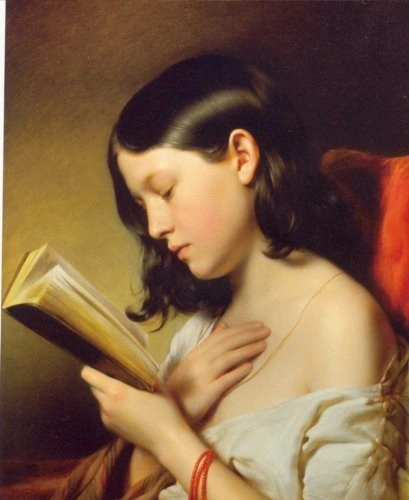
devient alors le protecteur de la famille, sa nouvelle figure de proue. Avec son adhésion au grand projet
du Rémois Colbert à la fin de 1661, la famille protestante rebondit et acquiert dans le monde des
publicains une importance plus considérable encore. Il entraîne dans son sillage ses frères. Protestant, il
se doit de recourir aux inévitables prête-noms Par son efficacité, Samuel Daliès se distingue des autres
associés de Colbert : défendant avec enthousiasme son mentor et sa politique, il est soutenu par Colbert
en toutes circonstances. Cette protection lui procure de nombreux soutiens et associés dans le monde de
la Finance. Samuel s’appuie sur de jeunes parents, pour contrôler les recettes de Montauban et les faire
exercer par commission : ainsi il ne risque pas l’opposition d’officiers rebelles. Colbert renforce de plus en
plus la prééminence de Samuel Daliès en Dauphiné : il voit chez lui un caractère entreprenant,
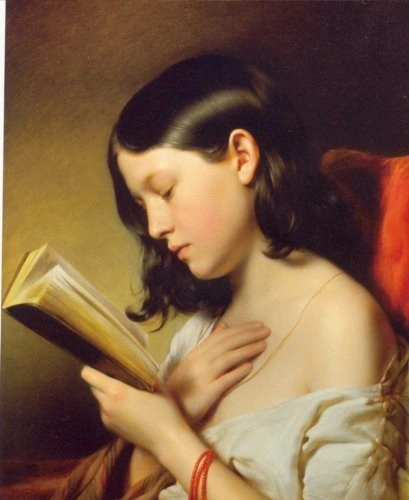
«
royaume par les alliances contractées avec une quinzaine de familles de la finance protestante.
C’est à
partir de ce moment que les Daliès vont basculer dans la maltôte.
Avec l’émergence de Richelieu et avec la déclaration de la guerre contre l’Espagne en 1635, on assiste à
une véritable guerre de l’argent au sein de l’Europe qui confère au officiers des finances un rôle majeur :
cette guerre au XVIIème siècle absorbe 80% des ressources de l’Etat.
Le succès des armées dépend
certaines fois de l’injonction de quelques ressources immédiates.
Le Roi fait appel, en plus des revenus de son Domaine, à des aides « extraordinaires » car
occasionnelles au début mais devenues permanentes par la suite : les impositions royales comprenant
des impôts directs (taille, taillon), des impôts indirects affermés sur la consommation (gabelle) ou la
circulation des produits (aides) et des taxes sur la circulations des denrées et des marchandises.
De plus
le pouvoir royal se doit de procéder à de nombreux emprunts (les constitutions de rentes, le prêt sur
recettes et les traités d’affaires extraordinaires), on peut remarquer que le crédit royal repose sur la
fiscalité, et à la multiplication des charges qui de par leur vénalité rapporte beaucoup au pouvoir royal.
Ces impositions constituent la chasse gardée des « traitants » qui sont critiqués par tous, traités de
« sangsues du peuple »,… Le recouvrement
des revenues du roi et ses modalités constituent la pierre angulaire du système fisco-financier.
Ce
système fait intervenir l’officier levant l’impôt indirect, le fermier général gérant les ressources indirectes
ou le traitant qui cherche à placer auprès du public des ressources extraordinaires.
Ils constituent un
corps unique : celui des financiers du Roi.
Les premiers paiements au Trésor s’effectuent en avance par rapport à la rentrée effective des espèces
dans les caisses du receveur général.
L’officier collecteur est davantage qu’un simple collecteur ; il est
avant tout un bailleur de fonds, capable d’avancer les crédits que réclament les instances suprêmes, il se
doit alors de posséder lui -même des réserves monétaires : le système fiscal est bien lié à l’appareil
financier.
La gente financière considère à juste titre qu’une recette particulière ou une recette générale est
un moyen efficace d’arriver au premier plan et est fascinée par la place de fermier général, réputée fort
lucrative, qui représente également la consécration dans le métier.
Le cumul des charges est interdit sauf
en cas de dérogation.
Pour passer outre cet interdit, les traitants font exercer leur charge par un prête-
nom.
De plus les fermiers concluent souvent entre eux une société sous seing privé ce qui équivaut au
placement de leur argent afin de le faire fructifier.
La participation aux finances royales leur demande
d’être solvable en toute circonstance, la voie des finances exposant qui s’y décide.
La guerre
contre les Habsbourgs contribue à faire tripler le brevet de la taille et à renforcer la réorganisation
politique et financière qui contribue à affaiblir le parti protestant et à renforcer l’autorité royale au travers
du redéploiement fiscal.
La parentèle des Daliès est alors contrainte à suivre Richelieu, qui abandonne le
royaume aux gens d’affaires pour se consacrer à son enrichissement personnel et familial.
Le consortium
protestant, gérant alors les biens du Cardinal, est lié à un groupe de financiers ultra catholiques.
Jean Daliès s’appuyant sur la dote de sa femme et de l’aide familiale entre pleinement dans le système
fisco-financier, de plus il fait appel au crédit public (investissement de personnes aisées dans la finance).
Il remplace tout d’abord son collègue Mallet dans l’exercice des tailles de Montauban, puis devient
receveur des tailles de l’élection de Montauban avant de d’effectuer la recette des deniers des Etats de
Béarn et Navarre.
Entre 1638 et 1648, les activités de Jean ne cesse de s’étendre : elles dont de lui l’un
des tout premiers financiers de la province, sinon du royaume.
Il se constitue alors en débiteur.
Il devient
un financier majeur dans l’entourage des Bourbon-Condé (Henri II de Condé a acquis le Béarn en tant
qu’apanage) qui lui offre leur protection, il tisse des liens assez étroits avec Monsieur Le Prince.
En 1635,
il est trésorier de France à Montauban ce qui lui confère la noblesse à titre personnel.
Durant la Fronde,
les financiers occupent
un rôle prépondérant : cette révolte peut être perçu comme une guerre de l’argent.
Du fait de ses.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Fiche de lecture le Comte de monte Cristo de ALEXANDRE DUMAS
- FICHE DE LECTURE : LE MONDE OUVRIER DE 1870-1914
- Lecture linéaire fiche gargantua
- Claude Bernard : Introduction à l'étude de la médecine expérimentale (fiche de lecture)
- Fiche lecture : Epicure - Lettre à Ménécée