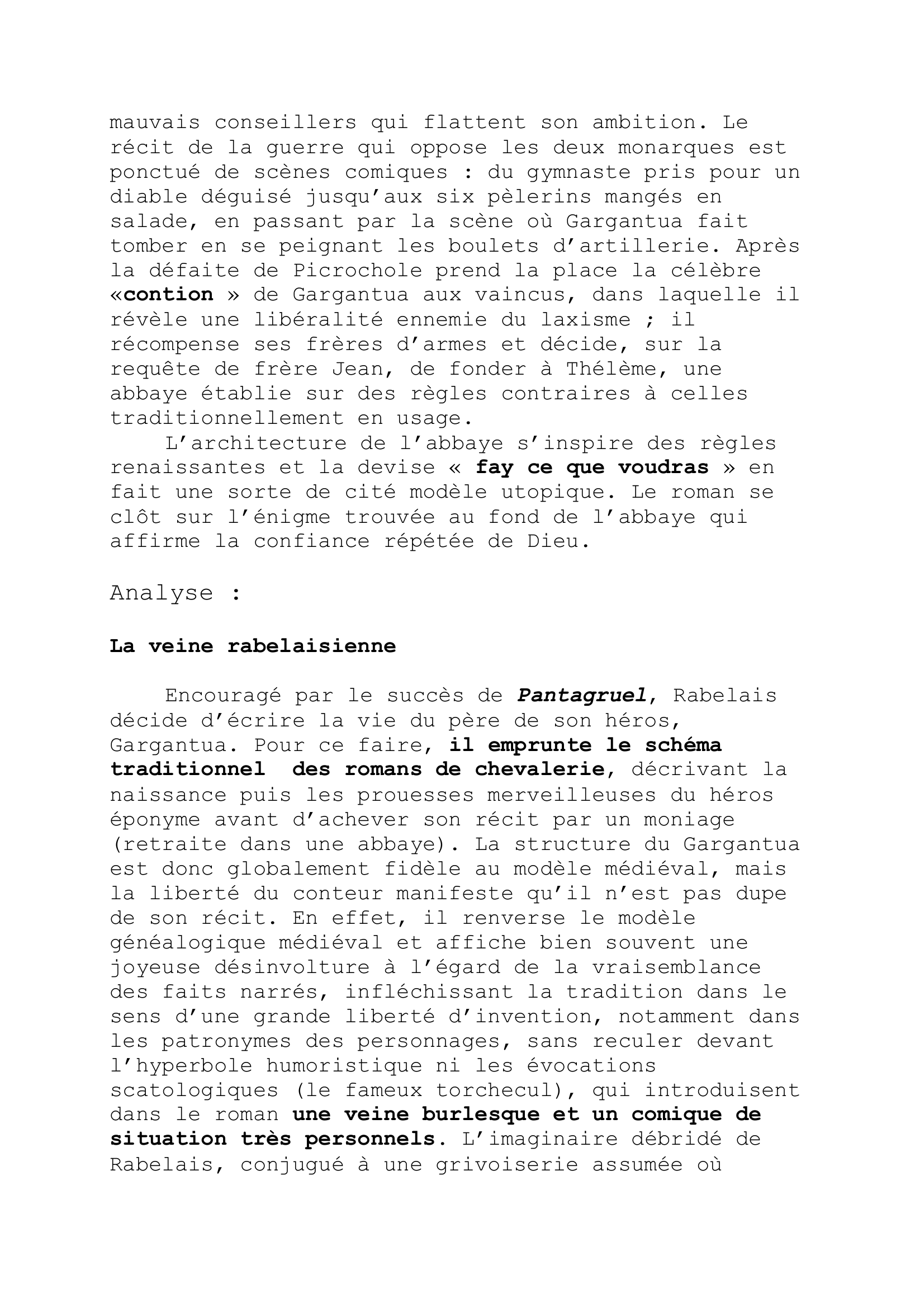Gargantua (1535) - Résumé
Publié le 02/04/2012

Extrait du document


«
mauvais conseillers qui flattent son ambition.
Le
récit de la guerre qui oppose les deux monarques est
ponctué de scènes comiques : du gymnaste pris pour un
diable déguisé jusqu’aux six pèlerins mangés en
salade, en passant par la scène où Gargantua fait
tomber en se peignant les boulets d’artillerie.
Après
la défaite de Picrochole prend la place la célèbre
«contion » de Gargantua aux vaincus, dans laquelle il
révèle une libéralité ennemie du laxisme ; il
récompense ses frères d’armes et décide, sur la
requête de frère Jean, de fonder à Thélème, une
abbaye établie sur des règles contraires à celles
traditionnellement en usage.
L’architecture de l’abbaye s’inspire des règles
renaissantes et la devise « fay ce que voudras » en
fait une sorte de cité modèle utopique.
Le roman se
clôt sur l’énigme trouvée au fond de l’abbaye qui
affirme la confiance répétée de Dieu.
Analyse :
La veine rabelaisienne
Encouragé par le succès de Pantagruel , Rabelais
décide d’écrire la vie du père de son héros,
Gargantua.
Pour ce faire, il emprunte le schéma
traditionnel des romans de chevalerie , décrivant la
naissance puis les prouesses merveilleuses du héros
éponyme avant d’achever son récit par un moniage
(retraite dans une abbaye).
La structure du Gargantua
est donc globalement fidèle au modèle médiéval, mais
la liberté du conteur manifeste qu’il n’est pas dupe
de son récit.
En effet, il renverse le modèle
généalogique médiéval et affiche bien souvent une
joyeuse désinvolture à l’égard de la vraisemblance
des faits narrés, infléchissant la tradition dans le
sens d’une grande liberté d’invention, notamment dans
les patronymes des personnages, sans reculer devant
l’hyperbole humoristique ni les évocations
scatologiques (le fameux torchecul), qui introduisent
dans le roman une veine burlesque et un comique de
situation très personnels .
L’imaginaire débridé de
Rabelais, conjugué à une grivoiserie assumée où.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Gargantua - RÉSUMÉ
- VIE INESTIMABLE DE GARGANTUA, PERE DE PANTAGRUEL (La) François Rabelais (résumé & analyse)
- GARGANTUA ET PANTAGRUEL. (résumé)
- Antoine MARIOTTE : GARGANTUA (résumé et analyse de l’œuvre – Répertoire lyrique)
- résumé gargantua