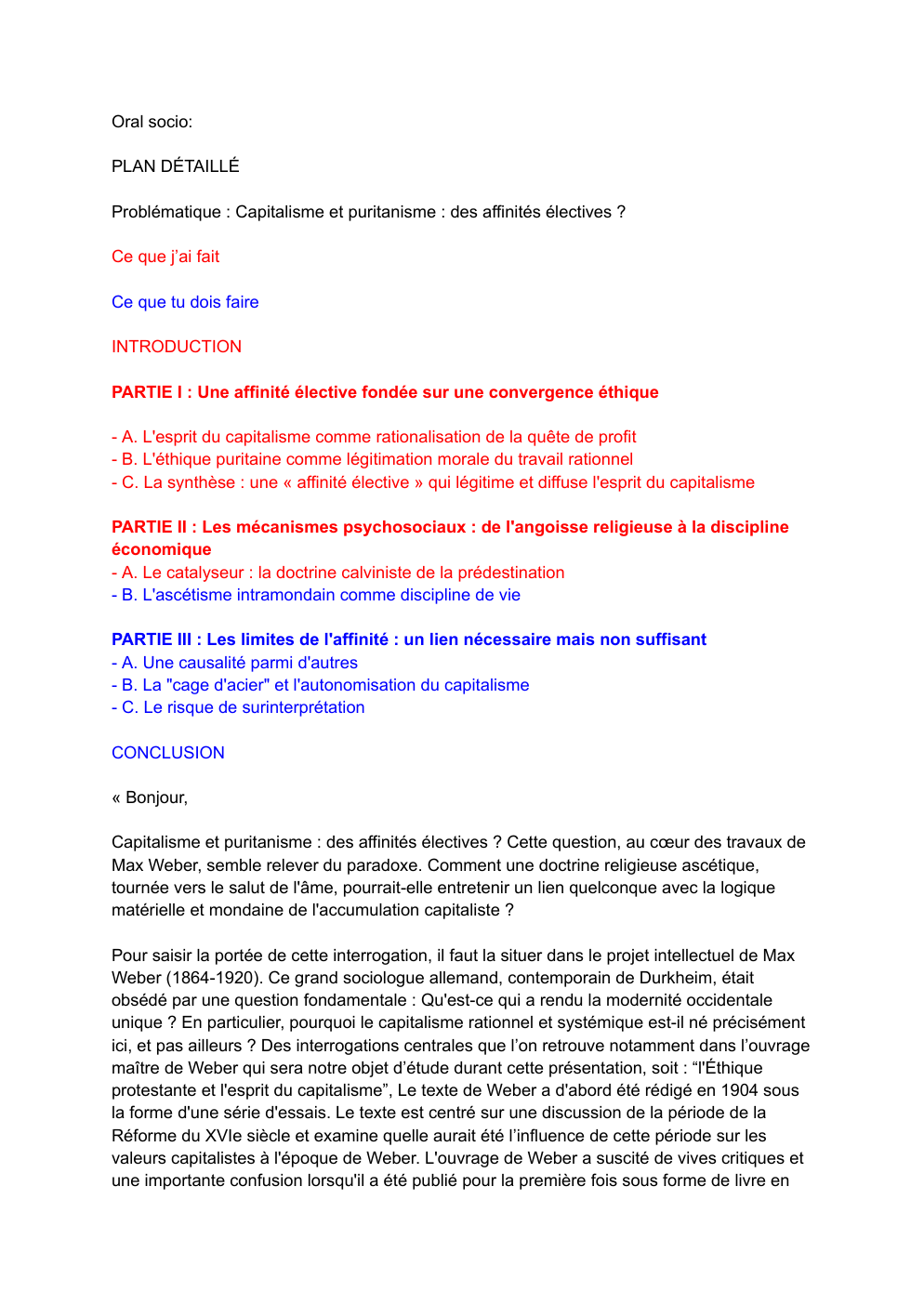Max Weber esprit du capitalisme
Publié le 24/10/2025
Extrait du document
«
Oral socio:
PLAN DÉTAILLÉ
Problématique : Capitalisme et puritanisme : des affinités électives ?
Ce que j’ai fait
Ce que tu dois faire
INTRODUCTION
PARTIE I : Une affinité élective fondée sur une convergence éthique
- A.
L'esprit du capitalisme comme rationalisation de la quête de profit
- B.
L'éthique puritaine comme légitimation morale du travail rationnel
- C.
La synthèse : une « affinité élective » qui légitime et diffuse l'esprit du capitalisme
PARTIE II : Les mécanismes psychosociaux : de l'angoisse religieuse à la discipline
économique
- A.
Le catalyseur : la doctrine calviniste de la prédestination
- B.
L'ascétisme intramondain comme discipline de vie
PARTIE III : Les limites de l'affinité : un lien nécessaire mais non suffisant
- A.
Une causalité parmi d'autres
- B.
La "cage d'acier" et l'autonomisation du capitalisme
- C.
Le risque de surinterprétation
CONCLUSION
« Bonjour,
Capitalisme et puritanisme : des affinités électives ? Cette question, au cœur des travaux de
Max Weber, semble relever du paradoxe.
Comment une doctrine religieuse ascétique,
tournée vers le salut de l'âme, pourrait-elle entretenir un lien quelconque avec la logique
matérielle et mondaine de l'accumulation capitaliste ?
Pour saisir la portée de cette interrogation, il faut la situer dans le projet intellectuel de Max
Weber (1864-1920).
Ce grand sociologue allemand, contemporain de Durkheim, était
obsédé par une question fondamentale : Qu'est-ce qui a rendu la modernité occidentale
unique ? En particulier, pourquoi le capitalisme rationnel et systémique est-il né précisément
ici, et pas ailleurs ? Des interrogations centrales que l’on retrouve notamment dans l’ouvrage
maître de Weber qui sera notre objet d’étude durant cette présentation, soit : “l'Éthique
protestante et l'esprit du capitalisme”, Le texte de Weber a d'abord été rédigé en 1904 sous
la forme d'une série d'essais.
Le texte est centré sur une discussion de la période de la
Réforme du XVIe siècle et examine quelle aurait été l’influence de cette période sur les
valeurs capitalistes à l'époque de Weber.
L'ouvrage de Weber a suscité de vives critiques et
une importante confusion lorsqu'il a été publié pour la première fois sous forme de livre en
1905.
Weber a ensuite révisé l'essai et ajouté de nombreuses notes de bas de pages
explicatives pour sa réédition en 1920.
Contrairement à d'autres approches, Weber postule que les idées, les croyances et les
valeurs sont des forces historiques autonomes, capables d'orienter en profondeur les
comportements économiques.
Son œuvre cherche ainsi à établir un dialogue entre l'idéel et
le matériel.
C'est dans cette perspective que notre réflexion s'articulera autour de la problématique
suivante : Capitalisme et puritanisme : des affinités électives ? Autrement dit, existe-t-il une
congruence, une rencontre féconde entre ces deux systèmes de pensée a priori
antagonistes ?
Pour y répondre, notre analyse s'organisera en trois temps :
Premièrement, nous définirons ce que Weber entend par « esprit du capitalisme » et «
éthique protestante » pour mettre en lumière leur affinité structurelle.
Deuxièmement, nous analyserons le mécanisme psychologique généré par la doctrine de la
prédestination, qui a transformé l'angoisse religieuse en une force motrice économique.
Enfin, nous interrogerons la portée et les limites de cette « affinité élective » pour nuancer la
thèse wébérienne.
I.
Une affinité élective fondée sur une convergence éthique
A.
L'esprit du capitalisme comme rationalisation de la quête de profit
Weber entreprend d'abord de définir avec précision ce qu'il nomme “l'esprit du capitalisme”.
Il s'agit pour lui de dépasser l'idée selon laquelle le capitalisme ne serait que la simple
recherche du profit.
1.
La rupture avec l' “ homme économique traditionnel” :
Avant l'émergence du capitalisme moderne, l'attitude économique dominante était celle d'un
individu qui travaille pour satisfaire des besoins traditionnels et connus.
Une fois ces besoins
comblés, la motivation à accumuler davantage s'éteint.
La recherche du profit pour lui-même
existe, mais elle est souvent perçue comme moralement condamnable, relevant de l'avarice
ou d'une pulsion irrationnelle.
Définition: L'homo œconomicus (homme économique) désigne chez les utililaristes
l’homme rationnel qui utilise les ressources disponibles pour maximiser son utilité.
Cette
représentation théorique du comportement de l'être humain est à la base du modèle
néo-classique en économie.
Max Weber utilise l'expression dans L'Éthique protestante et l'Esprit du capitalisme en
soutenant que l'éthique puritaine de l'existence « a veillé sur le berceau de l'homo
œconomicus moderne »
2.
La construction d'un idéal-type : la figure de Benjamin Franklin :
Dans le cadre de cet exposé, Benjamin Franklin (1706-1790) est pour Max Weber la figure
idéal-typique qui incarne "l'esprit du capitalisme" dans sa forme la plus pure.
Homme
d'affaires, scientifique et philosophe américain, ses écrits - notamment ses conseils
pratiques sur l'épargne et le travail - illustrent parfaitement l'idée que la recherche
méthodique du profit est devenue une fin en soi, une éthique sécularisée.
Weber le cite abondamment pour montrer comment cette mentalité capitaliste s'est
autonomisée de son fondement religieux originel.
Pour saisir la spécificité de l'esprit du capitalisme, Weber a recours à la méthode de
“l'idéal-type”.
Il prend pour exemple les écrits de Benjamin Franklin et ses maximes : « Le
temps, c'est de l'argent », « Le crédit est de l'argent ».
L'important n'est pas ces proverbes
en eux-mêmes, mais “l'éthique systématique qu'ils révèlent”.
« Car non seulement un sens élevé des responsabilités y est indispensable, mais de plus il y
faut un état d’esprit qui soit libéré, au moins pendant les heures de travail, de la
sempiternelle question : comment gagner un salaire donné avec le maximum de commodité
et le minimum d’efforts ? Le travail, au contraire, doit s’accomplir comme s’il était un but en
soi – une « vocation » [Beruf].
» p.63
-) Le travail n'est plus un moyen, mais une “fin en soi”, une vocation (*Beruf*).
« Il redoute l’ostentation et la dépense inutile tout autant que la jouissance consciente de sa
puissance ; il se sent gêné des signes extérieurs de considération sociale dont il est l’objet.
En d’autres termes – et nous allons examiner la signification historique de ce fait important
– sa vie emprunte souvent un visage ascétique, ce qui apparaissait nettement dans le «
sermon » de Benjamin Franklin que nous avons cité.
» pp.73-74
C'est ainsi que Weber décrit l’« idéal type » d'un entrepreneur capitaliste.
Selon Weber, ceux
qui réussissent constamment sont généralement des personnes humbles qui travaillent dur
sans rechercher la reconnaissance.
D'une certaine manière, cette attitude peut être qualifiée
d'approche ascétique de la vie, puisqu'elle implique le rejet des plaisirs inutiles, même si elle
implique également l'accumulation de richesses.
Weber montre clairement que ce type
d'attitude ascétique est présent dans le texte de Benjamin Franklin, puisqu'il conseille à ses
disciples de rejeter les excès afin d'accumuler un capital de manière fiable.
C'est également
un type d'attitude qui sera important pour la suite de l'analyse de Weber sur l'histoire qui a
conduit à l'esprit capitaliste.
3.
Le noyau de l'esprit du capitalisme :
« Ce qui est réellement condamnable, du point de vue moral, c’est le repos dans la
possession, la jouissance de la richesse et ses conséquences : oisiveté, tentations de la
chair, risque surtout de détourner son énergie de la recherche d’une vie « sainte ».
Et ce
n’est pas dans la mesure où elle implique le danger de ce repos que la possession est tenue
en suspicion.
».
p.188
Weber identifie ainsi le cœur de cette mentalité : la combinaison d'une pulsion
d'acquisition illimitée avec un rejet strict de toute jouissance spontanée des richesses.
Cette
combinaison, apparemment contre-nature, constitue le terreau sur lequel va pouvoir s'opérer
une rencontre décisive avec une éthique religieuse inattendue.
Cette éthique du travail et de l'accumulation, si contraire aux instincts naturels, nécessitait
une justification extrêmement puissante pour s'imposer.
C'est précisément cette justification
que l'ascétisme intramondain du puritanisme est venu lui fournir.
B.
L'éthique puritaine comme légitimation morale du travail rationne
Si l'esprit du capitalisme constitue une mentalité spécifique, il ne peut s'épanouir sans une
légitimation morale puissante.
C'est ici qu'intervient l'éthique puritaine, qui va fournir à cette
rationalité économique naissante un cadre de valeur et une motivation profondément
enracinée dans le religieux.
1.
La sanctification du travail profane : la notion de “Beruf”:
« Mais estimer que le devoir s’accomplit dans les affaires temporelles, qu’il constitue
l’activité morale la plus haute que l’homme puisse s’assigner ici-bas – voilà sans
conteste le fait absolument nouveau.
Inéluctablement, l’activité quotidienne revêtait
ainsi une signification religieuse, d’où ce sens [de vocation] que prend la notion de
Beruf.
» p.90
La Réforme protestante opère une révolution symbolique majeure en conférant une
“valeur religieuse au travail séculier”.
Le terme allemand “Beruf”, signifiant à la fois « métier
» et « vocation », incarne cette synthèse nouvelle.
Désormais, accomplir son devoir dans
son métier, quel qu'il soit, n'est plus une activité purement mondaine mais une “obligation
religieuse”, une manière de servir Dieu.
Cette sacralisation du travail ordinaire constitue une
rupture radicale avec l'idéal catholique de la vie monastique, qui valorisait la retraite hors du
monde comme voie de sainteté supérieure.
2.
L'ascétisme intramondain : une discipline de vie
Le puritanisme pousse cette....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire de texte : L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme de Max Weber
- ÉTHIQUE PROTESTANTE ET L’ESPRIT DU CAPITALISME (L’), Max Weber
- ÉTHIQUE PROTESTANTE ET L’ESPRIT DU CAPITALISME (Sur l’) Max Weber
- Éthique protestante et l'esprit du capitalisme, l' [Max Weber] - sociologie.
- Max Weber: L'Éthique Protestante Et L'Esprit Du Capitalisme