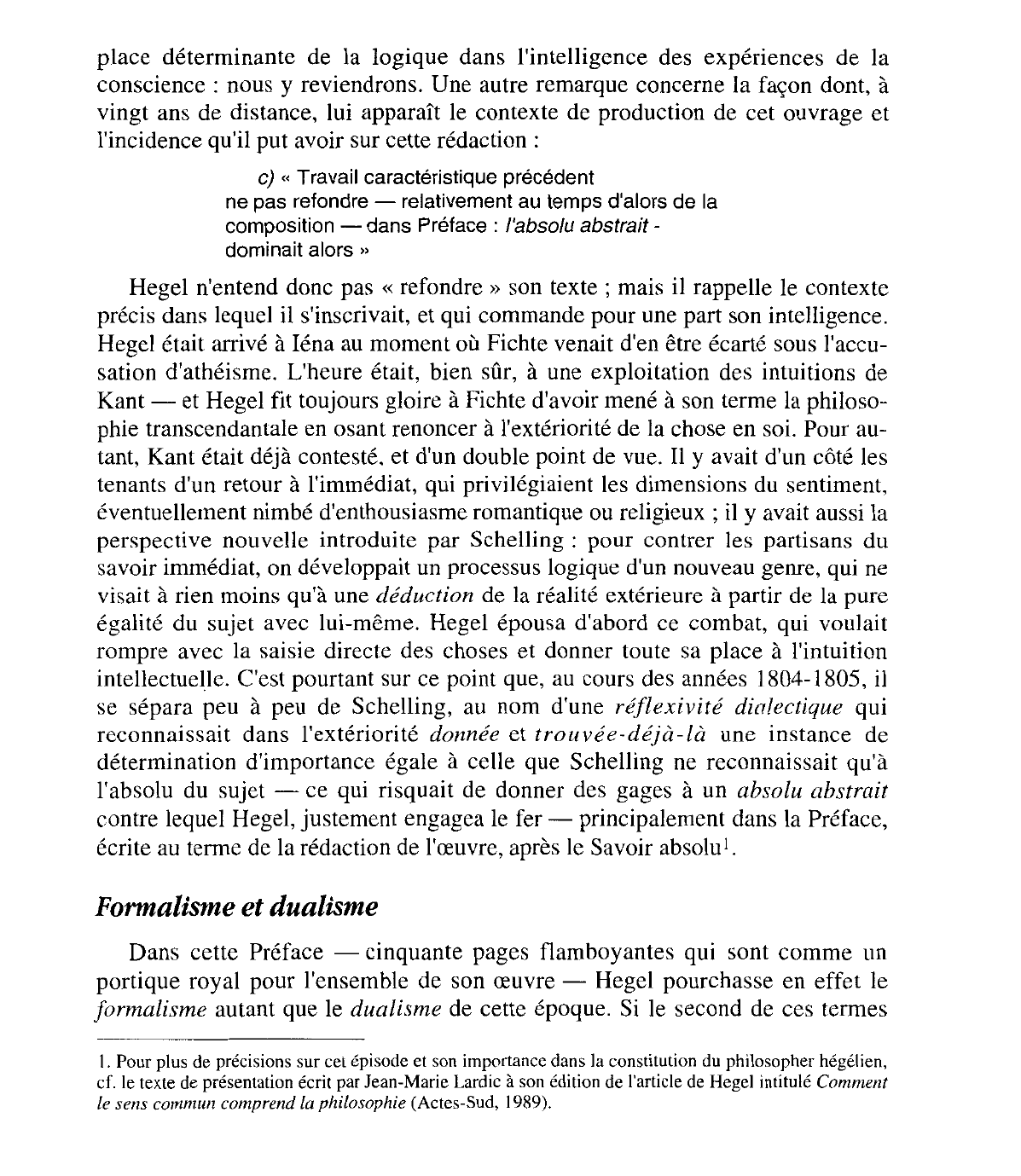Phénoménologie de l'esprit de Hegel (analyse et résumé)
Publié le 21/03/2015

Extrait du document

Entre octobre 1805 et janvier 1807, Hegel, en des temps difficiles marqués par la guerre et les incertitudes d'une révolution culturelle, s'attacha à rédiger le premier de ses grands ouvrages systématiques, La Phénoménologie de l'esprit.
Occupé à préparer de nouvelles moutures de l'Encyclopédie des sciences philosophiques (qui parurent en 1827 puis en 1830) comme aussi de la Science de la logique (dont il n'eut le temps de refondre que le premier livre, consacré à L'Être), Hegel n'engagea cette nouvelle tâche que peu de temps avant sa mort, survenue le 14 novembre 1831.
place déterminante de la logique dans l'intelligence des expériences de la conscience : nous y reviendrons.
C'est pourquoi ce moment particulier du déploiement d'une Philosophie de l'esprit ne reprend, sous mode ultra-résumé, que les deux premières sections de l'oeuvre de 1807, et s'arrête au seuil de la troisième.
Mais pour cela, on ne pouvait en rester à l'être formel de la simple conscience ; car le point de vue du savoir philosophique est en même temps en lui-même le plus riche en teneur essentielle et le plus concret ; par conséquent, émergeant comme résultat, il présupposait aussi les figures concrètes de la conscience, comme par exemple celles de la morale, de la vie éthique, de l'art, de la religion.
Rien d'étonnant, par conséquent, à ce qu'il y ait un lien étroit entre les trois premières sections et la quatrième, et Hegel l'explicite en montrant, une fois encore dans l'introduction à la Religion, comment leur contenu se trouve reversé, si l'on peut dire, dans la section Esprit, qui se trouve alors décider à elle seule du sens véritable qui est celui de l'Esprit dans sa conscience.
Ainsi le formalisme possible de la raison se trouve-t-il assumé et dépassé --- sursumé --- dans l'effectivité de ces figures d'histoire.
Le rapport du temps de la conscience à la réalité de l'histoire est un point délicat, qu'il faut soigneusement préciser.
Telle est donc la situation : les figures, théoriquement, apparaissent en se disposant selon l'ordre d'une différence temporelle --- et donc d'une succession historique, comprise comme procès de totalisation ---, tandis que les sections décident pratiquement de l'abstraction ou du caractère concret de leur mode d'appréhension, selon le niveau de concrétude logique qui justement marque chacune d'entre elles : appréhension d'abord partielle (Conscience, Autoconscience), puis seulement formelle (Raison), la reprise de toutes ces premières figures sous la raison de l'en-et-pour-soi n'étant possible que dans les deux sections logiquement accomplies que sont l'Esprit et la Religion.
Dans l'exposé relatif à l'Esprit absolu, au terme de l'Encyclopédie des sciences philosophiques, ils formeront les deux premières étapes --- celle de l'idée saisie d'abord dans son immédiateté puis dans son élaboration représentative --- et trouveront à s'accomplir de concert sous les espèces de la philosophie.
Il fut alors de bon ton d'opposer ces premiers écrits, Phénoménologie comprise, à ceux de la grande maturité, dans lesquels on croyait déceler une sorte d'appauvriissement des contenus et de plus grande sécheresse de la forme conceptuelle.
On peut dire que cette sorte de dichotomie, à partir des années vingt et pour un demi-siècle au moins, domina les études hégéliennes.
La Phénoménologie de l'esprit, en France surtout mais aussi en Italie, profita de cette sorte d'intérêt, que renforça bientôt la vogue du courant existentialiste.
L'attention nouvelle portée aux structures de l'oeuvre, et donc à sa finalité logique unitaire, germa principalement, à partir des années cinquante, au sein de ce que l'on nomma parfois l'école de Chantilly, dont le représentant principal, à l'origine, fut Joseph Gauvin.
Depuis lors, de nombreuses études ont vu le jour, en France et dans la plupart des pays, pour justifier ce type de lecture qui reconnaît à la Phénoménologie de l'esprit son statut originaire et véritable : celui d'un ouvrage qui, en s'attachant à une relecture systématique de l'expérience des hommes, dans son immédiateté phénoménale comme dans toute l'extension d'une histoire politique, culturelle et religieuse, ouvre décidément, au coeur de la modernité post-révolutionnaire et post-kantienne, à une nouvelle manière de penser, qui s'efforce de conjoindre la plus grande exigence conceptuelle et la prise en compte de l'immédiateté la plus contingente.

«
Hegel, Phénoménologie de l'esprit 5
place déterminante de la logique dans l'intelligence des expenences de la
conscience : nous y reviendrons.
Une autre remarque concerne la façon dont, à
vingt ans de distance, lui apparaît le contexte de production de cet ouvrage et
l'incidence qu'il put avoir sur cette rédaction :
c) " Travail caractéristique précédent
ne pas refondre -
relativement au temps d'alors de la
composition -dans Préface : l'absolu abstrait -
dominait
alors »
Hegel n'entend donc pas « refondre » son texte ; mais il rappelle le contexte
précis dans lequel il s'inscrivait, et qui commande pour une part son intelligence.
Hegel était arrivé à Iéna au moment où Fichte venait d'en être écarté sous l'accu
sation d'athéisme.
L'heure était, bien sûr, à une exploitation des intuitions de
Kant -et Hegel
fit toujours gloire à Fichte d'avoir mené à son terme la philoso
phie transcendantale en osant renoncer à l'extériorité de la chose en soi.
Pour au
tant, Kant était déjà contesté, et d'un double point de vue.
II y avait d'un côté les
tenants d'un retour à l'immédiat, qui privilégiaient les dimensions du sentiment,
éventuellement nimbé d'enthousiasme romantique ou religieux ;
il y avait aussi la
perspective nouvelle introduite par
Schelling : pour contrer les partisans du
savoir immédiat, on développait un processus logique d'un nouveau genre, qui
ne
visait à rien moins qu'à une déduction de la réalité extérieure à partir de la pure
égalité du sujet avec lui-même.
Hegel épousa d'abord ce combat, qui voulait
rompre avec la saisie directe des choses et donner toute sa place à l'intuition
intellectuelle.
C'est pourtant sur ce point que, au cours des années
1804-1805, il
se sépara peu à peu de Schelling, au nom d'une réflexivité dialectique qui
reconnaissait dans l'extériorité
donnée et trouvée-déjà-là une instance de
détermination d'importance égale à celle que
Schelling ne reconnaissait qu'à
l'absolu du sujet -ce qui risquait de donner des gages à un
absolu abstrait
contre lequel Hegel, justement engagea le fer -principalement dans la Préface,
écrite au terme de la rédaction de I'œuvre, après le Savoir absolu 1.
Fonnalisme et dualisme
Dans cette Préface -cinquante pages flamboyantes qui sont comme un
portique royal pour l'ensemble de son œuvre -Hegel pourchasse en effet le
formalisme autant que le dualisme de cette époque.
Si le second de ces termes
1.
Pour plus de précisions sur cet épisode et son importance dans la constitution du philosopher hégélien,
cf.
le texte de présentation écrit par Jean-Marie Lardie à son édition de l'article de Hegel intitulé Comment le sens commun comprend la philosophie (Actes-Sud, 1989)..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- PHÉNOMÉNOLOGIE DE L’ESPRIT (LA), Georg Wilhelm Friedrich Hegel - résumé de l'oeuvre
- PHÉNOMÉNOLOGIE DE L’ESPRIT (La) de Georg Wilhelm Friedrich Hegel (résumé)
- FRIEDRICH HEGEL : PHENOMENOLOGIE DE L'ESPRIT (Résumé & Analyse)
- De l'esprit des lois de Montesquieu (résumé & analyse)
- ESQUISSE D’UN TABLEAU HISTORIQUE DES PROGRÈS DE L’ESPRIT HUMAIN Condorcet (résumé & analyse)