SAINT-DENYS GARNEAU Hector (vie et oeuvre)
Publié le 13/10/2018

Extrait du document
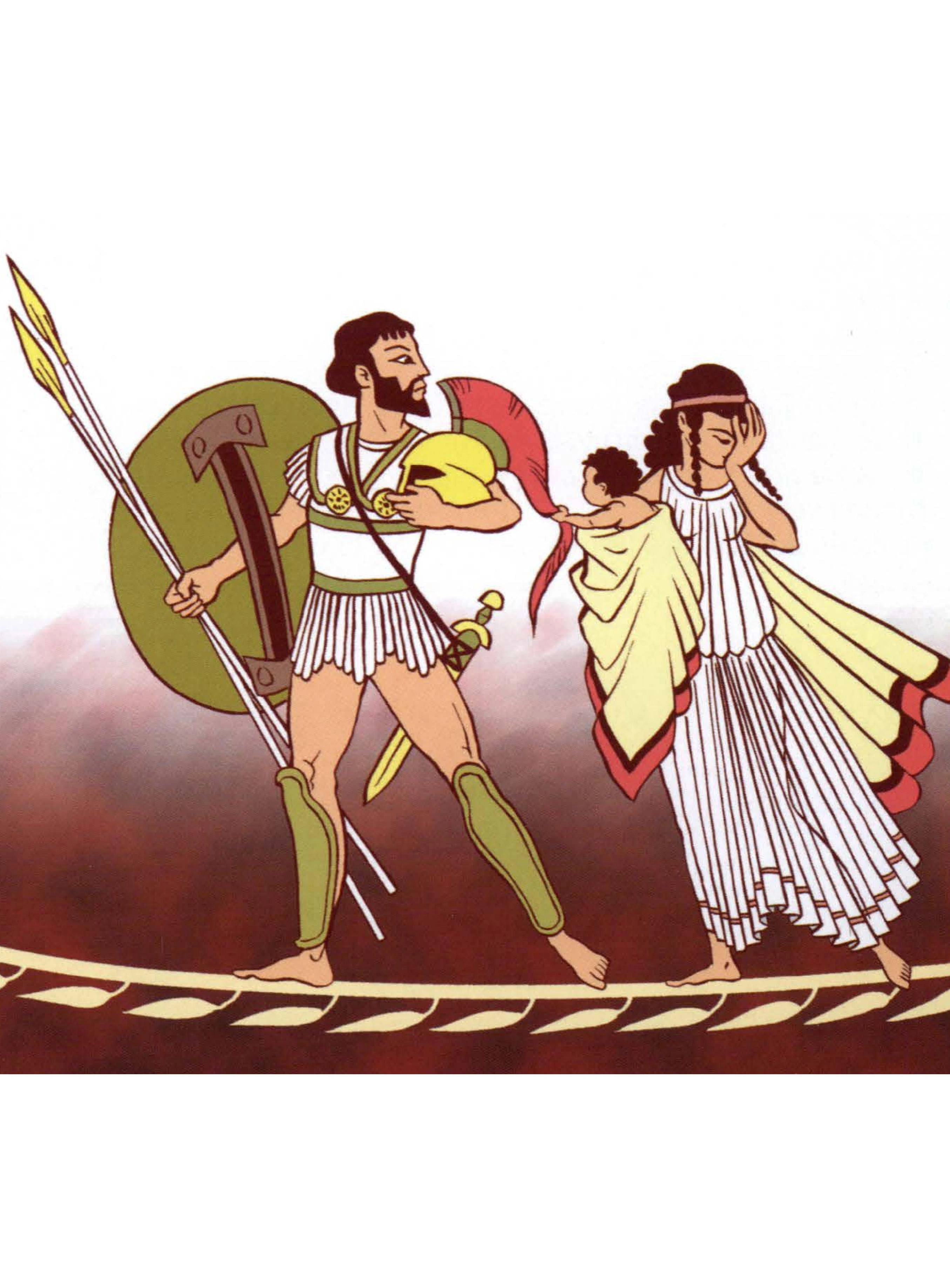
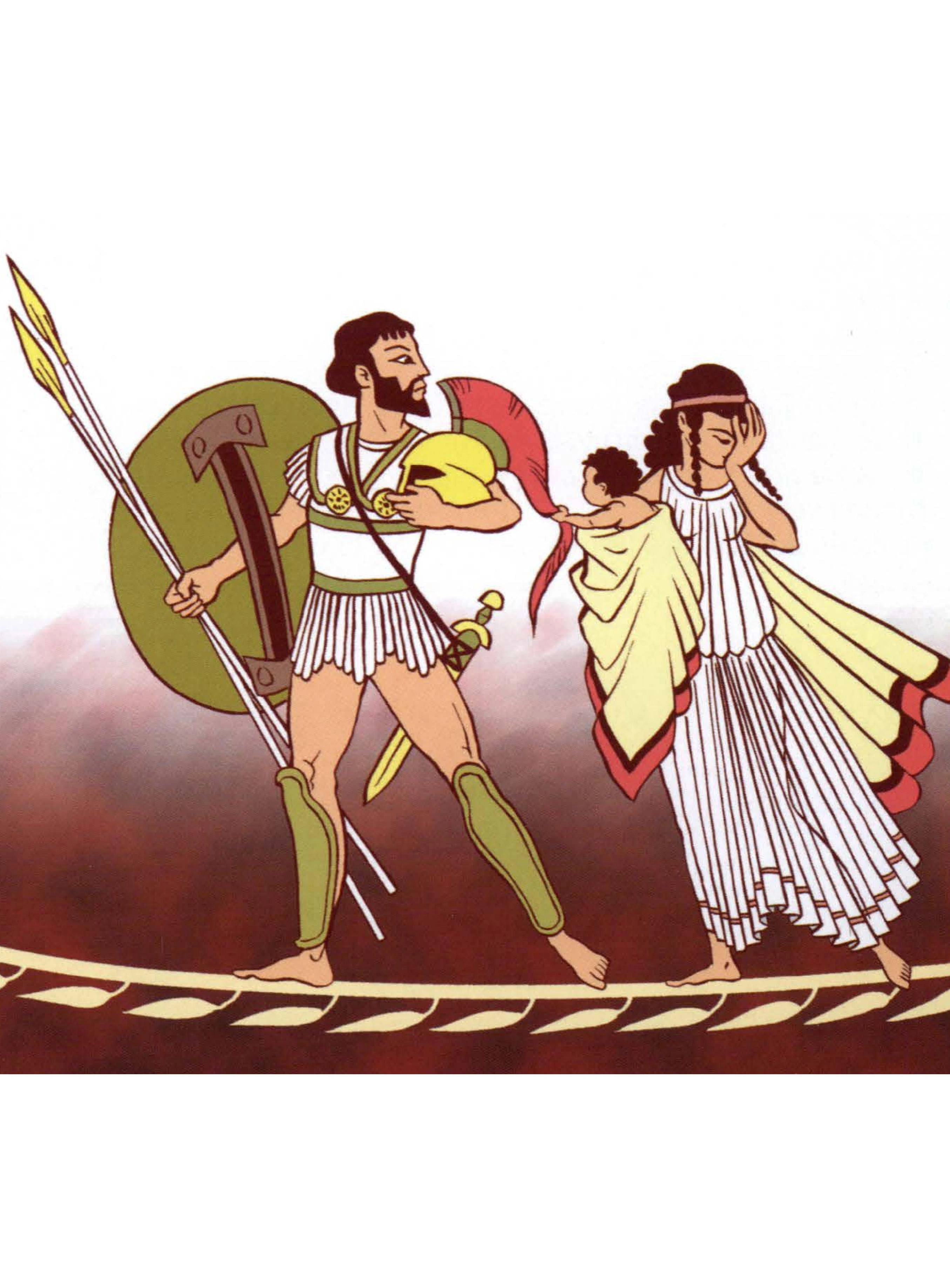
«
voix est fêlée [ ...
], le son n'empUt plus la forme » : lir e Saint-Denys Garneau, c'est entendre à chaque instant cette fêlure, r esse ntir cette inadéquation du langage qui devrait signifier la mort de la poé sie .
Loin du chant, presque grinçante, cette œuvre est d'abord l'élaboration d'une myth ologie du sujet : son régime dominant est celui d'une représentation assez proche de la fable, r éalisée dan s cert ain s textes de prose comme «le Ma uva is Pauvre », inséré dans le Journal.
Ce symbo le de l'étrangeté et de la dépossession se d éve lop pe jusqu'à l'image inqu .iét ante d 'un être dont la colonne vertébrale est assaillie à coups de hach e, et qui se trouv e r éduit à «un seul tron c vertical, franchement nu».
S'il fallait cherc her ici de s parentés, c'est à Henri Michaux qu e l'on songerait , mai s à un Michaux où ce serait moin s la fable elle -m êm e qu i s'imposerait dans son insolent e absurdité, que le mouvement angoi ssé vers
elle, rendu plu s approximatif par l a conscience a nalyti que qui le trav erse.
En ce sens, «Je Mauvais Pauvre » est un texte clé; il définit un certain rapport au lan gage, caractérisé par une tens i on entre 1' ironie la plus profond e et une volont é de figuration int ég rale du sujet , de ses enjeux exi s tentiel s : inadéquation à soi; quête de transpa rence; conscience de la mort.
ll y a chez Saint-Denys Garn eau une in s istan ce pres que panique dans la représentation de soi, marqué e for mellement par des réitérations, par une syntaxe qui déve loppe l'image sur un mode descriptif, avec une froide précision.
De nombreux poèm es de Regards et jeux dan s
l 'espace relèvent de cette écriture, entre autres le cél èbre >, devenu p o ur plusieurs lecteur s la figure idéale de l'aventure du po ète :
Je marche à côté de moi en joie
J'entends mon pas en joie qui marche à côté de moi Mais je ne peux changer de pla c e sur le trottoir Je ne puis pas mettre mes pieds dans ce pas-là et dire voilà, c'est moi.
Mais une lecture psychologique empêche de voir que la représentation se vit chez Saint-Denys Garneau comme une crise : l'écriture déco uvre qu'elle a parti e liée avec la pla ce vide du sujet; loi n de combler la diffé rence entre Je sujet de l'énonciati o n et ce lui de l'é noncé , elle la creuse irrémédiablement, dans un « attardement à reconstruire » qui, pour Saint-Deny s Garneau, caractéri sait la danse et en faisait la forme idéale de l'expression artistique.
La «différence » n'est pas ic i u ne notion abstraite.
Elle est liée , comme son envers, à la très haute exigence de présence qui s'e xprime part out dans cette œuv re.
Comme ses amis de la Relè ve, Saint-Denys Garn eau a été influen cé par Maritain et Mouni er, c'es t-à-dir e p ar une philo soph ie de la présence à soi et au monde.
Mais
il est aussi un héritier direct de Baudelaire, dont il fut
toujo urs le fervent lecte ur.
L 'essentiel, toutefois, c'est le moment où ces influences intellecn 1e lles sont portées par J'écriture jusqu'au fantasme et au mythe : ainsi dan s cette image du Journal où« les mot s » ont souda in «soif de substance».
Saint- Denys Garn ea u a été le premi er poète québécoi s à pouvoir fanta s mer le langage en tant que tel : son écriture ne se met en branle que dans celle
réflexivité , dans une soif qui e st la soif du désert , où le sujet se meurt d'être« sorti en plein ai r».
On ne saurait trop insister sur le fait qu e ce mouve ment utilise en même temps tout es les ressources du discours parlé, souvent Je plus familier.
Avant Gaston Miron, dont les poèmes politique s de la Vie agoniqu e portent la trace de l'auteur de Reg ard s et jeux dans l'es pace, Saint -D enys Garneau a saisi la nécessité de « par ler» dan s l'écriture, de transform er le monologue poéti qu e en dialogue , en interpellation, même s'il y a quelque
chose de dé ses péré et d'inacce ssible dans cette
fa miliarité.
On s'étonne que la plupart de ses contemporains l'aient jugé obsc ur.
On compr end mieux que les poètes de la génération de l'Hexagon e, en 1960 , aient préfé ré à cette proximité du désespoir l'ouverture cosmique des poèmes d'Ala in Grandboi s.
M ais la voix de Saint -D enys Garneau parle de ce qui ne vieillit p as : le sujet fabulant son destin, cherc hant à capter dans une image la forme de sa propre absence .
BIBLIOGRAPHlE É diti on .
- Œuvres, Montréal, P.U.M., « Bibliothèque d es let tres québécoises», 1971 (texte établi, annoté et pré se nté par
Jacques Brault et Benoît Lacroix ).
A consu lter.
- Études françaises, « Ho=age à Saint-Denys
Garneau », novembre 1969 , p.
455- 488 , et «Relire Saint-Denis
Garneau », hiver 1984-1985 , p.
7-12 7; Jacq ues Bla is, Saim Denys Garneau et le thème d'Icare , Sherbrooke, Naarnan , 1973; Roland Boum euf, Saint-Denys Garneau et ses lecfllres europé ennes , Qu ébec, P.U.L., 1969; Éva Ku shner, Saint -D enys Gar
neau , Paris, Seghers et Montréa l, Fidès, «Poètes d'au jourd'hui >>, 1967; Nicole Durand-Lut zy , Saint-Denys Gam ea u.
La couleur d e Dieu, Montréal , Fid~s.
1981; P.
Popovic, «le Différend des disco urs dans Regards et jeux da11s l'es pace», Voix et imag es n° 34, automne 1986; A.
Pur dy, «Au seuil de la modernité : le jeu d'échecs de Saussure et le Jeu de Saint - De nys
Garneau », Revue roma11e, 1986-2; Georges Riser , Co1yon ction et disjonction dans la poésie de Saint -Denys Garneau, Ed.
Uni v.
Ottawa, 1984; R.
Vigneault, Saint- Denys Garneau à travers «Regards el jeux dans l'espace», P.U.
Montréal, 1973.
P.
N EP VEU.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- SAINT-DENYS GARNEAU Hector
- VIE DE SAINT LOUIS de Jean, sire de Joinville (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- SAINT-PIERRE, Charles Irénée Castel, abbé de (vie et oeuvre)
- SAINT-JOHN PERSE, pseudonyme d'Alexis Saint-Leger Leger, dit aussi Alexis Leger (vie et oeuvre)
- VIE DE SAINT ÉTIENNE. (résumé & analyse de l’oeuvre)




