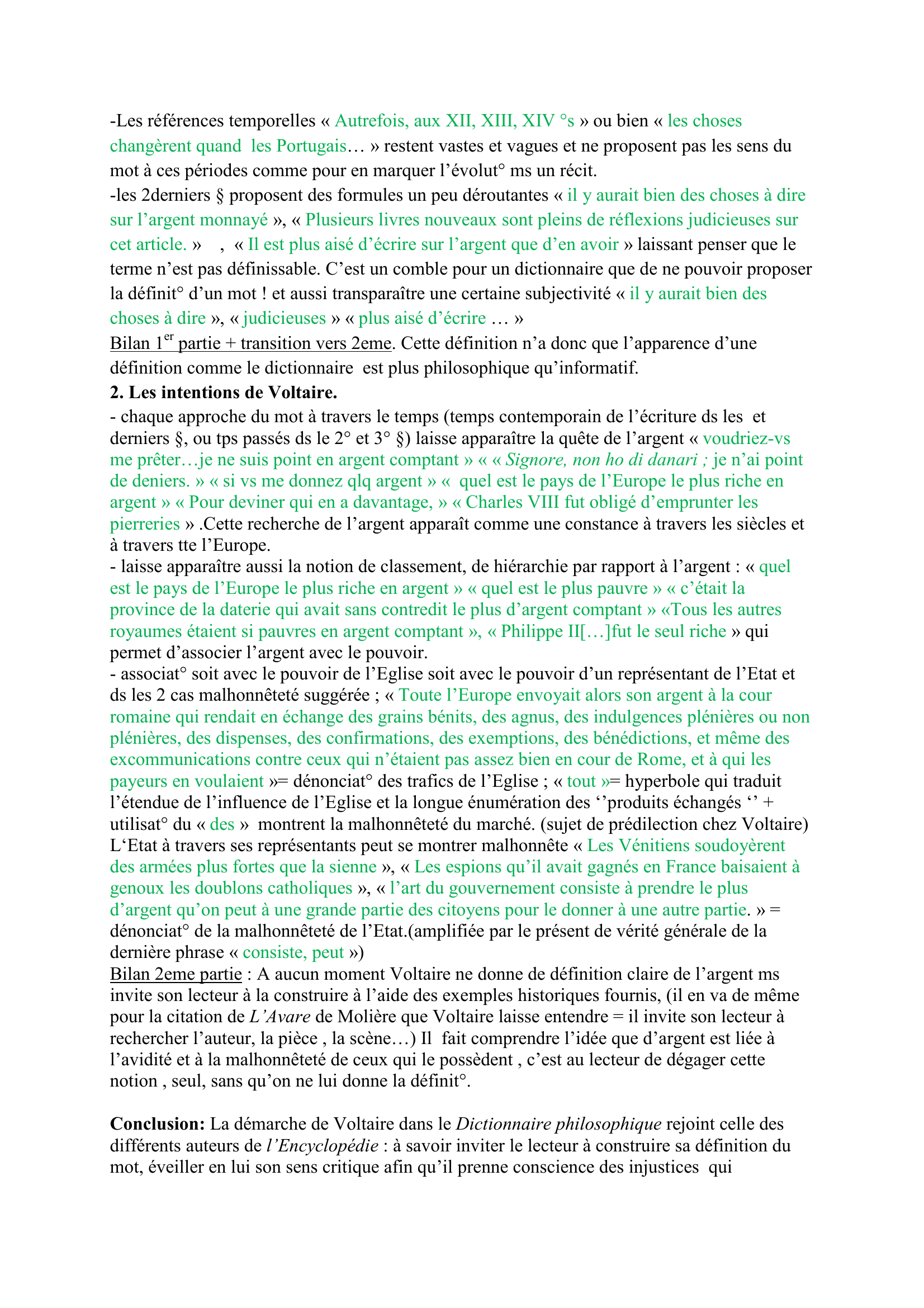voltaire dictionnaire philosophique
Publié le 18/11/2012

Extrait du document


«
-Les références temporelles « Autrefois, aux XII, XIII, XIV °s » ou bien « les choses
changèrent quand les Portugais … » restent vastes et vagues et ne proposent pas les sens du
mot à ces périodes comme pour en marquer l’évolut° ms un réci t.
-les 2derniers § proposent des formules un peu déroutantes « il y aurait bien des choses à dire
sur l’argent monnayé », « Plusieurs livres nouveaux sont pleins de réflexions judicieuses sur
cet article. » ,«Il est plus aisé d’écrire sur l’argent qu e d’en avoir » laissant penser que le
terme n’est pas définissable.
C’est un comble pour un dictionnaire que de ne pouvoir proposer
la définit° d’un mot ! et aussi transparaître une certaine subjectivité « il y aurait bien des
choses à dire », « judicieuse s» « plus aisé d’écrire … »
Bilan 1 erpartie + transition vers 2eme .
Cette définition n’a donc que l’apparence d’une
définition comme le dictionnaire est plus philosophique qu’informatif.
2.
Les intentions de Voltaire.
-chaque approche du mot à travers le temps (temps contemporain de l’écriture ds les et
derniers §, ou tps passés ds le 2° et 3° §) laisse apparaître la quête de l’argent « voudriez -vs
me prêter…je ne suis point en argent comptant » « «Signore, non ho di danari ;je n’ai point
de deniers. » « si vs me donnez qlq argent » « quel est le pays de l’Europe le plus riche en
argent »«Pour deviner qui en a davantage, »«Charles VIII fut obligé d’emprunter les
pierreries » .Cette recherche de l’argent apparaît comme un e constance à travers les siècles et
à travers tte l’Europe.
-laisse apparaître aussi la notion de classement, de hiérarchie par rapport à l’argent : « quel
est le pays de l’Europe le plus riche en argent »«quel est le plus pauvre »«c’était la
provinc e de la daterie qui avait sans contredit le plus d’argent comptant » «Tous les autres
royaumes étaient si pauvres en argent comptant », « Philippe II[…]fut le seul riche » qui
permet d’associer l’argent avec le pouvoir.
-associat° soit avec le p ouvoi r de l’Eglise soit avec le pouvoir d’un représentant de l’Etat et
ds les 2 cas malhonnêteté suggérée ; « Toute l’Europe envoyait alors son argent à la cour
romaine qui rendait en échange des grains bénits, des agnus, des indulgences plénières ou non
plénières, des dispenses, des confirmations, des exemptions, des bénédictions, et même des
excommunications contre ceux qui n’étaient pas assez bien en cour de Rome, et à qui les
payeurs en voulaient »= dénonciat° des trafics de l’Eglise ; « tout »= hyperbole qui tra duit
l’étendue de l’influence de l’Eglise et la longue énumération des ‘’produits échangés ‘’ +
utilisat° du « des » montrent la malhonnêteté du marché.
(sujet de prédilection chez Voltaire) L‘Etat à travers ses représentants peut se montrer malhonnête « Les Vénitiens soudoyèrent des armées plus fortes que la sienne », « Les espions qu’il avait gagnés en France baisaient à genoux les doublons catholiques », « l’art du gouvernement consiste à prendre le plus d’argent qu’on peut à une grande partie des citoy ens pour le donner à une autre partie .» = dénonciat° de la malhonnêteté de l’Etat.(amplifiée par le présent de vérité générale de la dernière phrase « consiste, peut ») Bilan 2eme partie : A aucun moment Voltaire ne donne de définition claire de l’argent ms invite son lecteur à la construire à l’aide des exemples historiques fournis, (il en va de même pour la citation de L’Avare de Molière que Voltaire laisse entendre = il invite son lecteur à rechercher l’auteur, la pièce , la scène…) Il fait comprendre l’idée que d’argent est liée à l’avidité et à la malhonnêteté de ceux qui le possèdent , c’est au lecteur de dégager cette notion , seul, sans qu’on ne lui donne la définit°. Conclusion: La démarche de Voltaire dans le Dictionnaire philo sophique rejoint celle des différents auteurs de l’Encyclopédie : à savoir inviter le lecteur à construire sa définition du mot, éveiller en lui son sens critique afin qu’il prenne conscience des injustices qui. »
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- DICTIONNAIRE PHILOSOPHIQUE, ou la Raison par alphabet, 1764. Voltaire (François Marie Arouet, dit)
- LA2 : VOLTAIRE, Le Dictionnaire Philosophique, article Liberté de penser, 1764 Introduction : -18 ème s : Mouvement des Lumières, mouvement littéraire, culturel, intellectuel, philosophique.
- Voltaire, dictionnaire philosophique ( 1764 )
- Dictionnaire philosophique PORTATIF. Ouvrage de François Marie Arouet, dit Voltaire (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- DICTIONNAIRE PHILOSOPHIQUE Voltaire (résumé & analyse)