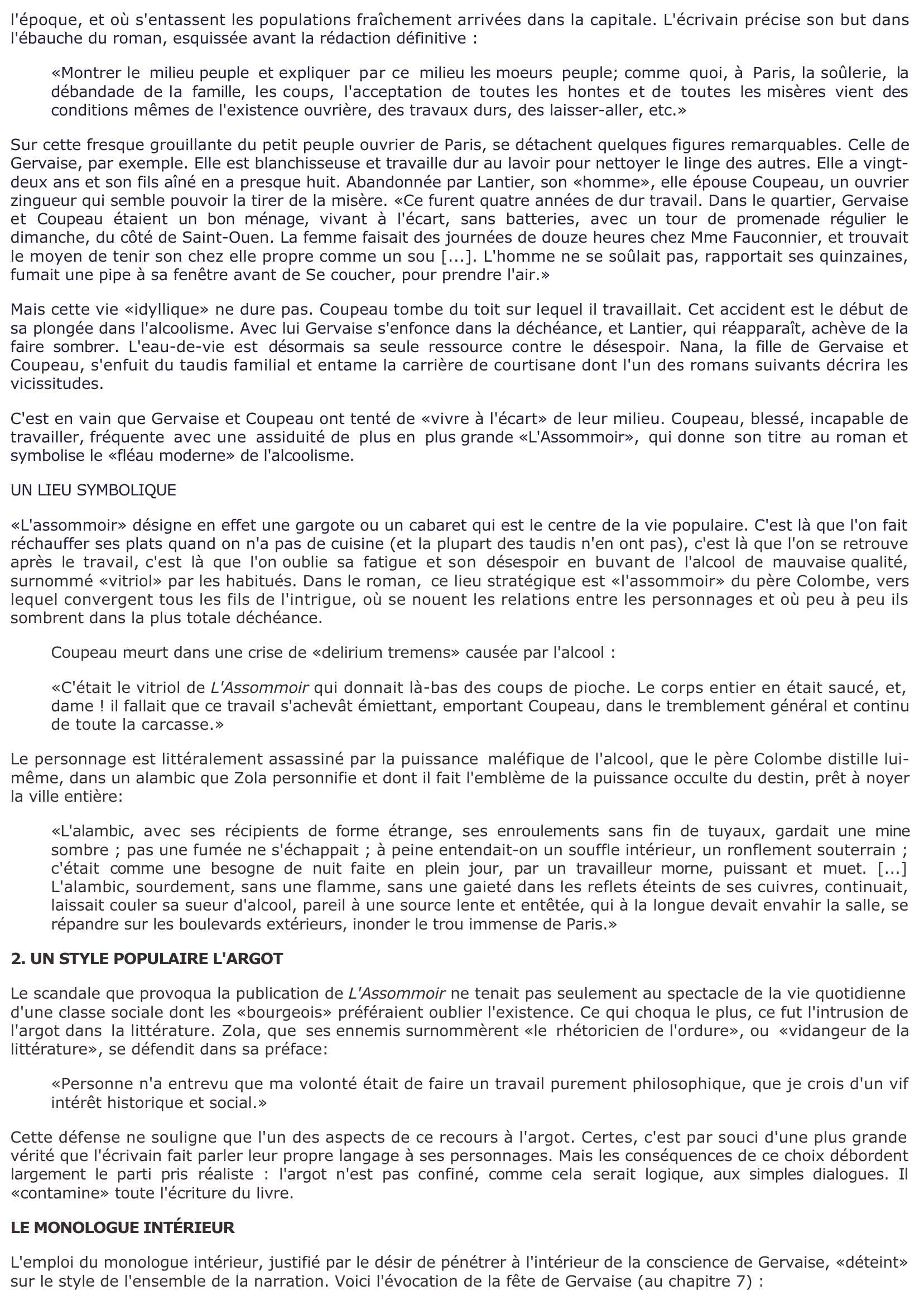ZOLA: L'Assommoir (Fiche de lecture)
Publié le 22/02/2012
Extrait du document


«
l'époque, et où s'entassent les populations fraîchement arrivées dans la capitale.
L'écrivain précise son but dansl'ébauche du roman, esquissée avant la rédaction définitive :
«Montrer le milieu peuple et expliquer par ce milieu les moeurs peuple; comme quoi, à Paris, la soûlerie, ladébandade de la famille, les coups, l'acceptation de toutes les hontes et de toutes les misères vient desconditions mêmes de l'existence ouvrière, des travaux durs, des laisser-aller, etc.»
Sur cette fresque grouillante du petit peuple ouvrier de Paris, se détachent quelques figures remarquables.
Celle deGervaise, par exemple.
Elle est blanchisseuse et travaille dur au lavoir pour nettoyer le linge des autres.
Elle a vingt-deux ans et son fils aîné en a presque huit.
Abandonnée par Lantier, son «homme», elle épouse Coupeau, un ouvrierzingueur qui semble pouvoir la tirer de la misère.
«Ce furent quatre années de dur travail.
Dans le quartier, Gervaiseet Coupeau étaient un bon ménage, vivant à l'écart, sans batteries, avec un tour de promenade régulier ledimanche, du côté de Saint-Ouen.
La femme faisait des journées de douze heures chez Mme Fauconnier, et trouvaitle moyen de tenir son chez elle propre comme un sou [...].
L'homme ne se soûlait pas, rapportait ses quinzaines,fumait une pipe à sa fenêtre avant de Se coucher, pour prendre l'air.»
Mais cette vie «idyllique» ne dure pas.
Coupeau tombe du toit sur lequel il travaillait.
Cet accident est le début desa plongée dans l'alcoolisme.
Avec lui Gervaise s'enfonce dans la déchéance, et Lantier, qui réapparaît, achève de lafaire sombrer.
L'eau-de-vie est désormais sa seule ressource contre le désespoir.
Nana, la fille de Gervaise etCoupeau, s'enfuit du taudis familial et entame la carrière de courtisane dont l'un des romans suivants décrira lesvicissitudes.
C'est en vain que Gervaise et Coupeau ont tenté de «vivre à l'écart» de leur milieu.
Coupeau, blessé, incapable detravailler, fréquente avec une assiduité de plus en plus grande «L'Assommoir», qui donne son titre au roman etsymbolise le «fléau moderne» de l'alcoolisme.
UN LIEU SYMBOLIQUE
«L'assommoir» désigne en effet une gargote ou un cabaret qui est le centre de la vie populaire.
C'est là que l'on faitréchauffer ses plats quand on n'a pas de cuisine (et la plupart des taudis n'en ont pas), c'est là que l'on se retrouve après le travail, c'est là que l'on oublie sa fatigue et son désespoir en buvant de l'alcool de mauvaise qualité,surnommé «vitriol» par les habitués.
Dans le roman, ce lieu stratégique est «l'assommoir» du père Colombe, verslequel convergent tous les fils de l'intrigue, où se nouent les relations entre les personnages et où peu à peu ilssombrent dans la plus totale déchéance.
Coupeau meurt dans une crise de «delirium tremens» causée par l'alcool :
«C'était le vitriol de L'Assommoir qui donnait là-bas des coups de pioche.
Le corps entier en était saucé, et, dame ! il fallait que ce travail s'achevât émiettant, emportant Coupeau, dans le tremblement général et continude toute la carcasse.»
Le personnage est littéralement assassiné par la puissance maléfique de l'alcool, que le père Colombe distille lui-même, dans un alambic que Zola personnifie et dont il fait l'emblème de la puissance occulte du destin, prêt à noyerla ville entière:
«L'alambic, avec ses récipients de forme étrange, ses enroulements sans fin de tuyaux, gardait une minesombre ; pas une fumée ne s'échappait ; à peine entendait-on un souffle intérieur, un ronflement souterrain ;c'était comme une besogne de nuit faite en plein jour, par un travailleur morne, puissant et muet.
[...]L'alambic, sourdement, sans une flamme, sans une gaieté dans les reflets éteints de ses cuivres, continuait,laissait couler sa sueur d'alcool, pareil à une source lente et entêtée, qui à la longue devait envahir la salle, serépandre sur les boulevards extérieurs, inonder le trou immense de Paris.»
2.
UN STYLE POPULAIRE L'ARGOT
Le scandale que provoqua la publication de L'Assommoir ne tenait pas seulement au spectacle de la vie quotidienne d'une classe sociale dont les «bourgeois» préféraient oublier l'existence.
Ce qui choqua le plus, ce fut l'intrusion del'argot dans la littérature.
Zola, que ses ennemis surnommèrent «le rhétoricien de l'ordure», ou «vidangeur de lalittérature», se défendit dans sa préface:
«Personne n'a entrevu que ma volonté était de faire un travail purement philosophique, que je crois d'un vifintérêt historique et social.»
Cette défense ne souligne que l'un des aspects de ce recours à l'argot.
Certes, c'est par souci d'une plus grandevérité que l'écrivain fait parler leur propre langage à ses personnages.
Mais les conséquences de ce choix débordentlargement le parti pris réaliste : l'argot n'est pas confiné, comme cela serait logique, aux simples dialogues.
Il«contamine» toute l'écriture du livre.
LE MONOLOGUE INTÉRIEUR
L'emploi du monologue intérieur, justifié par le désir de pénétrer à l'intérieur de la conscience de Gervaise, «déteint»sur le style de l'ensemble de la narration.
Voici l'évocation de la fête de Gervaise (au chapitre 7) :.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- ASSOMMOIR (L') d'Émile Zola (fiche de lecture)
- Assommoir, l' [Émile Zola] - Fiche de lecture.
- Assommoir, l' [Émile Zola] - fiche de lecture.
- Emile ZOLA (1840-1902), L'Assommoir - Fiche de lecture
- FICHE DE LECTURE: L'ASSOMMOIR D'ÉMILE ZOLA