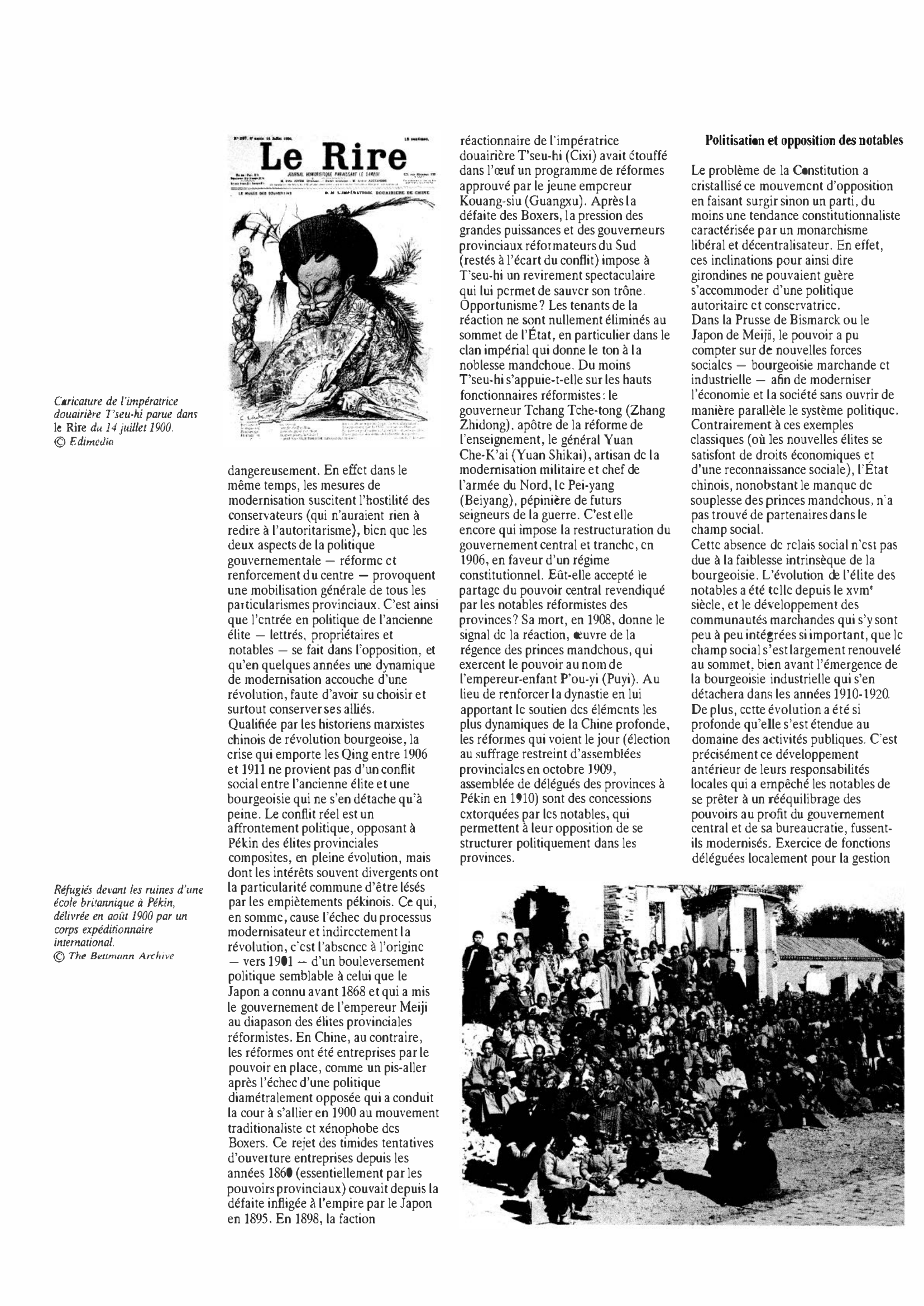Chine de 1900 à 1909 : Histoire
Publié le 30/12/2018
Extrait du document

Des réformes institutionnelles profondes, mais tardives, et qui ne sauvent pas un empire affaibli par les rébellions populaires et l’ouverture imposée par les étrangers dans les années 1840-1860: voilà la dominante des années 1900. L’aggiomamento commence dès 1901, au lendemain de la rébellion des Boxers (1900). Son échec est sanctionné dix ans plus tard, en 1911, par le déclenchement de la révolution qui instaurera la république en 1912.
Un aggiornamento tardif sans assises politiques
L’effondrement de la plus ancienne structure politique vivante au début du siècle (y compris l’Église catholique) pourrait paraître chose normale. D’autant que la dernière dynastie, celle des Qing, contemporaine de Louis XIV, ne manquait pas d’ennemis. Sun Yat-sen (Sun Yixian) lui avait déclaré une guerre sans merci depuis 1895. Bon nombre de Chinois lui reprochaient sa faiblesse à l’égard de l’étranger, et d’être étrangère elle-même, puisque d’origine mandchoue. Pourtant, les réformes ont été à deux doigts de réussir, car elles ont su rallier dans un premier temps la fraction la plus évoluée des notables. Cette entente entre gouvernement et élite réformiste permet d'abolir en 1905 l’institution-clé de l’époque impériale : les examens qui sélectionnent les lettrés et donnent accès au mandarinat. Elle éclate cependant après 1905 lorsque ces alliés du régime, devenus maîtres des provinces, exigent de partager le

«
Cfcricawre
de l'impératrice
douairière T'seu-hi parue dans
Je Rire du 14 juillet 1900.
© Edimedill
Réfugi és devant les ruines d'une
école briJannique à Pékin,
délivrée en août 1900 par un
corps expéditionnaire
internariona/.
© Tite 8ettmam1 Archive =-'"*� :: ..
--·� .;:.::;.:::�
:
S�� ::.�7�:�.: ··-��, :�� ;-�.;-�.
e.OII
L'lOIII> UIOt..U:
dangereusement.
En effet dans le
même temps, les mesures de
modernisation suscitent l'hostilité des
conservateurs (qui n'auraient rien à
redire à l'autoritarisme), bien que les
deux aspects de la politique
gouvernementale -réforme ct
renforcement du centre -provoquent
une mobilisation générale de tous les
particularismes provinciaux.
C'est ainsi
que l'entrée en politique de l'ancienne
élite -lettrés, propriétaires et
notables -se fait dans l'opposition, et
qu'en quelques années une dynamique
de modernisation accouche d'une
révolution, faute d'avoir su choisir et
surtout conserver ses alliés.
Qualifiée par les historiens marxistes
chinois de révolution bourgeoise, la
crise qui emporte les Qing entre 1906
et 1911 ne provient pas d'un conflit
social entre l'ancienne élite et une
bourgeoisie qui ne s'en détache qu'à
peine.
Le conflit réel est un
affrontement politique, opposant à
Pékin des élites provinciales
composites, en pleine évolution, mais
dont les intérêts souvent divergents ont
la particularité commune d'être lésés
par les empiètements pékinois.
Ce qui,
en somme, cause l'échec du processus
modernisateur et indirectement la
révolution, c'est l'absence à l'origine
- vers 1901 -d'un bouleversement
politique semblable à celui que le
Japon a connu avant 1868 et qui a mis
le gouvernement de l'empereur Meiji
au diapason des élites provinciales
réformistes.
En Chine, au contraire,
les réformes ont été entreprises par le
pouvoir en place, comme un pis-aller
après l'échec d'une politique
diamétralement opposée qui a conduit
la cour à s'allier en 1900 au mouvement
traditionaliste et xénophobe des
Boxers.
Ce rejet des timides tentatives
d'ouverture entreprises depuis les
années 1860 (essentiellement par les
pouvoirs provinciaux) couvait depuis la
défaite infligée à l'empire par le Japon
en 1895.
En 1898, la faction réactionnaire
de l'impératrice
douairière T'seu-hi (Cixi) avait étouffé
dans l'œuf un programme de réformes
approuvé par le jeune empereur
Kouang-siu (Guangxu).
Après la
défaite des Boxers, la pression des
grandes puissances et des gouverneurs
provinciaux réformateurs du Sud
(restés à l'écart du conflit) impose à
T'seu-hi un revirement spectaculaire
qui lui permet de sauver son trône.
Opportunisme? Les tenants de la
réaction ne sont nullement éliminés au
sommet de l'État, en particulier dans le
clan impérial qui donne le ton à la
noblesse mandchoue.
Du moins
T'seu-hi s'appuie-t-elle sur les hauts
fonctionnaires réformistes: le
gouverneur Tchang Tche-tong (Zhang
Zhidong), apôtre de la réforme de
l'enseignement, le général Yuan
Che-K'ai (Yuan Shikai), artisan de la
modernisation militaire et chef de
l'armée du Nord, le Pei-yang
(Bei yang), pépinière de futurs
seigneurs de la guerre.
C'est elle
encore qui impose la restructuration du
gouvernement central et tranche, en
1906, en faveur d'un régime
constitutionnel.
Eût-elle accepté le
partage du pouvoir central revendiqué
par les notables réformistes des
provinces? Sa mort, en 1908, donne le
signal de la réaction, œuvre de la
régence des princes mandchous, qui
exercent le pouvoir au nom de
l'empereur-enfant P'ou-yi (Puyi).
Au
lieu de re.nforcer la dynastie en lui
apportant le soutien des éléments les
plus dynamiques de la Chine profonde,
les réformes qui voient le jour (élection
au suffrage restreint d'assemblées
provinciales en octobre 1909,
assemblée de délégués des provinces à
Pékin en 1910) sont des concessions
extorquées par les notables, qui
permettent à leur opposition de se
structurer politiquement dans les
provinces.
Politisation
et opposition des notables
Le problème de la Constitution a
cristallisé ce mouvement d'opposition
en faisant surgir sinon un parti, du
moins une tendance constitutionnaliste
caractérisée par un monarchisme
libéral et décentralisateur.
En effet,
ces inclinations pour ainsi dire
girondines ne pouvaient guère
s'accommoder d'une politique
autoritaire et conservatrice.
Dans la Prusse de Bismarck ou le
Japon de Meiji, le pouvoir a pu
compter sur de nouvelles forces
sociales -bourgeoisie marchande et
industrielle -afin de moderniser
l'économie et l.a société sans ouvrir de
manière parallèle le système politique.
Contrairement à ces exemples
classiques (où les nouvelles élites se
satisfont de droits économiques �t
d'une reconnaissance sociale), l'Etat
chinois, nonobstant le manque de
souplesse des princes mandchous, n'a
pas trouvé de partenaires dans le
champ social.
Cette absence de relais social n'est pas
due à la faiblesse intrinsèque de la
bourgeoisie.
L'évolution de l'élite des
notables a été telle depuis le xvm'
siècle, et le développement des
communautés marchandes qui s'y sont
peu à peu intégrées si important, que le
champ social s'est largement renouvelé
au sommet, bien avant l'émergence de
la bourgeoisie industrielle qui s'en
détachera dans les années 1910-1920.
De plus, cette évolution a été si
profonde qu'elle s'est étendue au
domaine des activités publiques.
C'est
précisément ce développement
antérieur de leurs responsabilités
locales qui a empêché les notables de
se prêter à un rééquilibrage des
pouvoirs au profit du gouvernement
central et de sa bureaucratie, fussent
ils modernisés.
Exercice de fonctions
déléguées localement pour la gestion.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'ART NOUVEAU de 1900 à 1909 : Histoire
- La Mode de 1900 à 1909 : Histoire
- LES CAPITALES DE L'Opérette de 1900 à 1909 : Histoire
- LE PARIS THÉÂTRAL de 1900 à 1909 : Histoire
- Russie de 1900 à 1909 : Histoire