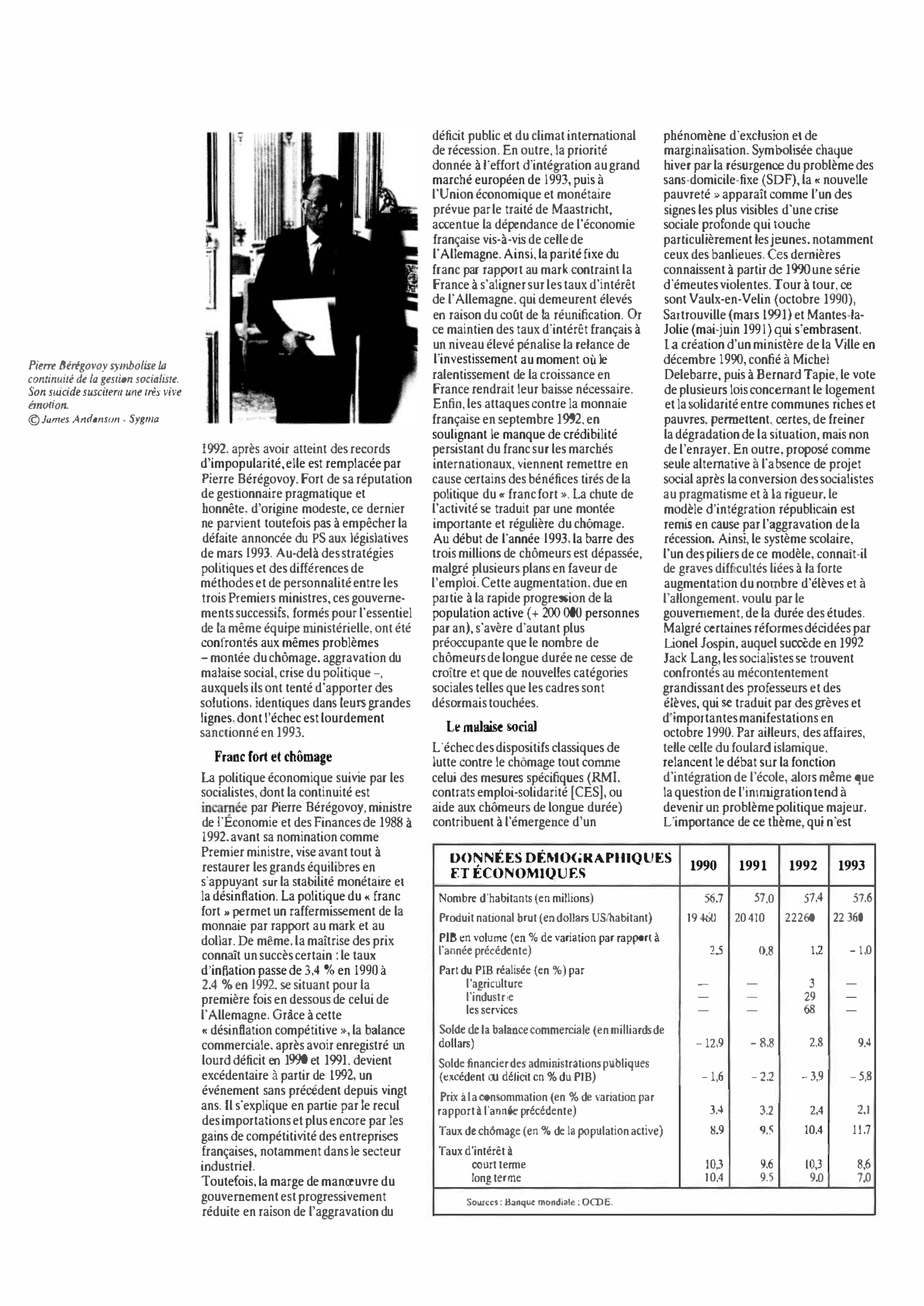FRANCE de 1990 à 1994 : Histoire
Publié le 16/01/2019

Extrait du document

■ Superficie : 547 026 km1
■ Capitale : Paris
FRANCE
Le discrédit croissant, auprès de l'opinion, du Parti socialiste, qui ne dispose que d’une faible majorité au Parlement, ainsi que le renversement de la conjoncture économique marquée par une récession de plus en plus grave obligent le président François
Mitterrand à changer trois fois de Premier ministre en deux ans.
Chef du gouvernement depuis 1988, Michel Rocard, partisan des « révolutions minuscules » qui doivent réformer la société française en profondeur et progressivement, échoue
dans sa tentative d’ouverture vers le centre, alors même que sa politique est contestée sur sa gauche. Afin de
« donner un nouvel élan », Édith Cresson lui succède le 15 mai 1991, devenant la première femme à occuper ce poste. Onze mois plus tard, le 3 avril 1992, après avoir atteint des records d'impopularité, elle est remplacée par Pierre Bérégovoy. Fort de sa réputation de gestionnaire pragmatique et honnête, d’origine modeste, ce dernier ne parvient toutefois pas à empêcher la défaite annoncée du PS aux législatives de mars 1993. Au-delà des stratégies politiques et des différences de méthodes et de personnalité entre les trois Premiers ministres, ces gouvernements successifs, formés pour l'essentiel de la même équipe ministérielle, ont été confrontés aux mêmes problèmes - montée du chômage, aggravation du malaise social, crise du politique -, auxquels ils ont tenté d'apporter des solutions, identiques dans leurs grandes lignes, dont l'échec est lourdement sanctionné en 1993.
Franc fort et chômage
La politique économique suivie par les socialistes, dont la continuité est incarnée par Pierre Bérégovoy, ministre de l'Économie et des Finances de 1988 à 1992, avant sa nomination comme Premier ministre, vise avant tout à restaurer les grands équilibres en s'appuyant sur la stabilité monétaire et la désinflation. La politique du « franc fort » permet un raffermissement de la monnaie par rapport au mark et au dollar. De même, la maîtrise des prix connaît un succès certain : le taux d'inflation passe de 3,4 % en 1990 à 2,4 % en 1992, se situant pour la première fois en dessous de celui de l'Allemagne. Grâce à cette « désinflation compétitive ». la balance commerciale, après avoir enregistré un lourd déficit en 1990 et 1991. devient excédentaire à partir de 1992, un événement sans précédent depuis vingt ans. Il s'explique en partie par le recul des importations et plus encore par les gains de compétitivité des entreprises françaises, notamment dans le secteur industriel.
Toutefois, la marge de manœuvre du gouvernement est progressivement réduite en raison de l'aggravation du
déficit public et du climat international de récession. En outre, la priorité donnée à l'effort d'intégration au grand marché européen de 1993, puis à l’Union économique et monétaire prévue par le traité de Maastricht, accentue la dépendance de l'économie française vis-à-vis de celle de l'Allemagne. Ainsi, la parité fixe du franc par rapport au mark contraint la France à s'aligner sur les taux d'intérêt de l’Allemagne, qui demeurent élevés en raison du coût de la réunification. Or ce maintien des taux d'intérêt français à un niveau élevé pénalise la relance de l'investissement au moment où le ralentissement de la croissance en France rendrait leur baisse nécessaire. Enfin, les attaques contre la monnaie française en septembre 1992, en soulignant le manque de crédibilité persistant du franc sur les marchés internationaux, viennent remettre en cause certains des bénéfices tirés de la politique du « franc fort ». La chute de l’activité se traduit par une montée importante et régulière du chômage. Au début de l'année 1993, la barre des trois millions de chômeurs est dépassée, malgré plusieurs plans en faveur de l'emploi. Cette augmentation, due en partie à la rapide progression de la population active (+ 200 000 personnes par an), s’avère d'autant plus préoccupante que le nombre de chômeurs de longue durée ne cesse de croître et que de nouvelles catégories sociales telles que les cadres sont désormais touchées.
Le malaise social
L'échec des dispositifs classiques de lutte contre le chômage tout comme celui des mesures spécifiques (RMI, contrats emploi-solidarité [CES], ou aide aux chômeurs de longue durée) contribuent à l'émergence d’un

«
Pierre
Bértgovoy symbolise la
continuité de la gestion socialiste.
Son su ic id e suscitera une très vive
émotion.
©James Andanson • Sygma
1992, après avoir atteint des records
d'impopularité, elle est remplacée par
Pierre Bérégovoy.
Fort de sa réputation
de gestionnaire pragmatique et
honnête, d'origine modeste, ce dernier
ne parvient toutefois pas à empêcher la
défaite annoncée du PS aux législatives
de mars 1993.
Au-delà des stratégies
politiques et des différences de
méthodes et de personnalité entre les
trois Premiers ministres, ces gouverne·
ments successifs.
formés pour l'essentiel
de la même équipe ministérielle, ont été
confrontés aux mêmes problèmes
- montée du chômage, aggravation du
malaise social, crise du politique -,
auxquels ils ont tenté d'apporter des
solutions.
identiques dans leurs grandes
lignes, dont l'échec est lourdement
sanctionné en 1993.
Franc fort et chômage
La politique économique suivie par les
socialistes, dont la continuité est
in car,
née par Pierre Bérégovoy, ministre
de l'Economie et des Finances de 1988 à
1992.
avant sa nomination comme
Premier ministre, vise avant tout à
restaurer les grands équilibres en
s'appuyant sur la stabilité monétaire et
la désinflation.
La politique du« franc
fort »permet un raffermissement de la
monnaie par rapport au mark et au
dollar.
De même.
la maîtrise des prix
connaît un succès certain :le taux
d'inflation passe de 3,4 % en 1990 à
2,4 % en 1992, se situant pour la
première fois en dessous de celui de
l'Allemagne.
Grâce à cette
« désinflation compétitive», la balance
commerciale.
après avoir enregistré un
lourd déficit en 1990 et 1991.
devient
excédentaire à partir de 1992, un
événement sans précédent depuis vingt
ans.
Il s'explique en partie par le recul
des importations el plus encore par les
gains de compétitivité des entreprises
françaises, notamment dans le secteur
industriel.
Toutefois.
la marge de manœuvre du
gouvernement est progressivement
réduite en raison de l'aggravation du déficit
public et du climat international
de récession.
En outre, la priorité
donnée à l'effort d'intégration au grand
marché européen de 1993, puis à
l'Union économique et monétaire
prévue par le traité de Maastricht,
accentue la dépendance de l'économie
française vis-à-vis de celle de
l'Allemagne.
Ainsi, la parité fixe du
franc par rapport au mark contraint la
France à s'aligner sur les taux d'intérêt
de l'Allemagne.
qui demeurent élevés
en raison du coOt de la réunification.
Or
ce maintien des taux d'intérêt français à
un niveau élevé pénalise la relance de
l'investissement au moment où le
ralentissement de la croissance en
France rendrait leur baisse nécessaire.
Enfin, les attaques contre la monnaie
française en septembre 1992, en
soulignant Je manque de crédibilité
persistant du franc sur les marchés
internationaux, viennent remettre en
cause certains des bénéfices tirés de la
politique du« franc fort».
La chute de
l'activité se traduit par une montée
importante et régulière du chômage.
Au début de l'année 1993, la barre des
trois millions de chômeurs est dépassée,
malgré plusieurs plans en faveur de
l'emploi.
Cette augmentation.
due en
partie à la rapide progression de la
population active ( + 200 000 personnes
par an), s'avère d'autant plus
préoccupante que le nombre de
chômeurs de longue durée ne cesse de
croître et que de nouvelles catégories
sociales telles que les cadres sont
désormais touchées.
Le malaise social
L'échec des dispositifs classiques de
lutte contre le chômage tout comme
celui des mesures spécifiques (RMI.
contrats emploi-solidarité [CES], ou
aide aux chômeurs de longue durée)
contribuent à l'émergence d'un phénomène
d'exclusion et de
marginalisation.
Symbolisée chaque
hiver par la résurgence du problème des
sans-domicile-fixe (SDF), la« nouvelle
pauvreté »apparaît comme l'un des
signes les plus visibles d'une crise
sociale profonde qui touche
particulièrement les jeunes, notamment
ceux des banlieues.
Ces dernières
connaissent à partir de 1990 une série
d'émeutes violentes.
Tour à tour, ce
sont Vaulx-en-Velin (octobre 1990),
Sartrouville (mars 1991 ) et Mantes-la·
Jolie (mai-juin 1991) qui s'embrasent.
La création d'un ministère de la Ville en
décembre 1990, confié à Michel
Delebarre, puis à Bernard Tapie, le vote
de plusieurs lois concernant le logement
et la solidarité entre communes riches et
pauvres, permettent.
certes, de freiner
la dégradation de la situation, mais non
de l'enrayer.
En outre, proposé comme
seule alternative à l'absence de projet
social après la conversion des socialistes
au pragmatisme et à la rigueur, le
modèle d'intégration républicain est
remis en cause par l'aggravation de la
récession.
Ainsi, le système scolaire,
l'un des piliers de ce modèle, connaît-il
de graves difficultés liées à la forte
augmentation du nombre d'élèves et à
l'allongement, voulu par le
gouvernement, de la durée des études.
Malgré certaines réformes décidées par
Lionel Jospin, auquel succède en 1992
Jack Lang, les socialistes se trouvent
confrontés au mécontentement
grandissant des professeurs et des
élèves, qui sc traduit par des grèves et
d'importantes manifestations en
octobre 1990.
Par ailleurs, des affaires,
telle celle du foulard islamique,
relancent le débat sur la fonction
d'intégration de l'école, alors même que
la question de l'in1migration tend à
devenir Wl problème politique majeur.
L'importance de ce thème, qui n'est
DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
ET ÉCONOMIQUES 1990
1991 1992 1993
Nombre d'habitants (en millions)
56.7 5
7.0 57,4
57.6
Produit national brut (en do ll ars US/habitant) 19460
20410
22260
22360
PIS en volume (en% de variation par rapport à
l'année précédente) 2,5
0.8 1,2
-1.0
Part du PIS réalisée (en%) par
l'agriculture -
-
3 -
l'industrie -
-
29 -
les services -
-
68 -
Solde de la balance commerciale (en milliards de
dollars) -12.9 -8.8 2,8
9.4
Solde financier des administrations publiques
(excédent ou déficit en% du P1S) -1,6
-2.2
-3,9 -5,8
Prix à la consommation (en % de variation par
rapport à l'année précédente) 3.4
3.2 2,4
2,1
Taux de chômage (en% de la population activ e) 8,9
9,5 10,4
11,7
Taux d'intérêt à
court terme 10,3
9,6 10,3
8,6
long terme 1
0 ,4
9.5 9,0
7,0
Souroes: Banque mondiale: OCDE..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le rock de 1990 à 1994 : Histoire
- LE Jazz, DES ADIEUX À LA RELÈVE de 1990 à 1994 : Histoire
- NOUVELLE Danse ET DÉCADENCE de 1990 à 1994 : Histoire
- LE MARCHÉ DE l’ART de 1990 à 1994 : Histoire
- Jordanie de 1990 à 1994 : Histoire