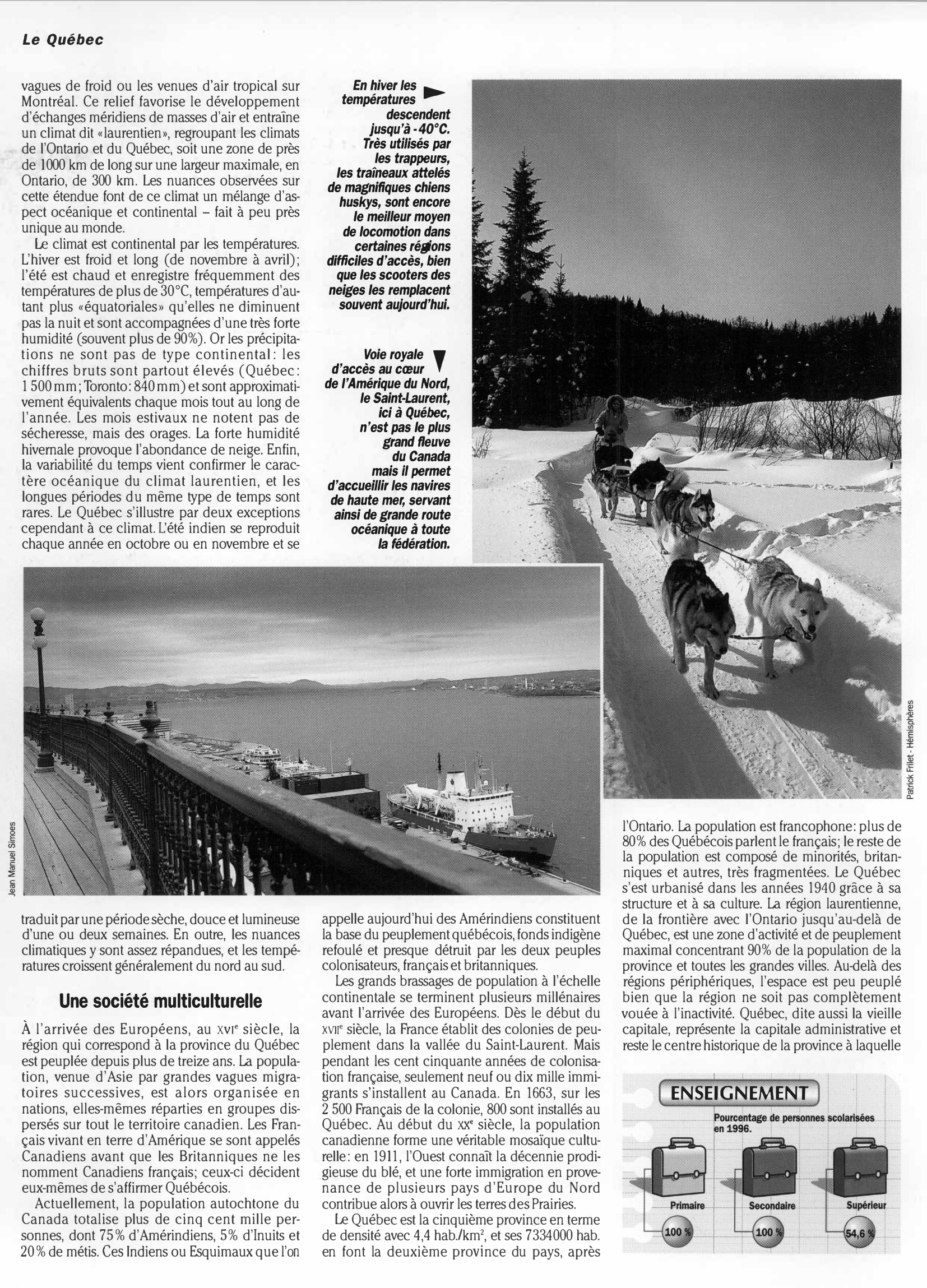Géographie LE QUEBEC
Publié le 08/02/2019

Extrait du document
«
Le
Québec
vagues de froid ou les venues d'air tropical sur
Montréal.
Ce relief favorise le développement
d'échanges méridiens de masses d'air et entraîne
un climat dit «laurentien», regroupant les climats
de l'Ontario et du Québec, soit une zone de près
de 1000 km de long sur une largeur maximale, en
Ontario, de 300 km.
Les nuances observées sur
cette étendue font de ce climat un mélange d'as
pect océanique et continental -fait à peu près
unique au monde.
Le climat est continental par les températures.
L' hiver est froid et long (de novembre à avril);
l'été est chaud et enregistre fréquemment des
températures de plus de 30°C, températures d'au
tant plus «équatoriales>> qu'elles ne diminuent
pas la nuit et sont accompagnées d'une très forte
humidité (souvent plus de 90%).
Or les précipita
tions ne sont pas de type continental: les
chiffres bruts sont partout élevés (Québec:
1 500 mm; Toronto: 840 mm) et sont approximati
vement équivalents chaque mois tout au long de
l'année.
Les mois estivaux ne notent pas de
sécheresse, mais des orages.
La forte humidité
hivernale provoque l'abondance de neige.
Enfin,
la variabilité du temps vient confirmer le carac
tère océanique du climat laurentien, et les
longues périodes du même type de temps sont
rares.
Le Québec s'illustre par deux exceptions
cependant à ce climat.
L'été indien se reproduit
chaque année en octobre ou en novembre et se
traduit par une période sèche, douce et lumineuse
d'une ou deux semaines.
En outre, les nuances
climatiques y sont assez répandues, et les tempé
ratures croissent généralement du nord au sud.
Une société multiculturelle
À l'arrivée des Européens, au xv1• siècle, la
région qui correspond à la province du Québec
est peuplée depuis plus de treize ans.
La popula
tion, venue d'Asie par grandes vagues migra
toires successives, est alors organisée en
nations, elles-mêmes réparties en groupes dis
persés sur tout le territoire canadien.
Les Fran
çais vivant en terre d'Amérique se sont appelés
Canadiens avant que les Britanniques ne les
nomment Canadiens français; ceux-d décident
eux-mêmes de s'affirmer Québécois.
Actuellement, la population autochtone du
Canada totalise plus de cinq cent mille per
sonnes, dont 75% d'Amérindiens, 5% d'lnuits et
20% de métis.
Ces Indiens ou Esquimaux que l'on En
hiver/es ..,..
températures
descendent
jusqu'à -40°C.
Très utilisés par
les trappeuiS,
tes traîneaux attelés
de magnifiques chiens
huskys, sont encore
le meilleur moyen
de locomotion dans
certaines régions
difficiles d'accès, bien
que les scooteiS des
neiges tes remplacent
souvent aujourd'hui.
Voie royale '
d'accès au cœur
de l'Amérique du Nord,
le Saint-Laurent,
ici à Québec,
n'est pas te plus
grand fleuve
du Canada
mais il permet
d'accue illir/es navires
de haute mer, servant
ainsi de grande route
océanique à toute
ta fédération.
appelle aujourd'hui des Amérindiens constituent
la base du peuplement québécois, fonds indigène
refoulé et presque détruit par les deux peuples
colonisateurs, français et britanniques.
Les grands brassages de population à l'échelle
continentale se terminent plusieurs millénaires
avant l'arrivée des Européens.
Dès le début du
XVJI• siècle, la France établit des colonies de peu
plement dans la vallée du Saint-Laurent.
Mais
pendant les cent cinquante années de colonisa
tion française, seulement neuf ou dix mille immi
grants s'installent au Canada.
En 1663, sur les
2 500 Français de la colonie, 800 sont installés au
Québec.
Au début du xx• siècle, la population
canadienne forme une véritable mosaïque cultu
relle: en 1911, l'Ouest connaît la décennie prodi
gieuse du blé, et une forte immigration en prove
nance de plusieurs pays d'Europe du Nord
contribue alors à ouvrir les terres des Prairies.
Le Québec est la cinquième province en terme
de densité avec 4,4 hab ./km2, et ses 7334 000 hab.
en font la deuxième province du pays, après l'Ontario.
La population est francophone: plus de
80% des Québécois parlent le français; le reste de
la population est composé de minorités, britan
niques et autres, très fragmentées.
Le Québec
s'est urbanisé dans les années 1940 grâce à sa
structure et à sa culture.
La région laurentienne,
de la frontière avec l'Ontario jusqu'au-delà de
Québec, est une zone d'activité et de peuplement
maximal concentrant 90% de la population de la
province et toutes les grandes villes.
Au-.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- -Le Théâtre“Le Malade Imaginaire” - Acte I Scène 1
- Cours d'histoire-géographie 2nd
- Travail de Géographie: Une vie pas comme les autres
- Correction DS d'histoire-géographie SUJETS DE TYPE COMPARATIF
- dm géographie: les mondes polaires