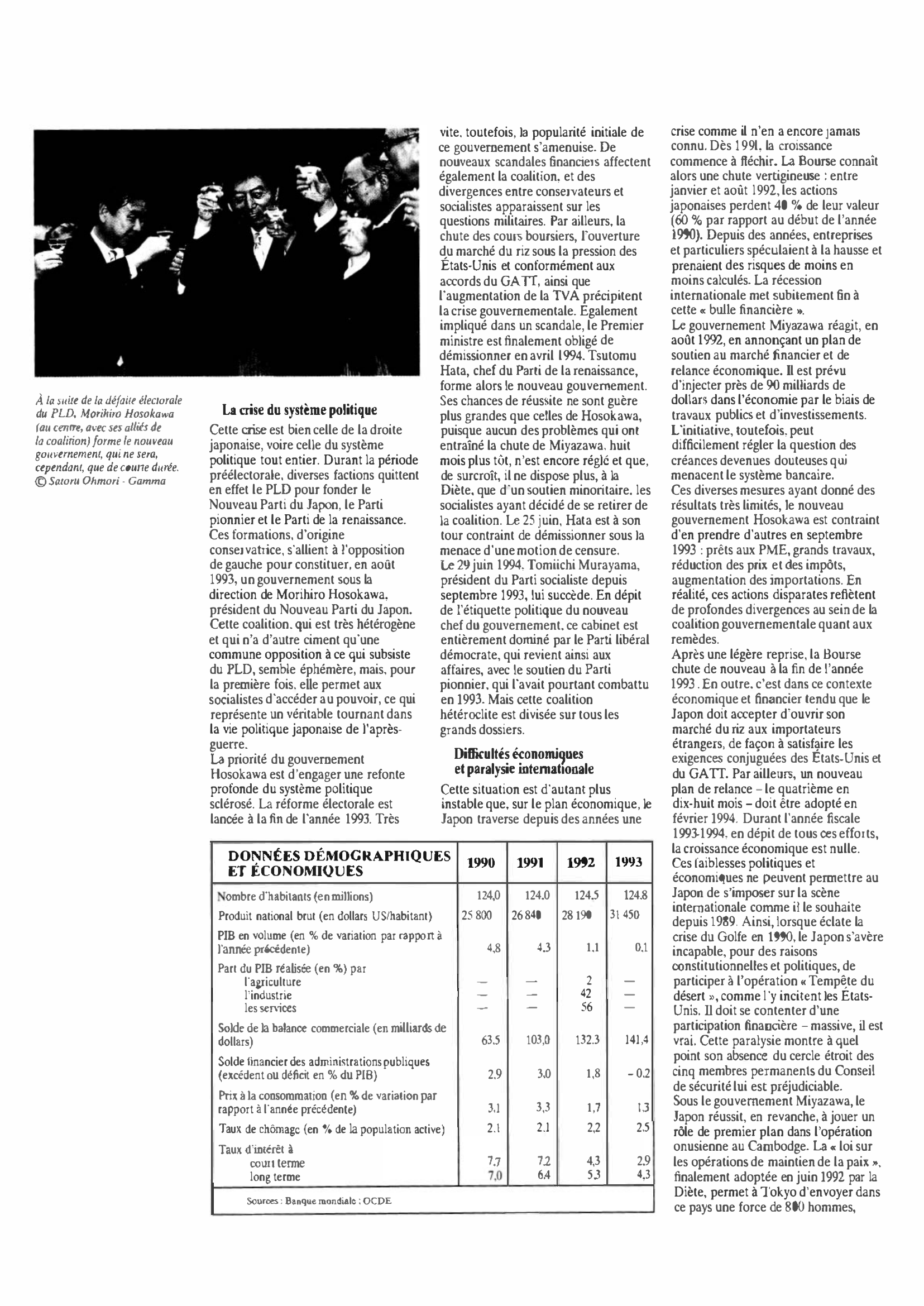Japon de 1990 à 1994 : Histoire
Publié le 16/01/2019

Extrait du document

Le Japon connaît, depuis le début des années quatre-vingt-dix, une série quasi ininterrompue de crises intérieures qui ont complètement bouleversé son système politique. Sans véritable assise parlementaire, le gouvernement conservateur de Toshiki Kaifu apparaissait fragile dès sa formation en août 1989. Les difficultés auxquelles il doit faire face en 1990-1991 l’affaiblissent davantage.
En avril 1991, les élections municipales à la mairie de Tokyo divisent profondément le Parti libéral démocrate (PLD), qui s’entend avec les sociaux-démocrates (PSD) et les bouddhistes (Komeito) pour soutenir la candidature d’un dirigeant de la télévision nationale NHK, Isomura, contre le gouverneur sortant, Suzuki. Or ce dernier, membre du PLD, qui dirige la mairie depuis 1979, l’emporte confortablement (49,9 % des voix, contre 30 % à son adversaire), ce qui provoque la démission du secrétaire général du PLD, Ozawa. Dans le même temps, le Premier ministre Kaifu est mis en minorité à la Diète sur un projet de loi relatif à la participation
éventuelle du Japon à l’opération alliée « Tempête du désert » dans le Golfe. Au cours de l’été 1991 éclate le scandale des maisons de courtage qui, dans les années 1987-1989, avaient accordé des « dédommagements » frauduleux, d’un montant total de 5 milliards de dollars, à leurs plus gros clients pour compenser leurs pertes boursières.
Après la démission des présidents des maisons Nomura et Nikko, puis du président de la banque Fuji, le ministre des Finances, Hashimoto, doit se démettre en octobre 1991 et le gouvernement paraît condamné. Le même mois, le Parlement rejette le projet de réforme électorale présenté par le Premier ministre. La puissante faction de l’ancien Premier ministre Takeshita retire alors son soutien à Toshiki Kaifu, qui renonce à briguer un second mandat à la tête du PLD et donc à diriger le prochain gouvernement. Kiichi Miyazawa forme alors un nouveau cabinet le 5 novembre. Mais les scandales financiers qui se multiplient ont finalement raison non seulement du
gouvernement Miyazawa, mais, plus largement, du système politique japonais.
En février 1992 éclate l’affaire Kyowa, du nom d’une entreprise de charpentes métalliques qui avait versé d'importantes sommes à l’ancien secrétaire général de la faction Miyazawa. Puis survient le scandale Sagawa Kyubin, du nom d’une société de transport de Kyoto qui, en liaison avec la pègre, finançait le PLD. Cette fois, les principales personnalités impliquées sont l’ancien vice-président du PLD. Kanemaru, et l’ancien Premier ministre, Takeshita, deux alliés essentiels du gouvernement Miyazawa. D’autres affaires, des difficultés économiques et boursières croissantes, ainsi que des dissensions internes entraînent inexorablement le déclin du PLD. Les élections législatives du 18 juillet 1993 lui sont fatales : le parti n'obtient que 223 sièges sur 511, perdant ainsi la majorité absolue qu’il détenait traditionnellement à la Diète.
Le Premier ministre Miyazawa démissionne immédiatement.

«
À
la su ile de la défaiœ élecrorale
du PLD, Moriiliro Hosokawa
(au centre, avec ses a//iis de
la coalirion) forme le nouveau
gouvemement, qui ne sera,
cependant, que de courre durée.
© Sa1oru Oilmori- Gamma La
crise du système politique
Cette crise est bien celle de la droite
japonaise, voire celle du système
politique tout entier.
Durant la période
préélectorale, diverses factions quittent
en effet le PLD pour fonder le
Nouveau Parti du Japon, le Parti
pionnier et le Parti de la renaissance.
Ces formations, d'origine
conservatrice, s'allient à l'opposition
de gauche pour constituer, en août
1993, un gouvernement sous la
direction de Morihiro Hosokawa,
président du Nouveau Parti du Japon.
Cette coalition.
qui est très hétérogène
et qui n'a d'autre ciment qu'une
commune opposition à ce qui subsiste
du PLD, semble éphémère, mais.
pour
la première fois.
elle permet aux
socialistes d'accéder au pouvoir, ce qui
représente un véritable tournant dans
la vie politique japonaise de l'après
guerre.
La priorité du gouvernement
Hosokawa est d'engager une refonte
profonde du système politique
sclérosé.
La réforme électorale est
lancée à la fin de l'année 1993.
Très vite,
toutefois, la popularité initiale de
ce gouvernement s'amenuise.
De
nouveaux scandales financiers affectent
également la coalition, et des
divergences entre conservateurs et
socialistes apparaissent sur les
questions militaires.
Par ailleurs, la
chute des cours boursiers, l'ouverture
du marché du riz sous la pression des
États-Unis et conformément aux
accords du GA TI, ainsi que
l'augmentation de la TVA précipitent
la crise gouvernementale.
Egalement
impliqué dans un scandale, le Premier
ministre est finalement obligé de
démissionner en avril l994.
Tsutomu
Hata, chef du Parti de la renaissance,
forme alors le nouveau gouvernement.
Ses chances de réussite ne sont guère
plus grandes que celles de Hosokawa,
puisque aucun des problèmes qui ont
entraîné la chute de Miyazawa.
huit
mois plus tôt, n'est encore réglé et que,
de surcroît, il ne dispose plus, à la
Diète, que d'un soutien minoritaire, les
socialistes ayant décidé de se retirer de
la coalition.
Le 25 juin, Ha ta est à son
tour contraint de démissionner sous la
menace d'une motion de censure.
Le 29 juin 1994, Tomiichi Murayama,
président du Parti socialiste depuis
septembre 1993, lui succède.
En dépit
de l'étiquette politique du nouveau
chef du gouvernement, ce cabinet est
entièrement dominé par le Parti libéral
démocrate, qui revient ainsi aux
affaires, avec le soutien du Parti
pionnier, qui l'avait pourtant combattu
en 1993.
Mais cette coalition
hétéroclite est divisée sur tous les
grands dossiers.
Difficultés économiques
et paralysie internationale
Cette situation est d'autant plus
instable que, sur le plan économique, le
Japon traverse depuis des années une
DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
ET ÉCONOMIQUES 1990
1991 1992 1993
ombre d'habitants (en millions) 124,0
124.0 124.5
124.8
Produit national brut (en dollars US/habitant) 25
800 26840
28190 31450
PIB en volume (en% de variation par rappo rt à
l'année précédente) 4.8
4.3 1,1
0,1
Part du PIB ré ali sée (en%) par
l'agriculture -
-
2 -
l'industrie -
-
42 -
les services -
-
56 -
Solde de la balance commerciale (en milliards de
dollars) 63.5
103,0
132.3
141.4
Solde financier des administrations publiques
(excédent ou défi c it en% du PIB) 2,9
3,0 1,8
-0,2
Prix à la consommation (e n % de variation par
rapport à l'année précéden te) 3,1 3,3
1,
7
1,3
Taux de chômage (en% de la population active) 2,1
2,1
2,2
2,5
Taux d'intérêt à
court terme 7,7
7).
4,3
2,9
long terme 7,0
6,4
5,3 4,3
Source.
: Bonque mondiale ; OCDE crise
comme il n'en a encore Jamats
connu.
Dès 199l, la croissance
commence à fléchir.
La Bourse connaît
alors une chute vertigineuse :entre
janvier et août l992, les actions
japonaises perdent 40 % de leur valeur
(60 % par rapport au début de l'année
1990).
Depuis des années, entreprises
et particuliers spéculaient à la hausse et
prenaient des risques de moins en
moins calculés.
La récession
internationale met subitement fin à
cette « bulle financière "·
Le gouvernement Miyazawa réagit, en
aoOt 1992, en annonçant un plan de
soutien au marché financier et de
relance économique.
Il est prévu
d'injecter près de 90 milliards de
dollars dans l'économie par le biais de
travaux publics et d'investissements.
L'initiative, toutefois, peut
difficilement régler la question des
créances devenues douteuses qui
menacent le système bancaire.
Ces diverses mesures ayant donné des
résultats très limités, Je nouveau
gouvernement Hosokawa est contraint
d'en prendre d'autres en septembre
1993 : prêts aux PME, grands travaux,
réduction des prix et des impôts,
augmentation des importations.
En
réalité, ces actions disparates reflètent
de profondes divergences au sein de la
coalition gouvernementale quant aux
remèdes.
Après une légère reprise, la Bourse
chute de nouveau à la fin de l'année
1993.
En outre, c'est dans ce contexte
économique et financier tendu que le
Japon doit accepter d'ouvrir son
marché du riz aux importateurs
étrangers, de façon à satisfaire les
exigences conjuguées des États-Unis et
du GA TT.
Par ailleurs, un nouveau
plan de relance -le quatrième en
dix-huit mois-doit être adopté en
février 1994.
Durant l'année fiscale
1993-1994, en dépit de tous ces efforts,
la croissance économique est nulle.
Ces faiblesses politiques et
économiques ne peuvent permettre au
Japon de s'imposer sur la scène
internationale comme ille souhaite
depuis 1989.
Ainsi, lorsque éclate la
crise du Golfe en 1990, le Japon s'avère
incapable, pour des raisons
constitutionnelles et politiques, de
participer à l'opération « Temp�te du
désert », comme 1 'y incitent les Etats
Unis.
Il doit se contenter d'une
participation financière-massive, il est
vrai.
Cette paralysie montre à quel
point son absence du cercle étroit des
cinq membres permanents du Conseil
de sécurité lui est préjudiciable.
Sous le gouvernement Miyazawa, le
Japon réussit, en revanche, à jouer un
rôle de premier plan dans l'opération
onusienne au Cambodge.
La " loi sur
les opérations de maintien de la paix "•
finalement adoptée en juin 1992 par la
Diète, permet à 1'okyo d'envoyer dans
ce pays une force de 800 hommes,.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le rock de 1990 à 1994 : Histoire
- LE Jazz, DES ADIEUX À LA RELÈVE de 1990 à 1994 : Histoire
- NOUVELLE Danse ET DÉCADENCE de 1990 à 1994 : Histoire
- LE MARCHÉ DE l’ART de 1990 à 1994 : Histoire
- Jordanie de 1990 à 1994 : Histoire