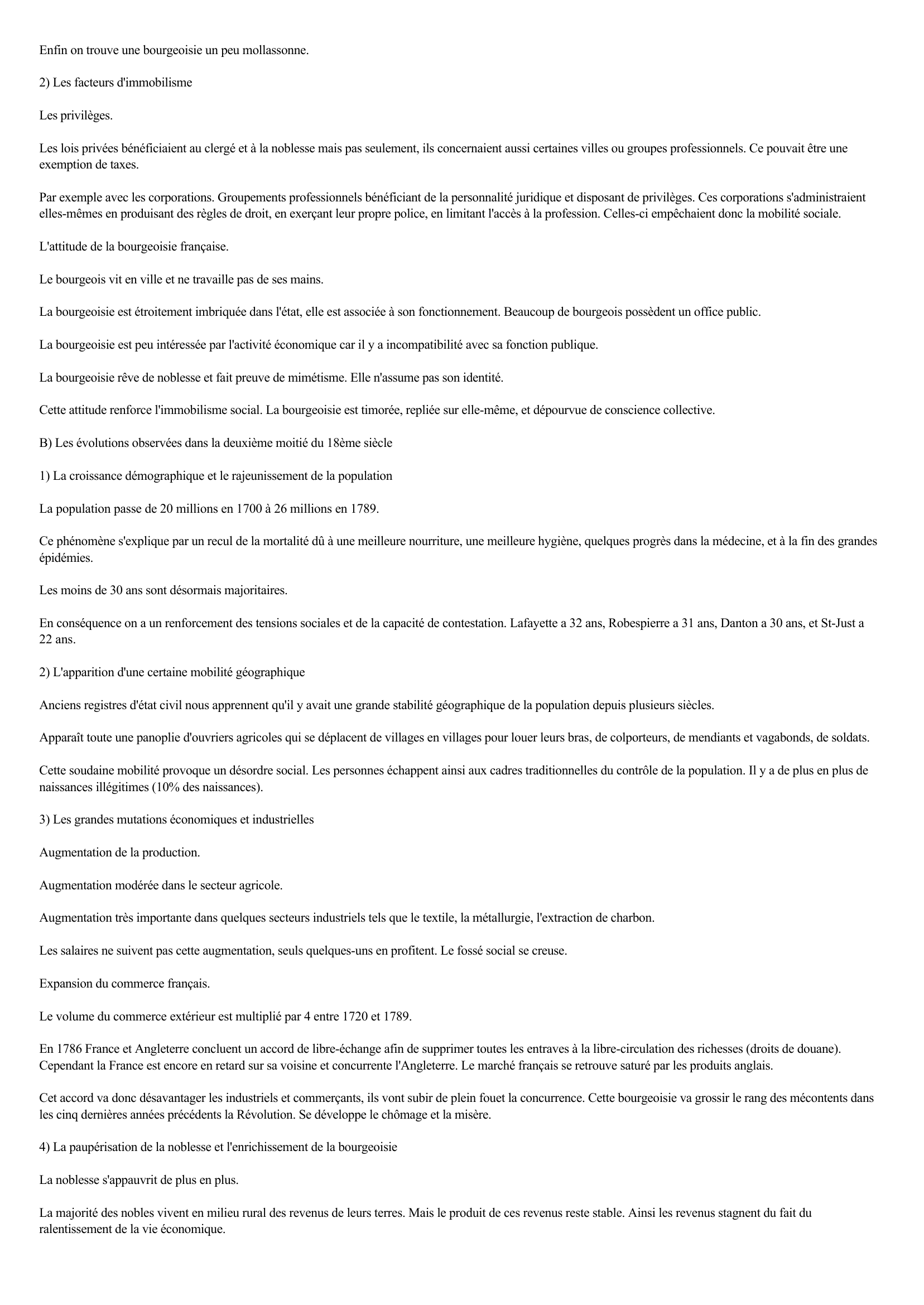La crise de l'Ancien régime
Publié le 16/08/2012

Extrait du document
Le système des charges anoblissantes va se refermer. Par exemple les parlements ne vont plus admettre au sein d'eux des personnes qui sont déjà nobles. De même pression sur le roi pour qu'il soit plus avare en matière d'anoblissement. La noblesse va aller plus loin en réclamant et obtenant un monopole d'accès à certaines fonctions, notamment les postes de commandement dans l'armée et les fonctions gouvernementales. L'édit de Ségur (1781) réserve l'accès aux écoles d'officiers de l'armée aux jeunes rapportant la preuve de quatre générations de noblesse. A part Necker tous les ministres du roi de la dernière décennie sont nobles. Cette réaction provoque la colère et l'exaspération de la bourgeoisie. Elle perd tout espoir de promotion sociale. Alors que la bourgeoisie rayonne par sa richesse, sa culture, et ses capacités administratives, elle est la principale victime des règles d'organisation sociale. Ils n'ont donc rien à perdre à un changement de régime. La révolution sera conduite essentiellement par les membres de cette bourgeoisie. Réaction dans le domaine des droits féodaux et des prérogatives seigneuriales (= la réaction féodale). Dans la mesure où la noblesse s'est fortement appauvrie elle va commencer, à partir des années 1770, à se montrer plus exigeante dans le payement de ses droits féodaux vis-à-vis de la population des campagnes. Ce mouvement entraîne un vif mécontentement du monde paysan, il vit comme une véritable vexation le fait qu'on lui demande de payer des droits qui datent du moyen-âge.
«
Enfin on trouve une bourgeoisie un peu mollassonne.
2) Les facteurs d'immobilisme
Les privilèges.
Les lois privées bénéficiaient au clergé et à la noblesse mais pas seulement, ils concernaient aussi certaines villes ou groupes professionnels.
Ce pouvait être uneexemption de taxes.
Par exemple avec les corporations.
Groupements professionnels bénéficiant de la personnalité juridique et disposant de privilèges.
Ces corporations s'administraientelles-mêmes en produisant des règles de droit, en exerçant leur propre police, en limitant l'accès à la profession.
Celles-ci empêchaient donc la mobilité sociale.
L'attitude de la bourgeoisie française.
Le bourgeois vit en ville et ne travaille pas de ses mains.
La bourgeoisie est étroitement imbriquée dans l'état, elle est associée à son fonctionnement.
Beaucoup de bourgeois possèdent un office public.
La bourgeoisie est peu intéressée par l'activité économique car il y a incompatibilité avec sa fonction publique.
La bourgeoisie rêve de noblesse et fait preuve de mimétisme.
Elle n'assume pas son identité.
Cette attitude renforce l'immobilisme social.
La bourgeoisie est timorée, repliée sur elle-même, et dépourvue de conscience collective.
B) Les évolutions observées dans la deuxième moitié du 18ème siècle
1) La croissance démographique et le rajeunissement de la population
La population passe de 20 millions en 1700 à 26 millions en 1789.
Ce phénomène s'explique par un recul de la mortalité dû à une meilleure nourriture, une meilleure hygiène, quelques progrès dans la médecine, et à la fin des grandesépidémies.
Les moins de 30 ans sont désormais majoritaires.
En conséquence on a un renforcement des tensions sociales et de la capacité de contestation.
Lafayette a 32 ans, Robespierre a 31 ans, Danton a 30 ans, et St-Just a22 ans.
2) L'apparition d'une certaine mobilité géographique
Anciens registres d'état civil nous apprennent qu'il y avait une grande stabilité géographique de la population depuis plusieurs siècles.
Apparaît toute une panoplie d'ouvriers agricoles qui se déplacent de villages en villages pour louer leurs bras, de colporteurs, de mendiants et vagabonds, de soldats.
Cette soudaine mobilité provoque un désordre social.
Les personnes échappent ainsi aux cadres traditionnelles du contrôle de la population.
Il y a de plus en plus denaissances illégitimes (10% des naissances).
3) Les grandes mutations économiques et industrielles
Augmentation de la production.
Augmentation modérée dans le secteur agricole.
Augmentation très importante dans quelques secteurs industriels tels que le textile, la métallurgie, l'extraction de charbon.
Les salaires ne suivent pas cette augmentation, seuls quelques-uns en profitent.
Le fossé social se creuse.
Expansion du commerce français.
Le volume du commerce extérieur est multiplié par 4 entre 1720 et 1789.
En 1786 France et Angleterre concluent un accord de libre-échange afin de supprimer toutes les entraves à la libre-circulation des richesses (droits de douane).Cependant la France est encore en retard sur sa voisine et concurrente l'Angleterre.
Le marché français se retrouve saturé par les produits anglais.
Cet accord va donc désavantager les industriels et commerçants, ils vont subir de plein fouet la concurrence.
Cette bourgeoisie va grossir le rang des mécontents dansles cinq dernières années précédents la Révolution.
Se développe le chômage et la misère.
4) La paupérisation de la noblesse et l'enrichissement de la bourgeoisie
La noblesse s'appauvrit de plus en plus.
La majorité des nobles vivent en milieu rural des revenus de leurs terres.
Mais le produit de ces revenus reste stable.
Ainsi les revenus stagnent du fait duralentissement de la vie économique..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Être chrétien en France sous l’ancien régime
- ANCIEN RÉGIME ET LA Révolution (L’) - Alexis de Tocqueville (résumé et analyse)
- ANCIEN RÉGIME ET LA RÉVOLUTION (L’), Tocqueville
- Taille Impôt de l'Ancien Régime.
- I nstaurée en 1958 en pleine crise algérienne, la Ve République a mis fin à l'instabilité politique du régime précédent.