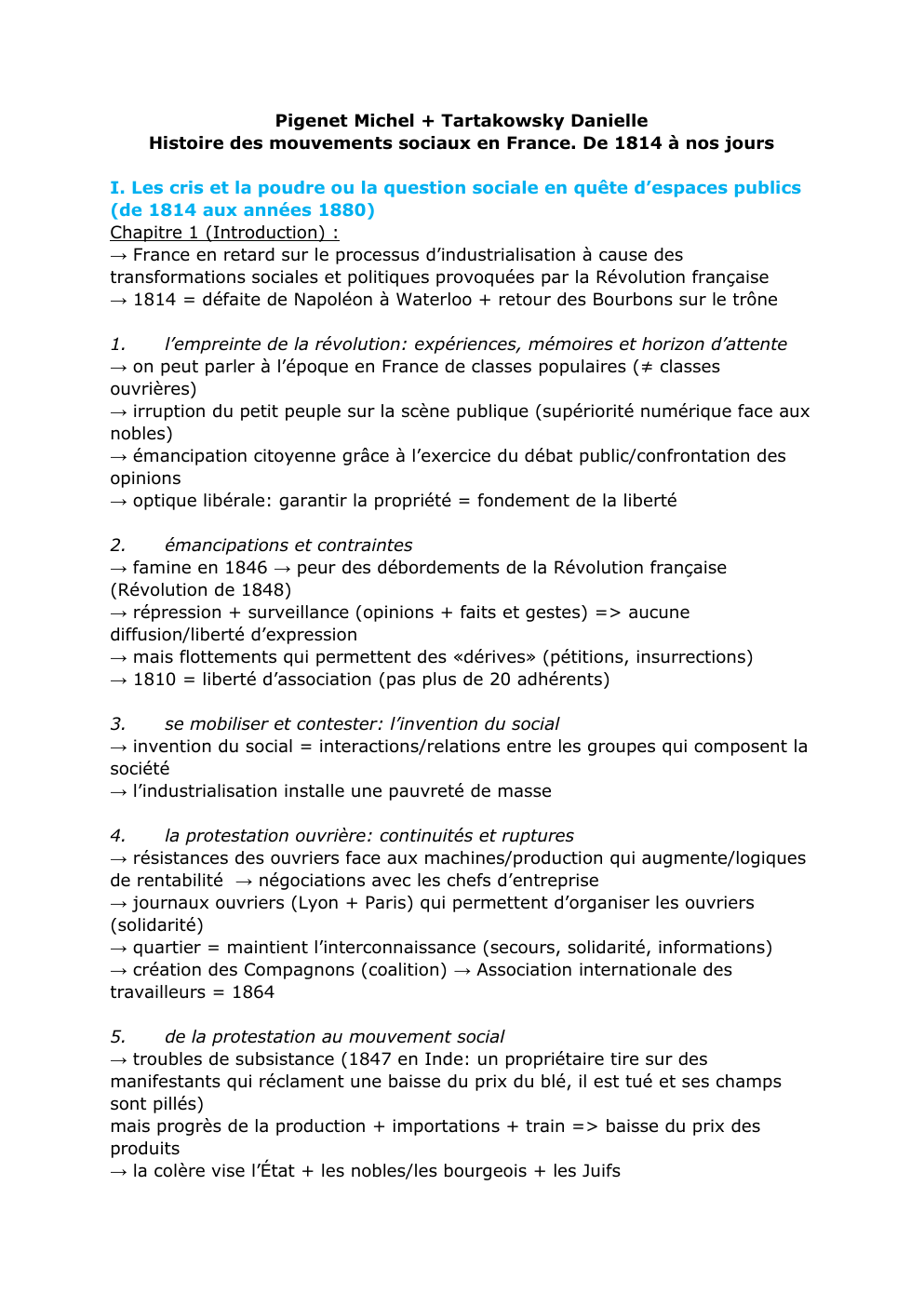Pigenet Michel + Tartakowsky Danielle Histoire des mouvements sociaux en France. De 1814 à nos jours
Publié le 22/09/2022

Extrait du document
«
Pigenet Michel + Tartakowsky Danielle
Histoire des mouvements sociaux en France.
De 1814 à nos jours
I.
Les cris et la poudre ou la question sociale en quête d’espaces publics
(de 1814 aux années 1880)
Chapitre 1 (Introduction) :
→ France en retard sur le processus d’industrialisation à cause des
transformations sociales et politiques provoquées par la Révolution française
→ 1814 = défaite de Napoléon à Waterloo + retour des Bourbons sur le trône
1.
l’empreinte de la révolution: expériences, mémoires et horizon d’attente
→ on peut parler à l’époque en France de classes populaires (≠ classes
ouvrières)
→ irruption du petit peuple sur la scène publique (supériorité numérique face aux
nobles)
→ émancipation citoyenne grâce à l’exercice du débat public/confrontation des
opinions
→ optique libérale: garantir la propriété = fondement de la liberté
2.
émancipations et contraintes
→ famine en 1846 → peur des débordements de la Révolution française
(Révolution de 1848)
→ répression + surveillance (opinions + faits et gestes) => aucune
diffusion/liberté d’expression
→ mais flottements qui permettent des «dérives» (pétitions, insurrections)
→ 1810 = liberté d’association (pas plus de 20 adhérents)
3.
se mobiliser et contester: l’invention du social
→ invention du social = interactions/relations entre les groupes qui composent la
société
→ l’industrialisation installe une pauvreté de masse
4.
la protestation ouvrière: continuités et ruptures
→ résistances des ouvriers face aux machines/production qui augmente/logiques
de rentabilité → négociations avec les chefs d’entreprise
→ journaux ouvriers (Lyon + Paris) qui permettent d’organiser les ouvriers
(solidarité)
→ quartier = maintient l’interconnaissance (secours, solidarité, informations)
→ création des Compagnons (coalition) → Association internationale des
travailleurs = 1864
5.
de la protestation au mouvement social
→ troubles de subsistance (1847 en Inde: un propriétaire tire sur des
manifestants qui réclament une baisse du prix du blé, il est tué et ses champs
sont pillés)
mais progrès de la production + importations + train => baisse du prix des
produits
→ la colère vise l’État + les nobles/les bourgeois + les Juifs
→ importance de la rue (barricades + circulation + connaissance du lieu par les
habitants)
→ émergence de la presse qui politise les foules
6.
reconnaissance d’une politique populaire ou l’imbrication du social et du
politique
→ demande d’une République démocratique et sociale en juin 1848
→ Raymond Huard = «politique du peuple» (points de vues des citoyens, leurs
attentes)
=> reconnaître une politique et une organisation derrière des manifestations
→ Edward P.
Thompson = «économie morale de la foule» = la foule réclame des choses dont le résultat est immédiat et qui la touche directement (niveau du salaire, embauche, prix des matériaux) → procédure électorale (suffrage universel) = expression de ≠ opinions par un acte individuel 7. dynamique des contestations → prendre en compte les vaincus + ne pas voir des logiques de continuités/ruptures partout → enchevêtrement d’évènements (comprendre leurs influences + leurs conséquences) Chapitre 9: Les barricades des 5 et 6 juin 1832 → 5 juin 1832 = funérailles du général Lamarque + donnent lieu à une insurrection (200 barricades) → dans la soirée + la nuit la Garde nationale et municipale reprennent des barricades → 6 juin au matin = 60 000 hommes (les autorités) vs 1 000 insurgés qui continuent de prendre les barricades jusqu’à 17h => 300 morts (dont 150 insurgés) 1. vingt-quatre heures d’affrontements au cœur de Paris → barricades + bandes armées dans la ville (ameuter des renforts + neutraliser les postes de police) + prendre des armes (boutiques/particuliers) → 5 juin à 18h = un groupe d’insurgés volent des armes dans une boutique + entrent dans la mairie → Paris des barricades = à l’échelle de rue/quartier → dans les arrondissements centraux grâce à la connaissance du lieu (rue étroite, chantier à proximité) espace d’insurrection = protecteur → des pavés/morceaux de bois sont lancés des immeubles sur les policiers → emplacements des barricades + raisons de l’insurrection = mal connues (raisons possibles: roi considéré comme usurpateur + libertés personnelles et politiques absentes + crise économique + épidémie de choléra au printemps 1832 + volonté d’abolir la monarchie) 2. insurgés au combat → insurgés = sûrement des jeunes hommes célibataires + métiers de l’artisanat/vente + ouvriers => condamnés à mort/aux travaux forcés/à la déportation/détention/réclusion/prison → la Société des Amis du peuple participe sans être à l’origine de l’insurrection → implication de la Société Gauloise (Républicains) → échec de l’insurrection + les insurgés décrits comme des barbares anarchistes par le régime → les membres de la Société des droits de l’Homme soulignent l’immaturité politique, l’inorganisation et la précipitation des insurgés de juin 1832 Chapitre 10 : «Vivre en travaillant ou mourir en combattant.» Les révoltes des canuts (1831-1834) → canuts = ouvriers tisserands de soie (pour Marx et Engels = 1ers révolutionnaires prolétariens) → 21 novembre 1831 = les canuts prennent le contrôle de Lyon et gouvernent la ville efficacement → les autorités les arrêtent/certains s’enfuient → avril 1834 = nouveau soulèvement => «sanglante semaine» de combats 9-11 avril = succès des canuts → mais ensuite poches de résistance arrêtées 14 avril = la Croix-Rousse capitule car est menacée de destruction 1. les Canuts étaient-ils des ouvriers ? → Lyon = ville prospère + offre des emplois notamment dans l’industrie de la soie (dispersée dans plusieurs centaines de «maisons» ≠ qui emploient un petit nombre d’employés) => transactions entres les négociants (anticipent la mode + acheminent les tissus + commandent) et les chefs d’atelier (sont à la tête de métiers à tisser: entre 2 et 5) → modèle obsolète dans la logique des manufactures concentrées → canuts = chefs d’atelier + des artisans qui ont un savoir-faire + expertise artistique (culture) 2. novembre 1831, une émeute de la faim ? → insurrection car les canuts cherchent à défendre leur industrie + leur autonomie baisse du prix de leur production (veulent fixer un niveau minimal des prix) → négociations refusées le 17 novembre (charte libérale l’interdit) → dénonciation des rapports asymétriques entre le chef d’atelier et le négociant 3. 1831, 1834, points de départ du mouvement social lyonnais ? → évènement inédit (même si 1res insurrections en 1744 + 1786 à cause des inégalités) → mars 1806 = création de prud’hommes à Lyon (conciliations négociants et chefs d’atelier) → canuts rassemblés derrière Charnier et Bouvery créent le Devoir mutuel (rassembler + organiser les tisserands en sections de 20 → contourne la loi de liberté d’association de 1810) 4. novembre 1831 et avril 1834, ébauches de révolutions ? → les ouvriers ont conscience que les révoltes,n’apportent pas toujours de grands changements et en plus qu’elles tuent d’autres ouvriers donc choisissent de négocier → publicisation des débats/opinions/projets de développement de leur industrie (journaux propres à certains chefs d’atelier) → insistent sur l’émancipation physique, morale, intellectuelle et culturelle de ces travailleurs → réclamation de la «libre-défense» (un canut peut exprimer ses revendications devant le prud’hommes et être assisté par quelqu’un de son choix) + les décisions prises doivent aboutir à l’élaboration d’un vrai «code de la fabrique» 5. les canuts, simples transmetteurs des utopies et autres radicalités du début des années 1830? →canuts = conscience politique + lucidité importantes → les canuts sont influencés par les saint-simoniens (société de producteurs débarrassée des aristocrates/prêtres + propriété = privilège) + les républicains (souveraineté populaire + suffrage universel mais conquête de l’État insuffisante) + les fouriéristes (négociant = parasite de l’industrie + garanties pour les travailleurs Chapitre 11 : La révolution de 1848 → insurrection en février qui est un échec → en juin → les insurgés (classes ouvrières) voulaient mettre en place l’idée de souveraineté populaire → les causes de la révolution: • les crises/problèmes pendant les monarchies constitutionnelles • insurrections de 1831, 1832 et 1834 + la répression importante • difficultés économiques + chômage en ville + famines en campagne → 22 février = insurrection => Louis-Philippe abdique le 24 février → 25 février, le droit au travail est proclamé → 27 février = proclamation officielle d’une République → 2 mars = lois qui répondent aux revendications des ouvriers (journée de travail + 10h) → 4 mars = abolition de l’esclavage 1. la réalisation des promesses de 1789 ? → révolution sociale + conséquences politiques («république démocratique et sociale ») → Alexis de Tocqueville parle de la peur ressentie par les propriétaires avant les élections → les insurgés veulent privilégier le drapeau rouge plutôt que le drapeau tricolore → les ouvrier + les fabricants/artisans expriment leurs opinions/revendications 2. la république démocratique et sociale ou la liberté souveraine → réforme globale de la société → concrétiser la liberté → vivre libre = garder la maîtrise et le contrôle de son propre travail (liberté souveraine) → suffrage universel = forme d’expression de cette souveraineté → rôle important des clubs, des journaux → les femmes demandent des droits (engagement) mais leur voix n’est pas écoutée → création d’associations du travail + projet d’Union des associations solidaires et fraternelles de Jeanne Deroin qui regroupe en juin 1849, plus de cent associations (contre-pouvoir car aucun représentant ouvrier à la Chambre des députés) 3. juin 1848 : la force du droit des insurgés → insurrection = juste protestation contre la violation d’un droit (dissolution des ateliers nationaux) → répression féroce car peur des propriétaires → futur gouvernement préfère écarter les Hommes et la sphère sociale du gouvernement Chapitre 12: La Commune de Paris → la Commune de Paris (1871) a-t-elle été un «mouvement social» ? 1. «une révolution sans précédent dans l’Histoire» → commencement le 18 mars 1871 (aucune réelle mobilisation des troupes du gouvernement mais nombreux insurgés parisiens) → les élections du 26 mars 1870 ont été «boudées» par les parisiens, car seulement 48% ont voté (abstention = dans les beaux quartiers du centre et de l’Ouest + les quartiers populaires: 13e, 14e, 15e) → élections complémentaires du 16 avril = seulement 20% des électeurs se sont déplacés → radicalisation de la population (renforcée par le siège + guerre contre l’Allemagne) → solidarités forgées au sein de la garde nationale (vs l’Assemblée communale) 2. de l’opacité du sens de l’évènement → but de la Commune ? Fonder une République de Paris («Paris ville libre») → volonté d’avoir un conseil municipal élu + des franchises municipales sérieuses + la suppression de la Préfecture de Police + le droit pour la Garde nationale de nommer tous les officiers + que l’armée se retire de Paris + une loi équitable sur les échéances + séparation Église/État + instruction gratuite et obligatoire par des instituteurs laïcs → identité de communauté (voisinage) forgée entre les insurgés → volonté de reconquête du Paris haussmannien (classes populaires expulsées du centre) 3. peut-on parler de mouvement social à propos de la Commune ? → volonté de faire de Paris une République autonome → volonté d’une démocratie directe → évènement imprévu/accidentel Chapitre 17: Après la Commune 1. poids de la répression et action collective → répression importante après les évènements (1875 = 10 000 condamnations prononcées) + morts + exilés/déportés en Nouvelle-Calédonie (perte d’ouvriers) → loi Dufaure (1872) aggrave la répression mais n’empêche pas les grèves → chambres syndicales tentent de s’allier (Cercle de l’Union syndicale ouvrière) mais échec → Chabert = figure du regroupement ouvrier → octobre 1876 = tenue.... »
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- dans quelles mesures les sociétés du 21 e s peuvent-elles voir se développer en France, des nouvelles formes de mouvements sociaux
- HISTOIRE LITTÉRAIRE DU SENTIMENT RELIGIEUX EN FRANCE DEPUIS LA FIN DES GUERRES DE RELIGION JUSQU’A NOS JOURS.
- Le père Elysée, aussi fameux prédicateur, a fait le même panégyrique devant mm des académies des sciences et des inscriptions. Louis Petit de Bachaumont, Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la république des lettres en France depuis 1762 jusqu'à nos jours
- 2000 ANS D'HISTOIRE DE FRANCE Conçu et écrit par Pascal Bonafoux Chefs de Projet Véronique Pierré & Sophie Troff Direction Artistique Michel Prudhomme Auteurs Pascal Bonafoux, Barbara Bonafoux, Loly Clerc, Véronique Petiot, Soko Phay-Vakalis, Véronique Pierré, Michèle Smouliansky, Sophie Troff.
- LA CAMPAGNE DE FRANCE (janvier-mars 1814) - HISTOIRE.