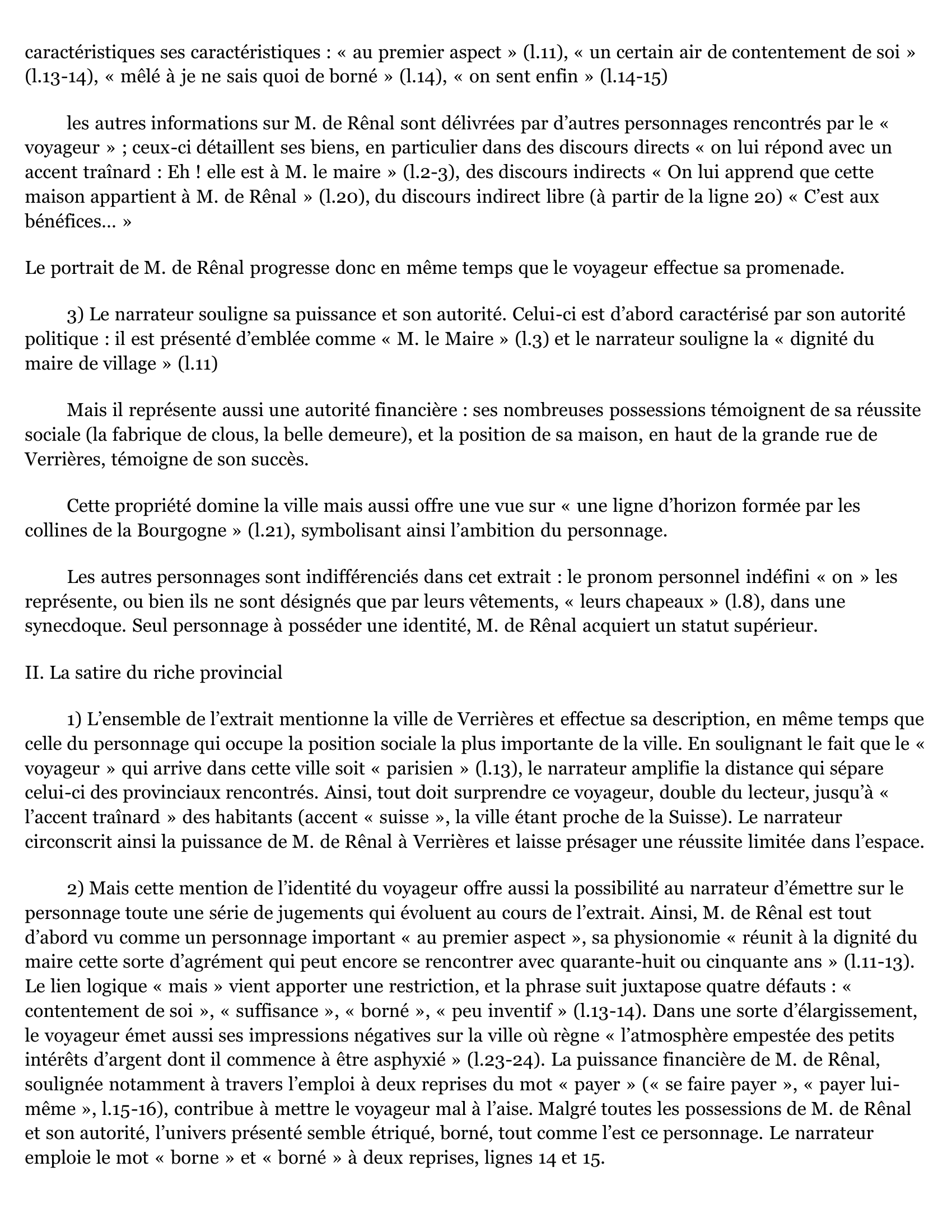Analyse Le Rouge Et Le Noir de Stendhal
Publié le 10/09/2018
Extrait du document
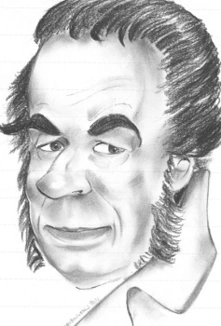
2) Le portrait s’accompagne de jugements de la part de la famille. Les paroles de Joseph et son jugement dévalorisant (« pour le reste, c’est un singe », l.6) amorcent une série d’opinions, qui viennent confirmer la sienne confirmer la sienne comme à la ligne 11 « c’était vrai, la figure n’était pas belle ».[ à compléter] Le personnage est également l’objet d’une fiction élaborée à partir de son costume, de son apparition : « Le chapeau mou sortait d’un film… » (l.8)[à compléter]. La richesse du personnage, visible grâce au costume, à la voiture de luxe [ à établir, détailler] et au diamant, fait fantasmer ceux qui le regardent, et M. Jo, désormais, devient une proie. Son isolement, signalé à deux reprises (l.1 et14) , le rend particulièrement repérable et vulnérable : la phrase brève, au rythme ternaire, « il était seul, planteur, et jeune » l.14, désigne les « qualités » du personnage, selon la mère. La présence du diamant, qui semble métamorphoser le personnage (il « conférait [aux mains] une valeur royale, un peu déliquescente », l.13-14) attire sa convoitise. Si la scène est quasiment muette, les regards qu’elle jette au diamant, puis au planteur et enfin à sa fille,[citez-les]trahissent ses intentions que les paroles qui suivent précisent : Suzanne doit être « aimable » pour plaire au planteur[ étudier les échanges mère-fille], visiblement séduit. M. Jo est alors une proie qu’il s’agit de conquérir.
3) A travers le portrait de M. Jo se construit alors celui des autres personnages , en particulier celui de Suzanne. Le regard jeté par la mère à Suzanne est l’occasion d’un portrait de la jeune fille, dont la jeunesse est soulignée avec insistance (« elle était jeune, à la pointe de l’adolescence » l.18), ainsi que le caractère : « pas timide ». Elle peut ainsi entrer dans les desseins de sa mère : tout doit être mis en œuvre pour séduire le planteur et obtenir les moyens de vivre, encore, dans la concession.
SYNTHESE
Le portrait de M. Jo insiste sur le statut social de celui-ci par la focalisation sur ses vêtements et surtout sur le diamant. Les regards des personnages préfigurent la suite de l’histoire : en observant Suzanne, le planteur manifeste son désir, mais celui-ci est perçu par la mère. M. Jo devient alors l’objet de toutes les convoitises : il symbolise la richesse, l’aisance, mais représente aussi la possibilité pour la famille de conserver leur concession.
Piste complémentaire :
Consulter sur le site de l’INA l’interview de Marguerite Duras sur les adaptations cinématographiques de romans. Quelles est son opinion ? Pour quelle raison un romancier est-il poussé à adapter ses œuvres ? Partagez-vous le point de vue de l’auteur ?
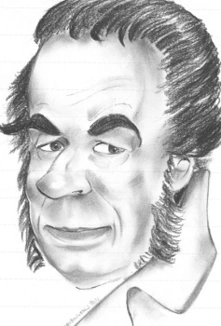
«
caractéristiques ses caractéristiques : « au premier aspect » (l.11), « un certain air de contentement de soi »
(l.13-14), « mêlé à je ne sais quoi de borné » (l.14), « on sent enfin » (l.14-15)les autres informations sur M.
de Rênal sont délivrées par d’autres personnages rencontrés par le «
voyageur » ; ceux-ci détaillent ses biens, en particulier dans des discours directs « on lui répond avec un
accent traînard : Eh ! elle est à M.
le maire » (l.2-3), des discours indirects « On lui apprend que cette
maison appartient à M.
de Rênal » (l.20), du discours indirect libre (à partir de la ligne 20) « C’est aux
bénéfices… »
Le portrait de M.
de Rênal progresse donc en même temps que le voyageur effectue sa promenade.
3) Le narrateur souligne sa puissance et son autorité.
Celui-ci est d’abord caractérisé par son autorité
politique : il est présenté d’emblée comme « M.
le Maire » (l.3) et le narrateur souligne la « dignité du
maire de village » (l.11)
Mais il représente aussi une autorité financière : ses nombreuses possessions témoignent de sa réussite
sociale (la fabrique de clous, la belle demeure), et la position de sa maison, en haut de la grande rue de
Verrières, témoigne de son succès.
Cette propriété domine la ville mais aussi offre une vue sur « une ligne d’horizon formée par les
collines de la Bourgogne » (l.21), symbolisant ainsi l’ambition du personnage.
Les autres personnages sont indifférenciés dans cet extrait : le pronom personnel indéfini « on » les
représente, ou bien ils ne sont désignés que par leurs vêtements, « leurs chapeaux » (l.8), dans une
synecdoque.
Seul personnage à posséder une identité, M.
de Rênal acquiert un statut supérieur.
II.
La satire du riche provincial
1) L’ensemble de l’extrait mentionne la ville de Verrières et effectue sa description, en même temps que
celle du personnage qui occupe la position sociale la plus importante de la ville.
En soulignant le fait que le «
voyageur » qui arrive dans cette ville soit « parisien » (l.13), le narrateur amplifie la distance qui sépare
celui-ci des provinciaux rencontrés.
Ainsi, tout doit surprendre ce voyageur, double du lecteur, jusqu’à «
l’accent traînard » des habitants (accent « suisse », la ville étant proche de la Suisse).
Le narrateur
circonscrit ainsi la puissance de M.
de Rênal à Verrières et laisse présager une réussite limitée dans l’espace.
2) Mais cette mention de l’identité du voyageur offre aussi la possibilité au narrateur d’émettre sur le
personnage toute une série de jugements qui évoluent au cours de l’extrait.
Ainsi, M.
de Rênal est tout
d’abord vu comme un personnage important « au premier aspect », sa physionomie « réunit à la dignité du
maire cette sorte d’agrément qui peut encore se rencontrer avec quarante-huit ou cinquante ans » (l.11-13).
Le lien logique « mais » vient apporter une restriction, et la phrase suit juxtapose quatre défauts : «
contentement de soi », « suffisance », « borné », « peu inventif » (l.13-14).
Dans une sorte d’élargissement,
le voyageur émet aussi ses impressions négatives sur la ville où règne « l’atmosphère empestée des petits
intérêts d’argent dont il commence à être asphyxié » (l.23-24).
La puissance financière de M.
de Rênal,
soulignée notamment à travers l’emploi à deux reprises du mot « payer » (« se faire payer », « payer lui-
même », l.15-16), contribue à mettre le voyageur mal à l’aise.
Malgré toutes les possessions de M.
de Rênal
et son autorité, l’univers présenté semble étriqué, borné, tout comme l’est ce personnage.
Le narrateur
emploie le mot « borne » et « borné » à deux reprises, lignes 14 et 15..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- ROUGE ET LE NOIR (Le) de Stendhal (résumé et analyse)
- Rouge ET LE Noir (le) de Stendhal (résumé et analyse de l'oeuvre)
- Le Rouge et le Noir & Chronique de 1830 de Stendhal (analyse détaillée)
- STENDHAL: LE ROUGE ET LE NOIR (résumé & analyse)
- Analyse chapitre 16 ,24 et 25 le Rouge et le Noir de Stendhal