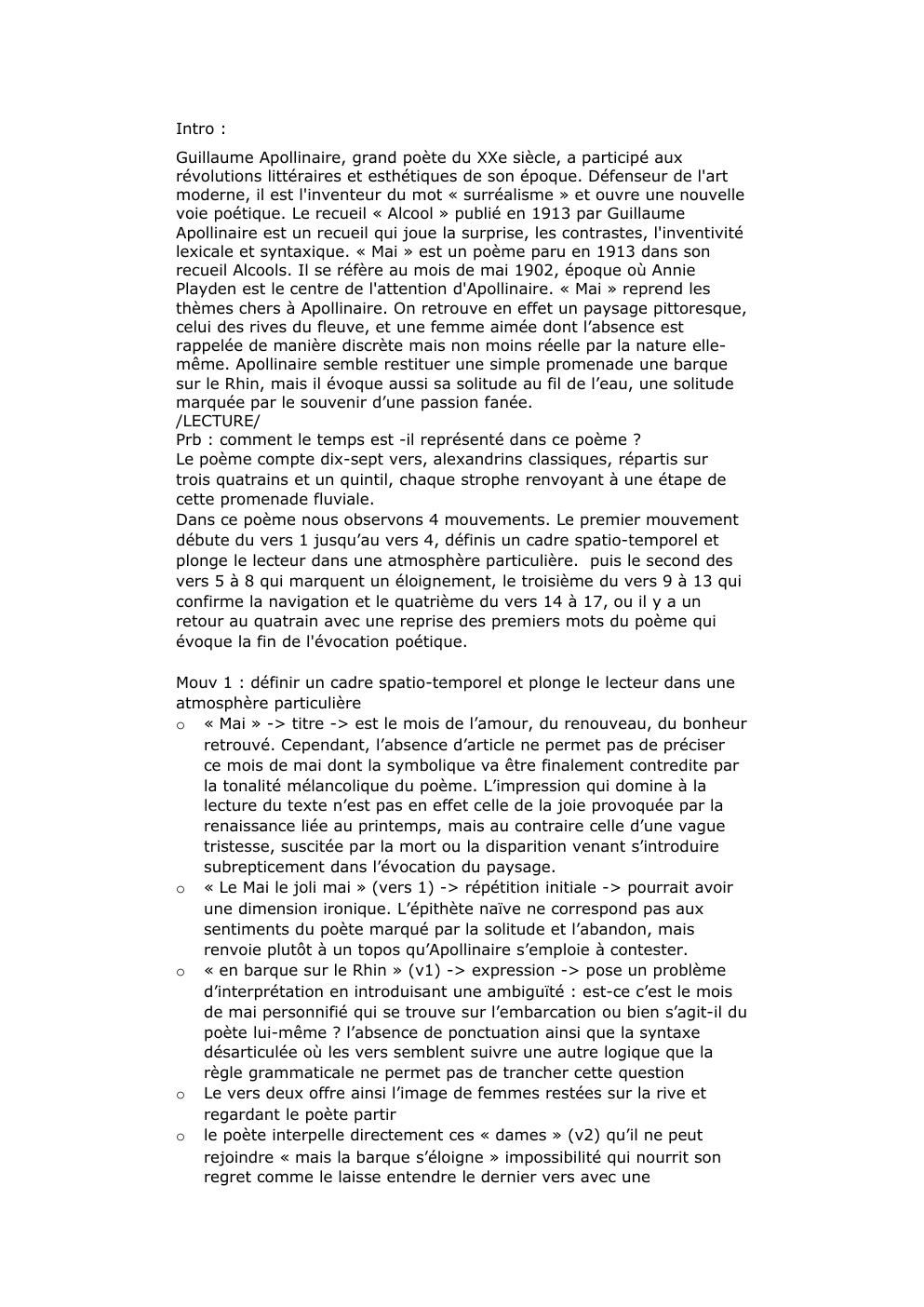Apollinaire: Mai (analyse du poème)
Publié le 25/10/2023
Extrait du document
«
Intro :
Guillaume Apollinaire, grand poète du XXe siècle, a participé aux
révolutions littéraires et esthétiques de son époque.
Défenseur de l'art
moderne, il est l'inventeur du mot « surréalisme » et ouvre une nouvelle
voie poétique.
Le recueil « Alcool » publié en 1913 par Guillaume
Apollinaire est un recueil qui joue la surprise, les contrastes, l'inventivité
lexicale et syntaxique.
« Mai » est un poème paru en 1913 dans son
recueil Alcools.
Il se réfère au mois de mai 1902, époque où Annie
Playden est le centre de l'attention d'Apollinaire.
« Mai » reprend les
thèmes chers à Apollinaire.
On retrouve en effet un paysage pittoresque,
celui des rives du fleuve, et une femme aimée dont l’absence est
rappelée de manière discrète mais non moins réelle par la nature ellemême.
Apollinaire semble restituer une simple promenade une barque
sur le Rhin, mais il évoque aussi sa solitude au fil de l’eau, une solitude
marquée par le souvenir d’une passion fanée.
/LECTURE/
Prb : comment le temps est -il représenté dans ce poème ?
Le poème compte dix-sept vers, alexandrins classiques, répartis sur
trois quatrains et un quintil, chaque strophe renvoyant à une étape de
cette promenade fluviale.
Dans ce poème nous observons 4 mouvements.
Le premier mouvement
débute du vers 1 jusqu’au vers 4, définis un cadre spatio-temporel et
plonge le lecteur dans une atmosphère particulière.
puis le second des
vers 5 à 8 qui marquent un éloignement, le troisième du vers 9 à 13 qui
confirme la navigation et le quatrième du vers 14 à 17, ou il y a un
retour au quatrain avec une reprise des premiers mots du poème qui
évoque la fin de l'évocation poétique.
Mouv 1 : définir un cadre spatio-temporel et plonge le lecteur dans une
atmosphère particulière
o « Mai » -> titre -> est le mois de l’amour, du renouveau, du bonheur
retrouvé.
Cependant, l’absence d’article ne permet pas de préciser
ce mois de mai dont la symbolique va être finalement contredite par
la tonalité mélancolique du poème.
L’impression qui domine à la
lecture du texte n’est pas en effet celle de la joie provoquée par la
renaissance liée au printemps, mais au contraire celle d’une vague
tristesse, suscitée par la mort ou la disparition venant s’introduire
subrepticement dans l’évocation du paysage.
o « Le Mai le joli mai » (vers 1) -> répétition initiale -> pourrait avoir
une dimension ironique.
L’épithète naïve ne correspond pas aux
sentiments du poète marqué par la solitude et l’abandon, mais
renvoie plutôt à un topos qu’Apollinaire s’emploie à contester.
o « en barque sur le Rhin » (v1) -> expression -> pose un problème
d’interprétation en introduisant une ambiguïté : est-ce c’est le mois
de mai personnifié qui se trouve sur l’embarcation ou bien s’agit-il du
poète lui-même ? l’absence de ponctuation ainsi que la syntaxe
désarticulée où les vers semblent suivre une autre logique que la
règle grammaticale ne permet pas de trancher cette question
o Le vers deux offre ainsi l’image de femmes restées sur la rive et
regardant le poète partir
o le poète interpelle directement ces « dames » (v2) qu’il ne peut
rejoindre « mais la barque s’éloigne » impossibilité qui nourrit son
regret comme le laisse entendre le dernier vers avec une
o
personnification toute romantique de la nature « Qui donc a fait
pleurer les saules riverains », en jouant sur la dénomination du saule
pleureur, Apollinaire réactive une image traditionnelle pour souligner
la tristesse de cet éloignement,
On remarque enfin que le poème mêle ici le récit et le discours, que
l’abandon de la ponctuation rendent plus perméables l’un à l’autre.
Mouv 2 : marque L’éloignement qui va aussi rappeler le souvenir de la
femme qu’il a tant aimée
o « or » (v 5) -> conjonction de coordination introduit une forte
opposition entre les deux strophes, comme pour mieux souligner cet
éloignement irrémédiable qui renvoie dans le passé figé les souvenirs
du poète.
o
Le tableau des « vergers fleuris » (v 5) est ainsi fixé pour mieux
évoquer dans une analogie subtile l’amour perdu.
o « pétales » (v 6 et 8) -> anaphore avec cependant une épithète
différente à chaque fois, « tombés » (v 6) et « flétris » (v8).
Dès
lors, si l’image s’explique aisément....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Analyse du poème d'Apollinaire "La Chanson du mal-aimé"
- Analyse du poème "Marie" de Guillaume Apollinaire
- Analyse du poème "La Charité" des Méditations Poétiques de Lamartine
- Analyse poème Mon reve familier
- Analyse linéaire Zone G. Apollinaire