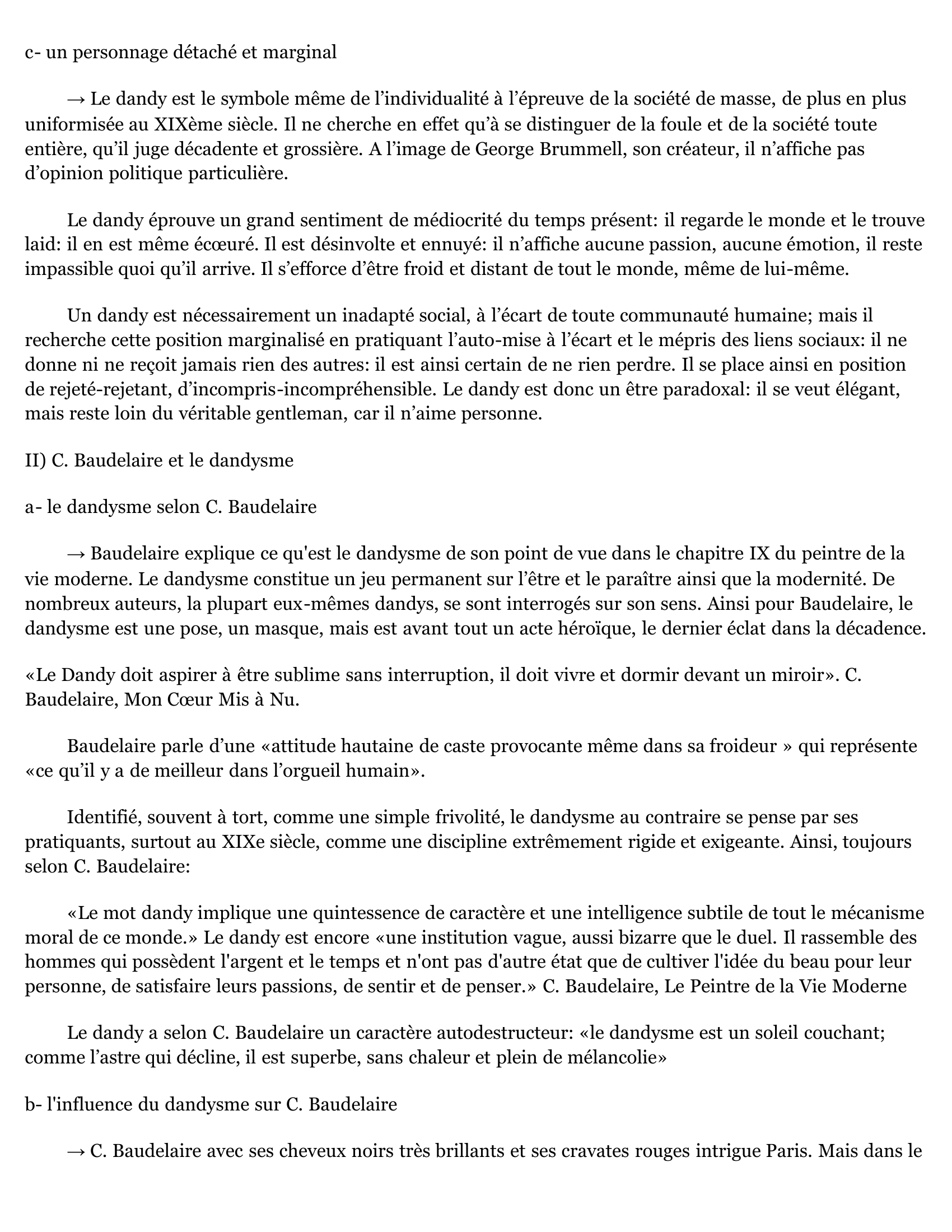Baudelaire Et Le Dandisme
Publié le 16/09/2018

Extrait du document

→ C. Baudelaire a participé à la mythification (apport d'un caractère mythique) du dandy qui a causé sa perte tout en le sauvant pour toujours. En effet Baudelaire a fait du dandysme une arme poétique, l'expression d'une révolte et d'un mal-être permanent, d'un spleen étouffant, et a alors tué le dandy. Mais C. Baudelaire lui a aussi donné une dimension qui le rend immortel car il exprime, ce qu'aucun dandy n'a fait par coquetterie ou capacité, les profondes motivations d'une posture qui aurait pu n'être comprise que dans sa superficialité. Le dandy se rapproche de l’artiste. C. Baudelaire décrit, dans quelques de ses écrits, l’artiste comme le nouvel “aristocrate”, qui doit avoir une attitude marquée de froideur distante, qui ne doit jamais avoir de sentiments excités ou irrités, et dont l’ironie doit être la qualité principale, de même que la capacité à raconter des anecdotes plaisantes. Le dandy artiste se démarque par rapport aux autres habituels de la société. Ces positions de C. Baudelaire se résument dans les paroles d’un personnage d’Ernst Jünger, dans le roman Héliopolis : « Je suis devenu le dandy, qui prend pour important ce qui ne l’est pas, qui se moque de ce qui est important ». Le dandy de C. Baudelaire, à l’instar de Brummell, n’est donc pas un personnage scandaleux et sulfureux à la Oscar Wilde, mais un observateur froid , qui voit le monde comme un simple théâtre, souvent insipide où des personnages sans réelle substance s’agitent et gesticulent. Le dandy baudelairien a quelque peu le goût de la provocation, mais reste proche de l’ironie.

«
c- un personnage détaché et marginal
→ Le dandy est le symbole même de l’individualité à l’épreuve de la société de masse, de plus en plus
uniformisée au XIXème siècle.
Il ne cherche en effet qu’à se distinguer de la foule et de la société toute
entière, qu’il juge décadente et grossière.
A l’image de George Brummell, son créateur, il n’affiche pas
d’opinion politique particulière.
Le dandy éprouve un grand sentiment de médiocrité du temps présent: il regarde le monde et le trouve
laid: il en est même écœuré.
Il est désinvolte et ennuyé: il n’affiche aucune passion, aucune émotion, il reste
impassible quoi qu’il arrive.
Il s’efforce d’être froid et distant de tout le monde, même de lui-même.
Un dandy est nécessairement un inadapté social, à l’écart de toute communauté humaine; mais il
recherche cette position marginalisé en pratiquant l’auto-mise à l’écart et le mépris des liens sociaux: il ne
donne ni ne reçoit jamais rien des autres: il est ainsi certain de ne rien perdre.
Il se place ainsi en position
de rejeté-rejetant, d’incompris-incompréhensible.
Le dandy est donc un être paradoxal: il se veut élégant,
mais reste loin du véritable gentleman, car il n’aime personne.
II) C.
Baudelaire et le dandysme
a - le dandysme selon C.
Baudelaire
→ Baudelaire explique ce qu'est le dandysme de son point de vue dans le chapitre IX du peintre de la
vie moderne.
Le dandysme constitue un jeu permanent sur l’être et le paraître ainsi que la modernité.
De
nombreux auteurs, la plupart eux -mêmes dandys, se sont interrogés sur son sens.
Ainsi pour Baudelaire, le
dandysme est une pose, un masque, mais est avant tout un acte héroïque, le dernier éclat dans la décadence.
«Le Dandy doit aspirer à être sublime sans interruption, il doit vivre et dormir devant un miroir».
C.
Baudelaire, Mon Cœur Mis à Nu.
Baudelaire parle d’une «attitude hautaine de caste provocante même dans sa froideur » qui représente
«ce qu’il y a de meilleur dans l’orgueil humain».
Identifié, souvent à tort, comme une simple frivolité, le dandysme au contraire se pense par ses
pratiquants, surtout au XIXe siècle, comme une discipline extrêmement rigide et exigeante.
Ainsi, toujours
selon C.
Baudelaire:
«Le mot dandy implique une quintessence de caractère et une intelligence subtile de tout le mécanisme
moral de ce monde.» Le dandy est encore «une institution vague, aussi bizarre que le duel.
Il rassemble des
hommes qui possèdent l'argent et le temps et n'ont pas d'autre état que de cultiver l'idée du beau pour leur
personne, de satisfaire leurs passions, de sentir et de penser.» C.
Baudelaire, Le Peintre de la Vie Moderne
Le dandy a selon C.
Baudelaire un caractère autodestructeur: «le dandysme est un soleil couchant;
comme l’astre qui décline, il est superbe, sans chaleur et plein de mélancolie»
b- l'influence du dandysme sur C.
Baudelaire
→ C.
Baudelaire avec ses cheveux noirs très brillants et ses cravates rouges intrigue Paris.
Mais dans le.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Texte d’étude : Charles Baudelaire, « L’Ennemi », Les Fleurs du Mal (1857): Le temps mange-t-il la vie ? (HLP Philo)
- Analyse linéaire Bac Français A une passante de Baudelaire
- explication linéaire charogne baudelaire
- Baudelaire, A un passante, analyse linéaire
- Le poison, Charles Baudelaire