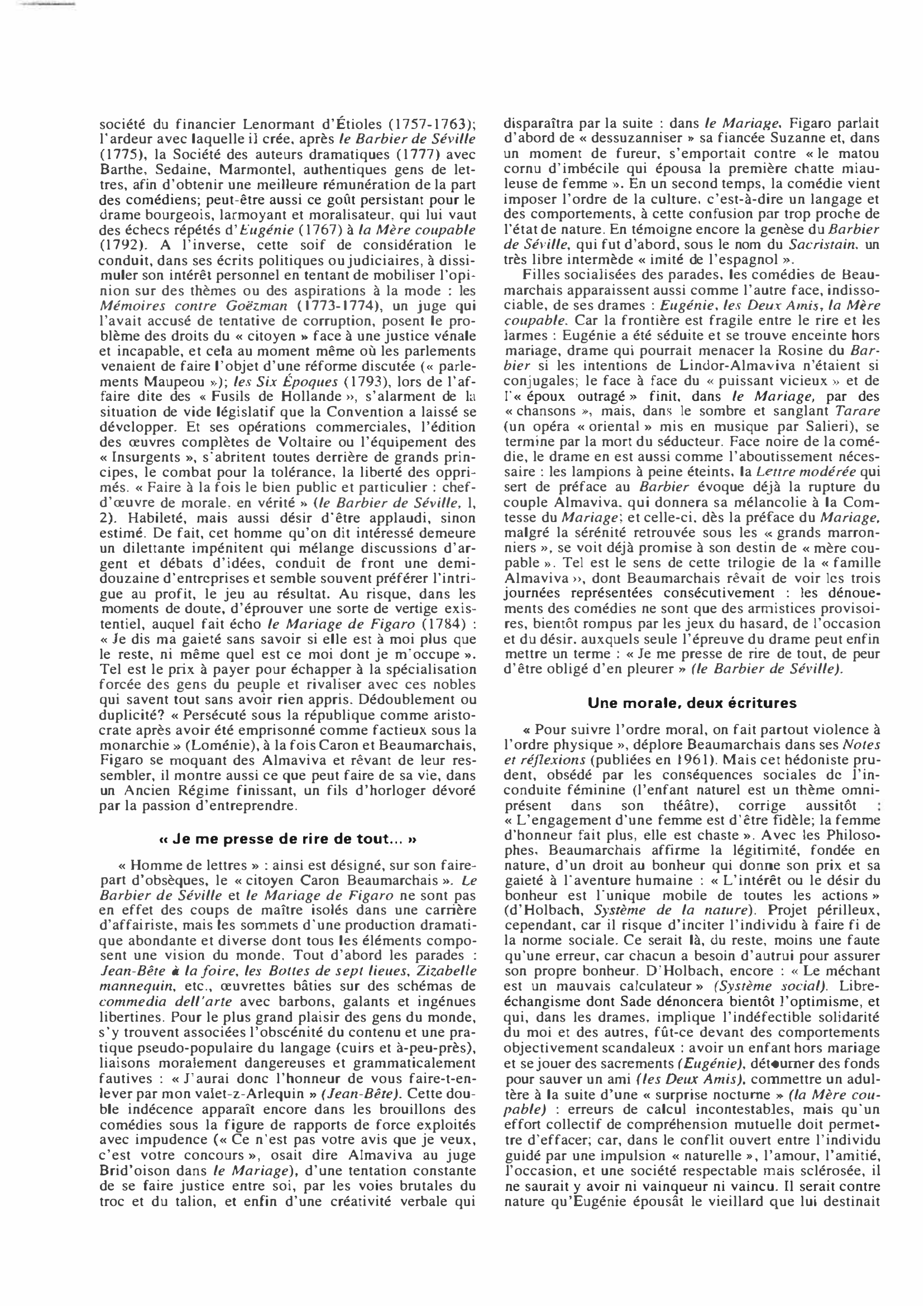BEAUMARCHAIS Pierre-Augustin Caron de : sa vie et son oeuvre
Publié le 16/11/2018

Extrait du document
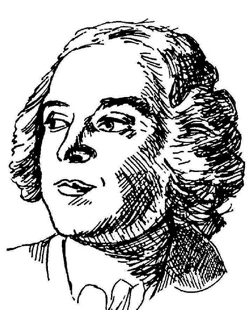
BEAUMARCHAIS Pierre-Augustin Caron de (1732-1799). Considéré avec méfiance par les Philosophes du xvme siècle, Beaumarchais apparut bientôt comme leur chef de file : « Figaro a tué la noblesse » (Danton). Eclatante revanche pour un ancien horloger devenu affairiste mondain, coupable aux yeux de ses contemporains d’écrire des chefs-d’œuvre sans prendre la littérature au sérieux et de tenir un discours déjà révolutionnaire sans mépriser pour autant la dolce vita des aristocrates. Sans doute y a-t-il de sa part quelque optimisme à décrire l’affrontement social en termes de comédie d’intrigue; pourtant le Mariage de Figaro pose déjà dans son ampleur la question des droits de l’homme, et ses mots d’auteur, qui résument d’une phrase les aspirations confuses d’une époque, ont déjà la force de ces slogans dont toute révolution a besoin.
La passion d'entreprendre
Sans jamais cesser d’écrire, Beaumarchais investit sa prodigieuse énergie vitale dans les activités les plus différentes : l’horlogerie, métier qu’exerçait son père André-Charles Caron, la magistrature, la police secrète, l’édition, le trafic d’armes, et toutes sortes d’opérations financières plus ou moins grandioses et honnêtes, de la Compagnie des eaux de Paris à la colonisation de Madagascar, de l’aide aux « Insurgents » américains à la promotion de l’« aérambule ». On conçoit que l’écriture, ces milliers de lettres, ces dizaines de rapports, de requêtes, de mémoires qu’il a laissés, ait d’abord été pour lui une arme d’usage quotidien, un instrument de combat ou de séduction; et la littérature, un « délassement », un « amusement ». Non négligeable, cependant : car la fiction, qui reproduit en la transposant l’expérience vécue de l’intrigant, aplanit miraculeusement les difficultés de la vie réelle; après le « travail forcé des affaires », elle donne l’illusion d’un pouvoir soudain absolu sur le monde : les contraintes dramaturgiques sont légères à côté de celles qu’imposent le négoce et la finance. Écriture en liberté, elle permet aussi de changer de masque, d’échapper à cette « réputation détestable » qui lui colle à la peau, celle d’un aventurier sans scrupules. D’où le silence pudique qu’il garde sur ses premières productions, des « parades » érotiques destinées au théâtre de société du financier Lenormant d’Étioles (1757-1763); l'ardeur avec laquelle il crée, après le Barbier de Séville (1775), la Société des auteurs dramatiques (1777) avec Barthe, Sedaine, Marmontel, authentiques gens de lettres, afin d’obtenir une meilleure rémunération de la part des comédiens; peut-être aussi ce goût persistant pour le drame bourgeois, larmoyant et moralisateur, qui lui vaut des échecs répétés d’Eugénie (1767) à la Mère coupable (1792). A l’inverse, cette soif de considération le conduit, dans ses écrits politiques ou judiciaires, à dissimuler son intérêt personnel en tentant de mobiliser l’opinion sur des thèmes ou des aspirations à la mode : les Mémoires contre Goëzman (1773-1774), un juge qui l'avait accusé de tentative de corruption, posent le problème des droits du « citoyen » face à une justice vénale et incapable, et cela au moment même où les parlements venaient de faire l’objet d’une réforme discutée (« parlements Maupeou »); les Six Epoques (1793), lors de l’affaire dite des « Fusils de Hollande », s'alarment de la situation de vide législatif que la Convention a laissé se développer. Et ses opérations commerciales, l’édition des œuvres complètes de Voltaire ou l’équipement des « Insurgents », s’abritent toutes derrière de grands principes, le combat pour la tolérance, la liberté des opprimés. « Faire à la fois le bien public et particulier : chef-d’œuvre de morale, en vérité » (le Barbier de Séville, I, 2). Habileté, mais aussi désir d'être applaudi, sinon estimé. De fait, cet homme qu’on dit intéressé demeure un dilettante impénitent qui mélange discussions d'argent et débats d’idées, conduit de front une demi-douzaine d’entreprises et semble souvent préférer l’intrigue au profit, le jeu au résultat. Au risque, dans les moments de doute, d’éprouver une sorte de vertige existentiel, auquel fait écho le Mariage de Figaro (1784) : « Je dis ma gaieté sans savoir si elle est à moi plus que le reste, ni même quel est ce moi dont je m’occupe ». Tel est le prix à payer pour échapper à la spécialisation forcée des gens du peuple et rivaliser avec ces nobles qui savent tout sans avoir rien appris. Dédoublement ou duplicité? « Persécuté sous la république comme aristocrate après avoir été emprisonné comme factieux sous la monarchie » (Loménie), à la fois Caron et Beaumarchais, Figaro se moquant des Almaviva et rêvant de leur ressembler, il montre aussi ce que peut faire de sa vie, dans un Ancien Régime finissant, un fils d'horloger dévoré par la passion d'entreprendre.
« Je me presse de rire de tout... »
« Homme de lettres » : ainsi est désigné, sur son faire-part d’obsèques, le « citoyen Caron Beaumarchais ». Le Barbier de Séville et le Mariage de Figaro ne sont pas en effet des coups de maître isolés dans une carrière d’affairiste, mais les sommets d’une production dramatique abondante et diverse dont tous les éléments composent une vision du monde. Tout d’abord les parades : Jean-Bête à la foire, les Bottes de sept lieues, Zizabelle mannequin, etc., œuvrettes bâties sur des schémas de commedia dell’arte avec barbons, galants et ingénues libertines. Pour le plus grand plaisir des gens du monde, s’y trouvent associées l’obscénité du contenu et une pratique pseudo-populaire du langage (cuirs et à-peu-près), liaisons moralement dangereuses et grammaticalement fautives : « J’aurai donc l’honneur de vous faire-t-en-lever par mon valet-z-Arlequin » (Jean-Bête). Cette double indécence apparaît encore dans les brouillons des comédies sous la figure de rapports de force exploités avec impudence (« Ce n’est pas votre avis que je veux, c’est votre concours », osait dire Almaviva au juge Brid’oison dans le Mariage), d’une tentation constante de se faire justice entre soi, par les voies brutales du troc et du talion, et enfin d’une créativité verbale qui disparaîtra par la suite : dans le Mariage, Figaro parlait d’abord de « dessuzanniser » sa fiancée Suzanne et, dans un moment de fureur, s’emportait contre « le matou cornu d’imbécile qui épousa la première chatte miau-leuse de femme ». En un second temps, la comédie vient imposer l’ordre de la culture, c'est-à-dire un langage et des comportements, à cette confusion par trop proche de l’état de nature. En témoigne encore la genèse du Barbier de Séville, qui fut d’abord, sous le nom du Sacristain, un très libre intermède « imité de l'espagnol ».
Filles socialisées des parades, les comédies de Beaumarchais apparaissent aussi comme l’autre face, indissociable, de ses drames : Eugénie, les Deux Amis, la Mère coupable. Car la frontière est fragile entre le rire et les larmes : Eugénie a été séduite et se trouve enceinte hors mariage, drame qui pourrait menacer la Rosine du Barbier si les intentions de Lindor-Almaviva n’étaient si conjugales; le face à face du « puissant vicieux » et de l'« époux outragé » finit, dans le Mariage, par des « chansons », mais, dans le sombre et sanglant Tarare (un opéra « oriental » mis en musique par Salieri), se termine par la mort du séducteur. Face noire de la comédie, le drame en est aussi comme l’aboutissement nécessaire : les lampions à peine éteints, la Lettre modérée qui sert de préface au Barbier évoque déjà la rupture du couple Almaviva, qui donnera sa mélancolie à la Comtesse du Mariage', et celle-ci, dès la préface du Mariage, malgré la sérénité retrouvée sous les « grands marronniers », se voit déjà promise à son destin de « mère coupable ». Tel est le sens de cette trilogie de la « famille Almaviva », dont Beaumarchais rêvait de voir les trois journées représentées consécutivement : les dénouements des comédies ne sont que des armistices provisoires, bientôt rompus par les jeux du hasard, de l'occasion et du désir, auxquels seule l’épreuve du drame peut enfin mettre un terme : « Je me presse de rire de tout, de peur d’être obligé d’en pleurer » (le Barbier de Séville).
Une morale, deux écritures
« Pour suivre l’ordre moral, on fait partout violence à l’ordre physique », déplore Beaumarchais dans ses Notes et réflexions (publiées en 1961). Mais cet hédoniste prudent, obsédé par les conséquences sociales de l’inconduite féminine (l’enfant naturel est un thème omniprésent dans son théâtre), corrige aussitôt : « L’engagement d'une femme est d’être fidèle; la femme d’honneur fait plus, elle est chaste ». Avec les Philosophes, Beaumarchais affirme la légitimité, fondée en nature, d’un droit au bonheur qui donne son prix et sa gaieté à l'aventure humaine : « L’intérêt ou le désir du bonheur est l'unique mobile de toutes les actions » (d’Holbach, Système de la nature). Projet périlleux, cependant, car il risque d’inciter l’individu à faire fi de la norme sociale. Ce serait là, du reste, moins une faute qu’une erreur, car chacun a besoin d’autrui pour assurer son propre bonheur. D'Holbach, encore : « Le méchant est un mauvais calculateur » (Système social). Libre-échangisme dont Sade dénoncera bientôt l’optimisme, et qui, dans les drames, implique l’indéfectible solidarité du moi et des autres, fût-ce devant des comportements objectivement scandaleux : avoir un enfant hors mariage et se jouer des sacrements (Eugénie), détourner des fonds pour sauver un ami (les Deux Amis), commettre un adultère à la suite d’une « surprise nocturne » (la Mère coupable) : erreurs de calcul incontestables, mais qu’un effort collectif de compréhension mutuelle doit permettre d’effacer; car, dans le conflit ouvert entre l’individu guidé par une impulsion « naturelle », l’amour, l’amitié, l’occasion, et une société respectable mais sclérosée, il ne saurait y avoir ni vainqueur ni vaincu. Il serait contre nature qu’Eugénie épousât le vieillard que lui destinait son père, que Mélac laissât périr le vertueux Aurelly (les Deux Amis), que la comtesse Almaviva abandonnée par son mari pût résister à Tardent Chérubin (la Mère coupable). Mais le « coupable », en échange de sa réintégration, n’en doit pas moins afficher clairement son repentir : l’échec du drame vient de ce qu'il se déroule après le « crime », en un temps où le héros, paralysé par le remords, ne peut plus agir ni parler, mais seulement se donner à voir : « tableaux » pitoyables (« Eugénie, s’élançant vers le Baron et le retenant à bras-le-corps »...), déplorations interminables qui s’intégrent mal dans une écriture dramatique demeurée traditionnelle. Le langage, dès lors, n’a plus ici que le statut secondaire d’un commentaire, voire d’une légende : « Mon frère, par pitié, suspendez vos reproches! Ne voyez-vous pas l’état où elle est? » (Eugénie). L’on comprend l’importance que Diderot et Beaumarchais, dans leur pratique du drame, attachaient à la « pantomime »... Echec du drame ou drame de l’échec : le héros est précisément celui qui n’a plus rien à dire.
Ce discours haché, douloureux, contraste fortement avec celui de la comédie, fluide et proliférant : nous voici « avant ». en un temps où le héros croit encore, même s’il « se hâte » de rire, savoir jusqu’où on peut aller trop loin. Voie étroite qui se définit par une stratégie et par une attitude : l’intrigue et l’insolence. Ce compromis subtil entre l’intérêt personnel et le respect de l'ordre établi, entre la révolte et la soumission, implique à son tour un langage spécifique : des maximes caustiques où le moi affirme bien haut son droit à la différence, sans pourtant mettre en cause sa connivence avec un adversaire qui souvent lui tend la perche :
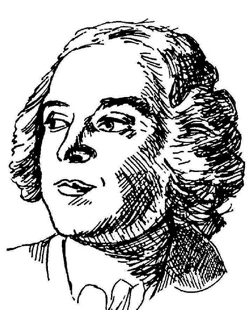
«
société
du financier Lenormant d'Étioles (1757-1763);
l'ardeur avec laquelle il crée, après le Barbier de Séville
( 1775), la Société des auteurs dramatiques (1777) avec
Barthe, Sedaine, Marmontel, authentiques gens de let
tres, afin d'obtenir une meilleure rémunération de la part
des comédiens; peut-être aussi ce goOt persistant pour le
drame bourgeois, larmoyant et moralisateur, qui lui vaut
des échecs répétés d'Eugénie ( 1767) à la Mère coupable
( 1792).
A l'inverse, cette soif de considération le
conduit, dans ses écrits politiques ou judiciaires, à dissi
muler son intérêt personnel en tentant de mobiliser l'opi
nion sur des thèmes ou des aspirations à la mode : les
Mémoires contre Goëzman ( 1773-1774), un juge qui
l'avait accusé de tentative de corruption, posent le pro
blème des droits du «citoyen » face à une justice vénale
et incapable, et cela au moment même où les parlements
venaient de faire l'objet d'une réforme discutée(> (le Barbier de Séville, l,
2).
Habileté, mais aussi désir d'être applaudi, sinon
estimé.
De fait, cet homme qu'on dit intéressé demeure
un dilettante impénitent qui mélange discussions d'ar
gent et débats d'idées, conduit de front une demi
douzaine d'entreprises et semble souvent préférer l'intri
gue au profit, le jeu au résultat.
Au risque, dans les
moments de doute, d'éprouver une sorte de vertige exis
tentiel, auquel fait écho le Mariage de Figaro (1784) :
>(Jean-Bête).
Cette dou
ble indécence appara1t encore dans les brouillons des
comédies sous la figure de rapports de force exploités
avec impudence («Ce n'est pas votre avis que je veux,
c'est votre concours», osait dire Almaviva au juge
Brid'oison dans le Mariage), d'une tentation constante
de se faire justice entre soi, par les voies brutales du
troc et du talion, et enfin d'une créativité verbale qui disparaîtra
par la suite : dans le Mariage, Figaro parlait
d'abord de« dessuzanniser >>sa fiancée Suzanne et, dans
un moment de fureur, s'emportait contre «le matou
cornu d'imbécile qui épousa la première chatte miau
leuse de femme ».
En un second temps, la comédie vient
imposer l'ordre de la culture, c'est-à-dire un langage et
des comportements, à cette confusion par trop proche de
1 'état de nature.
En témoigne encore la genèse du Barbier
de Séville, qui fut d'abord, sous le nom du Sacristain, un
très libre intermède« imité de l'espagnol».
Filles socialisées des parades.
les comédies de Beau
marchais apparaissent aussi comme l'autre face, indisso
ciable, de ses drames : Eugénie, les Deux Amis, la Mère
coupable.
Car la frontière est fragile entre le rire et les
larmes : Eugénie a été séduite et se trouve enceinte hors
mariage, drame qui pourrait menacer la Rosine du Bar
bier si les intentions de Lindor-Almaviva n'étaient si
conjugales; le face à face du «puissant vicieux» et de
l'« époux outragé» finit, dans le Mariage, par des
«chansons >>, mais, dans le sombre et sanglant Tarare
(un opéra «oriental» mis en musique par Salieri), se
termine par la mort du séducteur.
Face noire de la comé
die, le drame en est aussi comme l'aboutissement néces
saire : les lampions à peine éteints, la Lettre modérée qui
sert de préface au Barbier évoque déjà la rupture du
couple Almaviva, qui donnera sa mélancolie à la Com
tesse du Mariage; et celle-ci, dès la préface du Mariage,
malgré la sérénité retrouvée sous les «grands marron
niers >>, se voit déjà promise à son destin de « mère cou
pable>>.
Tel est le sens de cette trilogie de la «famille
Almaviva >>, dont Beaumarchais rêvait de voir les trois
journées représentées consécutivement : les dénoue
ments des comédies ne sont que des armistices provisoi
res, bientôt rompus par les jeux du hasard, de 1 'occasion
et du désir, auxquels seule l'épreuve du drame peut enfin
mettre un terme : «Je me presse de rire de tout, de peur
d'être obligé d'en pleurer >> (le Barbier de Séville).
Une morale, deux écritures
>, déplore Beaumarchais dans ses Notes
et réflexions (publiées en 1961 ).
Mais cet hédoniste pru
dent, obsédé par les conséquences sociales de 1' in
conduite féminine (l'enfant naturel est un thème omni
présent dans son théâtre), corrige aussitôt
« L'engagement d'une femme est d'être fidèle; la femme
d'honneur fait plus.
elle est chaste».
Avec les Philoso
phes, Beaumarchais affirme la légitimité, fondée en
nature, d'un droit au bonheur qui donne son prix et sa
gaieté à l'aventure humaine : «L'intérêt ou le désir du
bonheur est l'unique mobile de toutes les actions>>
(d'Holbach, Système de la nature).
Projet périlleux,
cependant, car il risque d'inciter l'individu à faire fi de
la norme sociale.
Ce serait là, du reste, moins une faute
qu'une erreur, car chacun a besoin d'autrui pour assurer
son propre bonheur.
D'Holbach, encore : «Le méchant
est un mauvais calculateur» (Système social).
Libre
échangisme dont Sade dénoncera bientôt 1 'optimisme, et
qui, dans les drames, implique l'indéfectible solidarité
du moi et des autres, fût-ce devant des comportements
objectivement scandaleux : avoir un enfant hors mariage
et se jouer des sacrements (Eugénie), détourner des fonds
pour sauver un ami (les Deux Amis), commettre un adul
tère à la suite d'une «surprise nocturne >> (la Mère cou
pable) : erreurs de calcul incontestables, mais qu'un
effort collectif de compréhension mutuelle doit permet
tre d'effacer; car, dans le conflit ouvert entre l'individu
guidé par une impulsion « naturelle >>, l'amour, l'amitié,
1 'occasion, et une société respectable mais sclérosée, i 1
ne saurait y avoir ni vainqueur ni vaincu.
Il serait contre
nature qu'Eugénie épousât le vieillard que lui destinait.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le Mariage de Figaro ou la Folle Journée Pierre Augustin Caron de Beaumarchais (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- Le Mariage de Figaro (résumé & analyse) de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais
- Le Barbier de Séville ou la Précaution inutile de Pierre Caron de Beaumarchais (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- EUGÉNIE de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (résumé)
- MÈRE COUPABLE (La) ou L’autre Tartuffe de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais - résumé, analyse