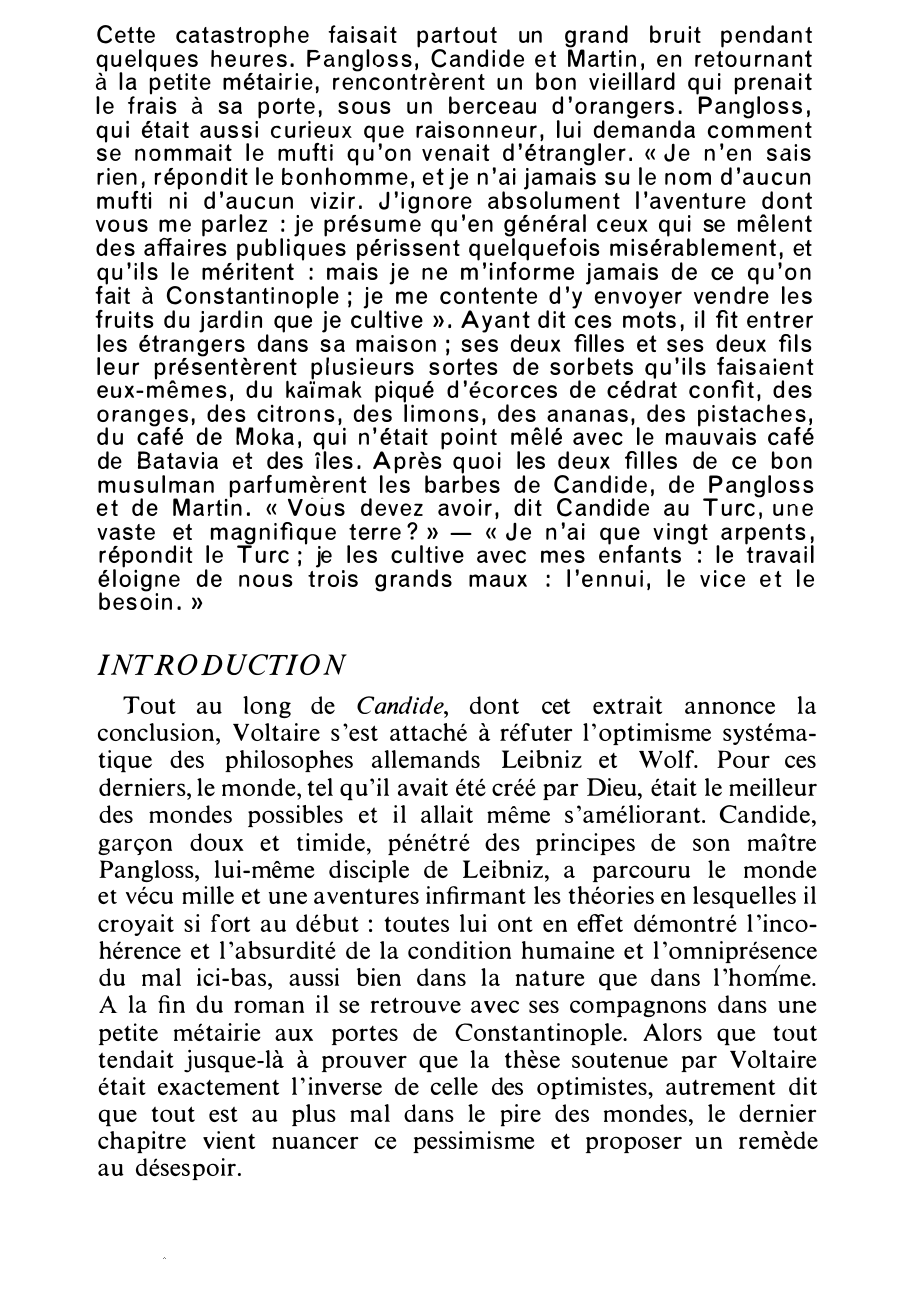Candide, chapitre 30 de Voltaire
Publié le 21/09/2018

Extrait du document

« Pendant cette conversation, la nouvelle s’était répandue qu’on venait d’étrangler à Constantinople deux vizirs du banc et le mufti, et qu’on avait empalé plusieurs de leurs amis. Cette catastrophe faisait partout un grand bruit pendant quelques heures. Pangloss, Candide et Martin, en retournant à la petite métairie, rencontrèrent un bon vieillard qui prenait le frais à sa porte, sous un berceau d’orangers. Pangloss, qui était aussi curieux que raisonneur, lui demanda comment se nommait le mufti qu’on venait d’étrangler. «Je n’en sais rien, répondit le bonhomme, et je n’ai jamais su le nom d’aucun mufti ni d’aucun vizir. J’ignore absolument l’aventure dont vous me parlez : je présume qu’en général ceux qui se mêlent des affaires publiques périssent quelquefois misérablement, et qu’ils le méritent : mais je ne m’informe jamais de ce qu’on fait à Constantinople ; je me contente d’y envoyer vendre les fruits du jardin que je cultive ». Ayant dit ces mots, il fit entrer les étrangers dans sa maison ; ses deux filles et ses deux fils leur présentèrent plusieurs sortes de sorbets qu’ils faisaient eux-mêmes, du kaïmak piqué d’écorces de cédrat confit, des oranges, des citrons, des limons, des ananas, des pistaches, du café de Moka, qui n’était point mêlé avec le mauvais café de Batavia et des îles. Après quoi les deux filles de ce bon musulman parfumèrent les barbes de Candide, de Pangloss et de Martin. « Vous devez avoir, dit Candide au Turc, une vaste et magnifique terre? » — «Je n’ai que vingt arpents, répondit le Turc ; je les cultive avec mes enfants : le travail éloigne de nous trois grands maux : l’ennui, le vice et le besoin. »
Après avoir montré ce qu’est la vie : moins horrible finalement que les événements le laissaient croire, puisque Candide et ses compagnons se sont tous retrouvés, mais loin d’être parfaite, puisqu’elle leur paraît maintenant monotone et sans intérêt, Voltaire nous présente un exemple de bonheur relatif en la personne du « bon vieillard » que Candide, Pangloss et Martin rencontrent sur le chemin de leur métairie. Se tenant délibérément en marge des événements politiques qui ne le regardent pas il avoue n’avoir jamais su « le nom d’aucun mufti ni d’aucun vizir » ce vieux Turc mène une vie agréable en compagnie de ses enfants ; sa table est opulente et d’excellente qualité, tout chez lui est raffiné et signe de prospérité depuis le choix des confiseries qu’il offre à ses invités jusqu’au rite qu’accomplissent ses deux filles en parfumant leurs barbes.
Et pourtant ce vieillard ne possède que 20 arpents de terre ce qui correspond à peu près à 7 hectares. Voltaire nous fait ici déduire nous-mêmes d’une expérience une moralité : ce vieillard, en cultivant avec ses enfants ses 7 hectares de terre, trouve dans l’action le moyen de résoudre, en les neutralisant, les trois grands problèmes qui, sollicitant l’homme perpétuellement, concourent à lui rendre la vie insupportable : l'ennui, autrement dit l’inquiétude métaphysique qui est vaine, comme la scène précédente avec le derviche l’a démontré ; le vice qui corrompt ; et le besoin qui prive des joies matérielles non dénuées de charmes et dont Voltaire connaît les agréments. Échappant ainsi à ces trois maux, grâce à son travail, à cet attachement à sa besogne quotidienne, qu’ii accomplit sans raisonner, à laquelle toute sa petite communauté familiale collabore et dont elle bénéficie, le vieux Turc n’a ni le temps ni les raisons de désespérer : pour lui, la vie qui est médiocre en soi est devenue tout à fait tolérable. Savoir écarter les questions qui ne nous concernent pas directement ou qui nous dépassent, travailler, sans chercher trop haut ni trop loin et en nous contentant de nos propres possibilités le vieux Turc ne tient pas à

«
Ce tte catastro phe faisait partout un grand bruit pendant
que lque s heur es.
Pangloss, Candide et Mar tin, en reto urnan t
à la pe tite métairie, rencontrèrent un bon vieillar d qui prenait
le frais à sa porte, sous un berceau d'or anger s.
Pangloss ,
qui était aussi curieux que raiso nneur, lui demanda comment
se nom mait le mu fti qu' on venait d'étr angler.
«Je n'en sais
rien , répo ndit le bonhomme, et je n'ai jamais su le nom d'aucun
mu fti ni d'aucun vizir.
J'igno re absolu ment l'aventu re don t
vo us me parle z :je pr és ume qu'en général ceux qui se mêlen t
des affaires publiq ues périssent quelq uefois misér ablemen t, et
qu 'ils le mér itent : mais je ne m'info rme jamais de ce qu' on
fait à Cons tantinople ; je me contente d'y env oyer vendr e les
fru its du jardin que je cultive ».
Ayant dit ces mots, il fit entrer
les étranger s dans sa maison ; ses deux filles et ses deux fils
leur présen tèrent plusieur s sor tes de sorbe ts qu'ils faisaient
eux -mêmes, du kaïmak piqué d'éco rces de céd rat confit, des
or anges, des citrons, des limons, des ananas, des pistac hes,
du café de Mok a, qui n'é tait point mêlé avec le ma uvais café
de Batavia et des îles.
Apr ès quoi les deux filles de ce bon
musulm an parfum èrent les barbes de Candide, de Pangloss
et de Mar tin.
«V ous devez avoir, dit Candide au Tur c, une
vaste et magni fique terre? » - « Je n'ai que vingt ar pents ,
répo ndit le Tur c ; je les cultive avec mes enfants : le trav ail
éloigne de nous trois grands maux : l'ennui, le vice et le
be soin .»
INTR ODUCT ION
Tout au long de Candide, dont cet extrait annonce la
concl usion, Voltaire s'est attaché à réfuter l'optimism e systéma
tique des philosophes allemands Leibniz et Wolf .
Pour ces
de rniers, le monde, tel qu'il avait été créé par Dieu, était le meilleur
des mond es possibles et il allait même s'améliorant.
Candide,
ga rçon doux et timide, pénétré des principes de son maîtr e
Pangloss, lui-même disciple de Leibniz, a parcouru le monde
et vécu mille et une aventures infirmant les théories en lesquelles il
croyait si fort au début : toutes lui ont en effet démontré l'inco
hérence et l'absurdité de la condition humaine et l'omni présence
du mal ici-bas, aussi bien dans la natur e que dans l'ho mme.
A la fin du roman il se retrouve avec ses compagnons dans une
petite métairie aux portes de Constantinople.
Alors que tout
tendait jusque-là à prouver que la thèse soutenue par Voltair e
était exactement l'inverse de celle des optimistes, autrement dit
que tout est au plus mal dans le pire des mondes, le dernier
chapi tre vient nuancer ce pess imism e et proposer un remède
au déses poir..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Chapitre 19 de Candide de Voltaire : De quel manière Voltaire dénonce-t-il l’esclavage ?
- Candide chapitre 16 de voltaire
- Chapitre 19 de Candide de Voltaire (commentaire)
- Lecture analytique : Chapitre 6 de Candide, Voltaire
- Commentaire chapitre 3 de Candide de Voltaire