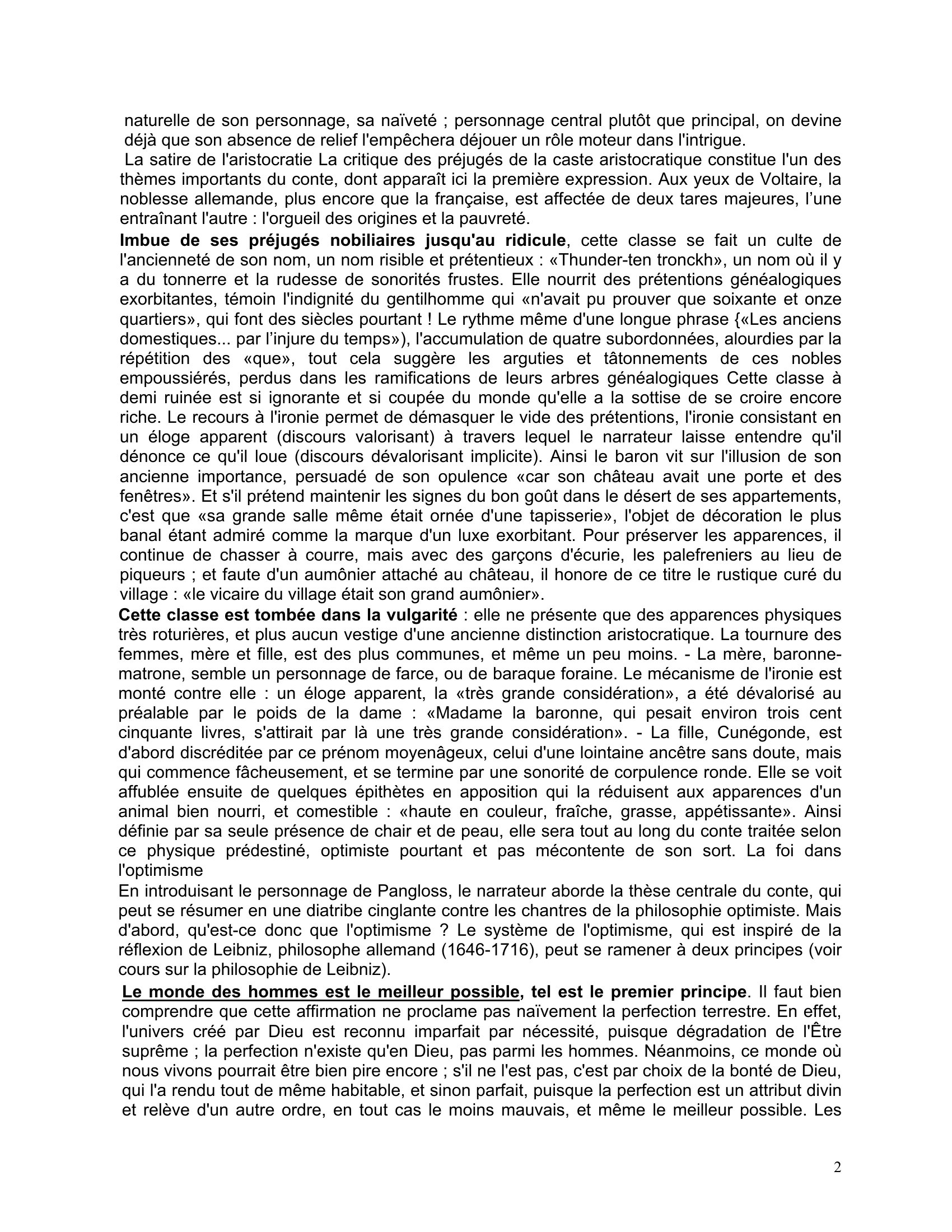CANDIDE DE VOLTAIRE: Du début du conte à « tout est au mieux »
Publié le 18/06/2012
Extrait du document

L'enjeu du texte.
Ce chapitre remplit une fonction précise d'exposition en apportant au lecteur les trois données indispensables à la mise en route de l'oeuvre : des informations sur le personnage central Candide, d'autres sur le milieu social, celui d'une aristocratie engluée dans ses préjugés, d'autres enfin sur le thème directeur, la critique de l'optimisme incarné par Pangloss. Si l'on ajoute qu'un certain ton est adopté, qui sera maintenu jusqu'à la fin, on aura cerné l'enjeu multiple de ce début.
Candide, un personnage central un peu simplet.
Au début de l'oeuvre, la première interrogation du lecteur porte légitimement sur Candide, personnage éponyme. il est dépeint déjà par son nom, qui est un de ces noms-portraits dont l'étymologie (Pangloss), les sonorités (Vanderdendur [«vendeur-dent-dure«] le négociant esclavagiste) ou les connotations sémantiques (Candide) annoncent un caractère....

«
naturelle de son personnage, sa naïveté ; personnage central plutôt que principal, on devine
déjà que son absence de relief l'empêchera déjouer un rôle moteur dans l'intrigue.
La satire de l'aristocratie La critique des préjugés de la caste aristocratique constitue l'un des
thèmes importants du conte, dont apparaît ici la première expression.
Aux yeux de Voltaire, la
noblesse allemande, plus encore que la française, est affectée de deux tares majeures, l’une
entraînant l'autre : l'orgueil des origines et la pauvreté.
Imbue de ses préjugés nobiliaires jusqu'au ridicule , cette classe se fait un culte de
l'ancienneté de son nom, un nom risible et prétentieux : «Thunder-ten tronckh», un nom où il y
a du tonnerre et la rudesse de sonorités frustes.
Elle nourrit des prétentions généalogiques
exorbitantes, témoin l'indignité du gentilho mme qui «n'avait pu prouver que soixante et onze
quartiers», qui font des siècles pourtant ! Le rythme même d'une longue phrase {«Les anciens
domestiques...
par l’injure du temps»), l'accumulation de quatre subordonnées, alourdies par la
répétition des «que», tout cela suggère les arguties et tâtonnements de ces nobles
empoussiérés, perdus dans les ramifications de leurs arbres généalogiques Cette classe à
demi ruinée est si ignorante et si coupée du monde qu'elle a la sottise de se croire encore
riche.
Le recours à l'ironie permet de démasquer le vide des prétentions, l'ironie consistant en
un éloge apparent (discours valorisant) à traver s lequel le narrateur laisse entendre qu'il
dénonce ce qu'il loue (discours dévalorisant implicite).
Ainsi le baron vit sur l'illusion de son
ancienne importance, persuadé de son opulence «car son château avait une porte et des
fenêtres».
Et s'il prétend maintenir les signes du bon goût dans le désert de ses appartements,
c'est que «sa grande salle même était ornée d'une tapisserie», l'objet de décoration le plus
banal étant admiré comme la marque d'un luxe exorbitant.
Pour préserver les apparences, il
continue de chasser à courre, mais avec des garçons d'écurie, les palefreniers au lieu de
piqueurs ; et faute d'un aumônier attaché au château, il honore de ce titre le rustique curé du
village : «le vicaire du village était son grand aumônier».
Cette classe est tombée dans la vulgarité : elle ne présente que des apparences physiques
très roturières, et plus aucun vestige d'une ancienne distinction aristocratique.
La tournure des
femmes, mère et fille, est des plus communes, et même un peu moins.
- La mère, baronne-
matrone, semble un personnage de farce, ou de baraque foraine.
Le mécanisme de l'ironie est
monté contre elle : un éloge apparent, la «très grande consi\
dération», a été dévalorisé au
préalable par le poids de la dame : «Madame la baronne, qui pesait environ trois cent
cinquante livres, s'attirait par là une très grande considération».
- La fille, Cunégonde, est
d'abord discréditée par ce prénom moyenâgeux, celui d'une lointaine ancêtre sans doute, mais
qui commence fâcheusement, et se termine par une sonorité de corpulence ronde.
Elle se voit
affublée ensuite de quelques épithètes en apposition qui la réduisent aux apparences d'un
animal bien nourri, et comestible : «haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante».
Ainsi
définie par sa seule présence de chair et de peau, elle sera tout au long du conte traitée selon
ce physique prédestiné, optimiste pourtant et pas mécontente de son sort.
La foi dans
l'optimisme
En introduisant le personnage de Pangloss, le narrateur aborde la thèse centrale du conte, qui
peut se résumer en une diatribe cinglante contre les chantres de la philosophie optimiste.
Mais
d'abord, qu'est-ce donc que l'optimisme ? Le système de l'optimisme, qui est inspiré de la
réflexion de Leibniz, philosophe allemand (1646-1716) , peut se ramener à deux principes (voir
cours sur la philosophie de Leibniz).
Le monde des hommes est le meilleur possible
, tel est le premier principe.
Il faut bien
comprendre que cette affirmation ne proclame pas naïvement la perfection terrestre.
En effet,
l'univers créé par Dieu est reconnu imparfait par nécessité, puisque dégradation de l'Être
suprême ; la perfection n'existe qu'en Dieu, pas parmi les hommes.
Néanmoins, ce monde où
nous vivons pourrait être bien pire encore ; s'il ne l'est pas, c'est par choix \
de la bonté de Dieu,
qui l'a rendu tout de même habitable, et sinon parfait, puisque la perfection est un attribut divin
et relève d'un autre ordre, en tout cas le moins mauvais, et même le meilleur possible.
Les.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Nègre de Surinam - de Candide ou l’optimiste, un conte philosophique écrit par Voltaire en 1759
- Incipit de Candide, Voltaire Le texte que nous allons étudier se trouve au début du conte philosophique Candide de Voltaire.
- CANDIDE OU L’OPTIMISME Voltaire. Conte - résumé de l'oeuvre
- PANGLOSS. Personnage de Candide (1759), conte de Voltaire
- la conclusion du conte de Candide, voltaire