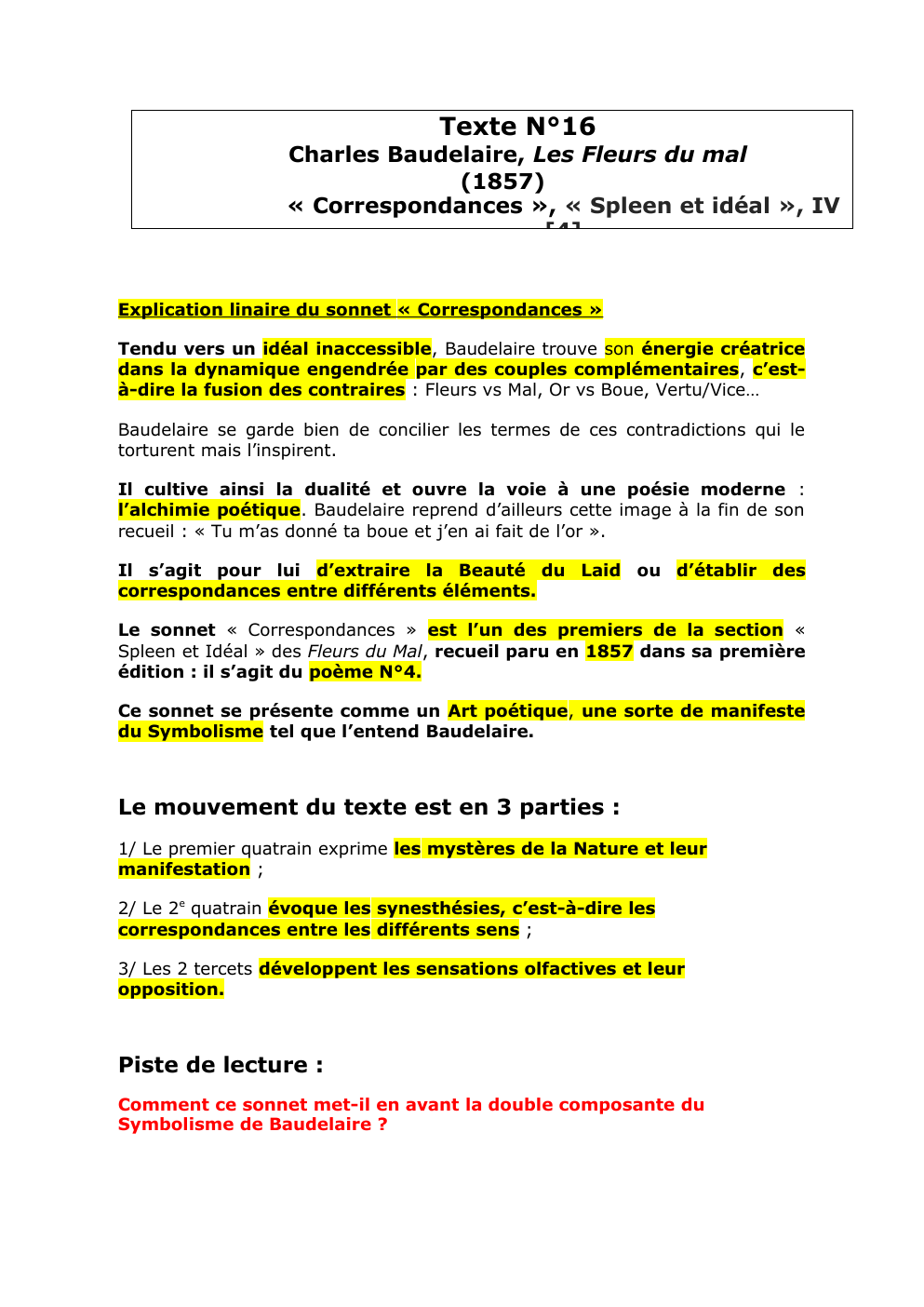Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal (1857) « Correspondances », « Spleen et idéal », IV
Publié le 24/09/2023
Extrait du document
«
Texte N°16
Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal
(1857)
« Correspondances », « Spleen et idéal », IV
[4]
Explication linaire du sonnet « Correspondances »
Tendu vers un idéal inaccessible, Baudelaire trouve son énergie créatrice
dans la dynamique engendrée par des couples complémentaires, c’està-dire la fusion des contraires : Fleurs vs Mal, Or vs Boue, Vertu/Vice…
Baudelaire se garde bien de concilier les termes de ces contradictions qui le
torturent mais l’inspirent.
Il cultive ainsi la dualité et ouvre la voie à une poésie moderne :
l’alchimie poétique.
Baudelaire reprend d’ailleurs cette image à la fin de son
recueil : « Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or ».
Il s’agit pour lui d’extraire la Beauté du Laid ou d’établir des
correspondances entre différents éléments.
Le sonnet « Correspondances » est l’un des premiers de la section «
Spleen et Idéal » des Fleurs du Mal, recueil paru en 1857 dans sa première
édition : il s’agit du poème N°4.
Ce sonnet se présente comme un Art poétique, une sorte de manifeste
du Symbolisme tel que l’entend Baudelaire.
Le mouvement du texte est en 3 parties :
1/ Le premier quatrain exprime les mystères de la Nature et leur
manifestation ;
2/ Le 2e quatrain évoque les synesthésies, c’est-à-dire les
correspondances entre les différents sens ;
3/ Les 2 tercets développent les sensations olfactives et leur
opposition.
Piste de lecture :
Comment ce sonnet met-il en avant la double composante du
Symbolisme de Baudelaire ?
Partie 1 :
Le sonnet s’ouvre sur une conception de la Nature (personnifiée avec un N
majuscule), au présent de vérité générale.
On trouve dès le vers 1 une première analogie entre la Nature et un
temple antique, sous la forme d’une métaphore in praesentia : « La
Nature est un temple où de vivants piliers » (c’est-à-dire les arbres ou les
colonnes) « Laissent parfois sortir de confuses paroles ».
Il s’agit pour l’homme d’interpréter les éléments naturels qui lui font signe, qui lui parlent et donnent au monde une certaine signification. En effet, le mouvement symboliste de la fin du XIXe siècle, dont Baudelaire est un précurseur, permet d’explorer, par l’expression artistique, l’invisible du monde en établissant des correspondances entre des éléments concrets et naturels et des éléments abstraits ou culturels, parfois porteurs d’une certaine spiritualité. Le mot « symbole », qui vient du grec « symbolon » dérivé du verbe de même famille qui signifie « mettre ensemble », est un objet matériel qui représente quelque chose d’autre par association d’idée, par ressemblance ou par convention. Ce mot « symbole » est d’ailleurs explicitement employé au vers 3 : « L’homme y passe à travers des forêts de symboles ». Ainsi, l’homme cherche à interpréter les signes ou les « confuses paroles » de la Nature, c’est-à- dire peu claires, qui nécessitent une médiation esthétique. On note que la Nature est bienveillante envers l’homme : ces « forêts de symboles […] l’observent avec des regards familiers ». On peut remarquer, comme premier type de correspondance, métaphores : « La Nature est un temple » et « des forêts de symboles ». les Dans ce premier quatrain, quelque peu énigmatique, la Nature est une allégorie du mystère qui entoure l’homme cherchant à lui donner du sens. Partie 2 : Le second quatrain débute par une comparaison auditive : « Comme de longs échos qui de loin se confondent/Dans une ténébreuse et profonde unité ». On retrouve ici la dualité de la comparaison (à travers l’analogie entre le comparé et le comparant) mais aussi le mystère propre à ces correspondances (comme l’indique l’adjectif « ténébreuse ») et l’unité à laquelle il faut parvenir (« les échos se confondent [c’est-à-dire se mêlent] dans une profonde unité. Le vers 8 annonce une idée chère à Baudelaire : l’importance des synesthésies, c’est-à-dire des correspondances entre les différentes informations sensorielles : « Les parfums, les couleurs et les.... »
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Etude linéaire - Spleen et Idéal, Les Fleurs du mal, Charles Baudelaire
- Moesta et Errabunda: Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal,« Spleen et Idéal »,LXII
- Charles Baudelaire (1821-1867) « Les fleurs du mal » « Spleen et Idéal »
- Commentaire de texte Correspondances : Fleurs du Mal - « Spleen et Idéal » (Baudelaire)
- Baudelaire, Correspondances, « Spleen et Idéal », Les Fleurs du Mal