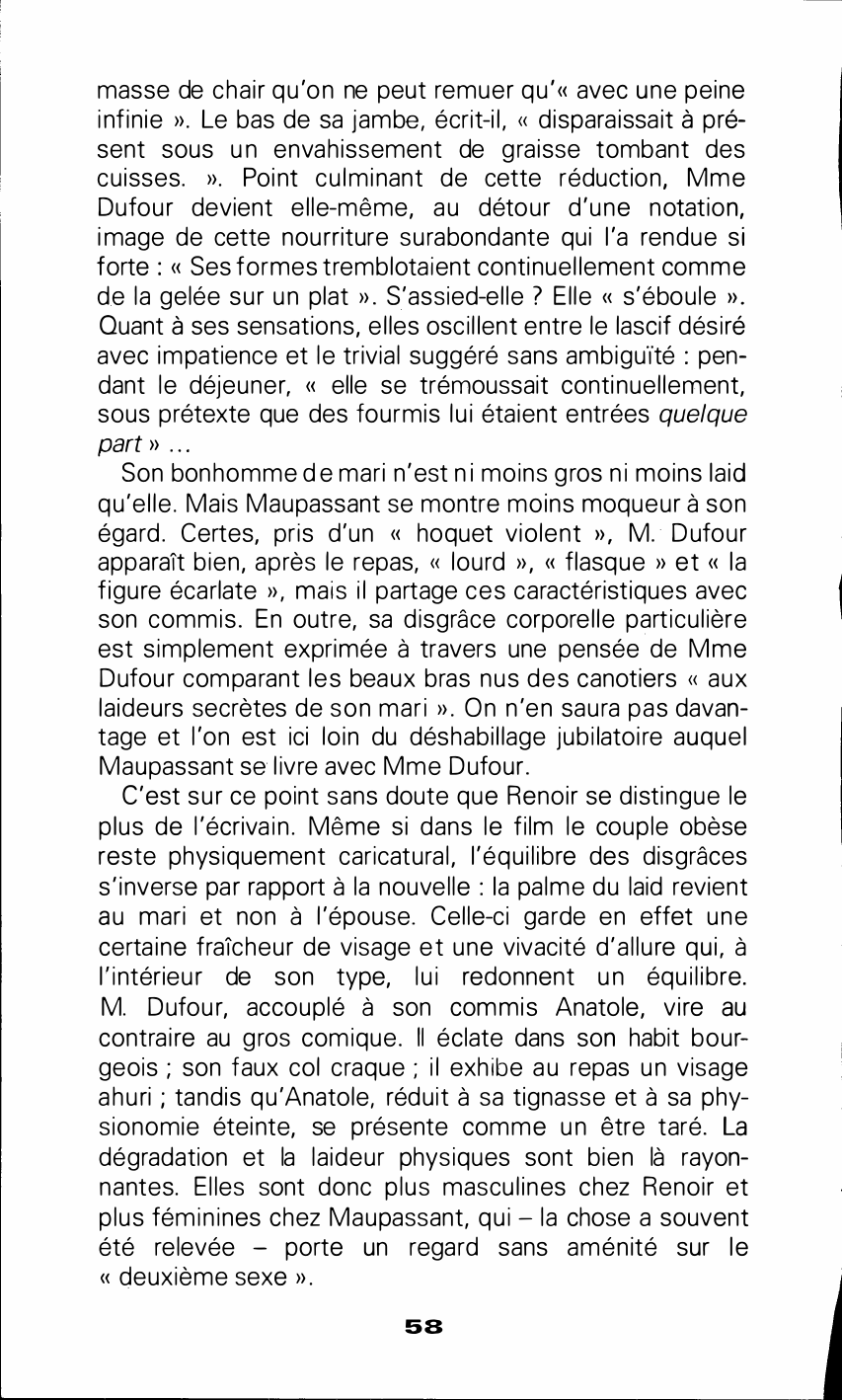Comique et dérision dans Une partie de Campagne (Maupassant et Renoir)
Publié le 05/12/2019

Extrait du document
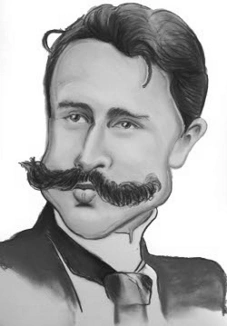
enfin ! » pour que le conteur ajoute : « Et sa femme, à ce signal, s'était attendrie sur la nature >> . Cette pique discrète suggère ainsi que Mme Dufour, en la circonstance, ne réagit pas à partir de sentiments éprouvés, mais à un signal, de façon entendue, en personne qui sait comment l'on ' se comporte en ville et dans la nature, côté caisse et côté rivière. D'autres détails vont dans le même sens : ainsi, considérant le restaurant Poulin, elle ne dit pas que la vue est plaisante, qu'il y a une belle vue, mais de façon figée : « Il y a de la vue ». Avoir de la vue apparaît ainsi comme une sorte de catégorie toute prête que le conformisme de Mme Dufour place quand elle est à la campagne.
Renoir surenchérit sur Maupassant. Dans son film, on observe en effet une expansion très significative de cette sorte de sottisier qui, soit dit en passant, n'est pas sans rappeler le célèbre Dictionnaire des idées reçues de Gustave Flaubert. Mme Dufour, bien entendu, tient sa partie avec quelques déclarations du genre : « Oh ! C'est salissant la campagne ! » ou encore, parlant avec sa fille de la possibilité qu'auraient les bêtes d'avoir des sentiments : « Mais non, voyons ; c'est pas comme les personnes ! Et puis elles sont bien trop petites ! >>. Mais M. Dufour se taille la part du lion, martelant souvent à l'usage de sa bête de commis, quelques maximes marquées au coin d'un énorme bon sens. Ainsi dit-il après plusieurs considérations prétentieuses sur la voracité du brochet : « La nature n'a pas encore livré à l'homme tous ses secrets ». Ou encore, dans un registre plus professionnel et toujours pour répondre à Anatole qui lui demande s'il sait nager : « Oui ! C'est-à-dire que j'ai su. Maintenant. j'ai oublié. Pour le commerce ça n'a pas d'importance>>.
On note ainsi que le film accuse plus fortement que la nouvelle cet aspect satirique, sans doute parce qu'il utilise davantage ledialogue.
LES FORMES DU COMIQUE
Le comique disséminé dans la nouvelle de Maupassant dépend directement de l'écriture. Certes, la situation classique du mari trompé entre pour quelque chose dans l'atmosphère parfois drolatique du texte ; mais les effets
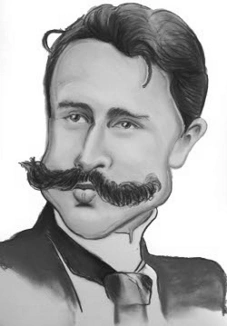
«
masse de
chair qu'on ne peut remuer qu'« avec une peine
in finie ».
Le bas de sa jamb e, écrit -il, « dis par aissa it à pr é
sent sous un envahissement de grais se tombant des
cuis ses.
».
Point culmin ant de cette réduction, Mme
Duf our devient elle-même, au détour d'une notation,
im age de cette nourriture surabondan te qui l'a rendue si
for te : « Ses formes tremblo tai ent conti nuellement comme
de la gelée sur un plat ».
S'assi ed-e l le? Elle « s'éb oule ».
Quant à ses sensati ons, elles oscillent entre le lascif désiré
avec impatience et le trivia l suggér é sans ambigu ïté : pen
dant le déjeuner , « elle se trémoussait continuellem ent,
sous prétexte que des fourmis lui étaient entrées quelque
part » ...
Son bonhomme de mari n'est ni moins gros ni moins laid
qu' elle.
Mais Maup assant se mo ntre moins moqueur à son
éga rd.
Cer tes, pris d'un « hoque t violent », M.
Dufour
appar aît bien, après le repas, « lour d », « flasq ue » et « la
figur e éca rlate », mais il par tage ces caractéris tiques avec
son commis.
En outre, sa disgr âce corpor elle particul ière
est simpl ement exprimée à travers une pensée de Mme
Du four com parant les beaux br as nus des cano tiers « aux
laideur s secr ètes de son mari ».
On n'en saura pas davan
tage et l'on est ici loin du déshabi llage jubilatoire auquel
Maup assant se livr e avec Mme Du four.
C'e st sur ce point sans doute que Renoir se distingue le
plus de l'écriv ain.
Même si dans le film le couple obèse
reste physiqu ement caricatur al, l'équilib re des disgr âces
s'i nver se par ra ppor t à la nouv elle : la pa lme du laid revient
au mari et non à l'épouse.
Celle-ci ga rde en effet une
ce rta ine fraî cheur de visage et une vivacité d'allure qui, à
l'in térie ur de son type, lui redonnent un équilib re.
M.
Dufour, acc ouplé à son commis Anatole, vire au
contr aire au gros com ique.
Il écla te dans son habit bour
geois ; son faux col craque ; il exh ibe au repas un visage
ahur i ; tandis qu'Anat ole, réduit à sa tignasse et à sa phy
sionomie éteinte, se prése nte com me un être taré.
La
dégr adation et la laideur physiques sont bien là rayon
nan tes.
Elles sont donc plus mascu lines che z Renoir et
plus fémin ines che z Maup assant, qui -la chose a souvent
été relevée -por te un rega rd sans aménité sur le
« deuxième sexe».
58.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L' impressionnisme chez Maupassant et Renoir dans Une partie de Campagne (Maupassant et Renoir)
- Adaptation ou création ? dans Une partie de Campagne (Maupassant et Renoir)
- Analyse comparée de la rencontre finale dans Une partie de Campagne (Maupassant et Renoir)
- Résumés en parallèle dans Une partie de Campagne (Maupassant et Renoir)
- Les personnages dans Une partie de Campagne (Maupassant et Renoir)