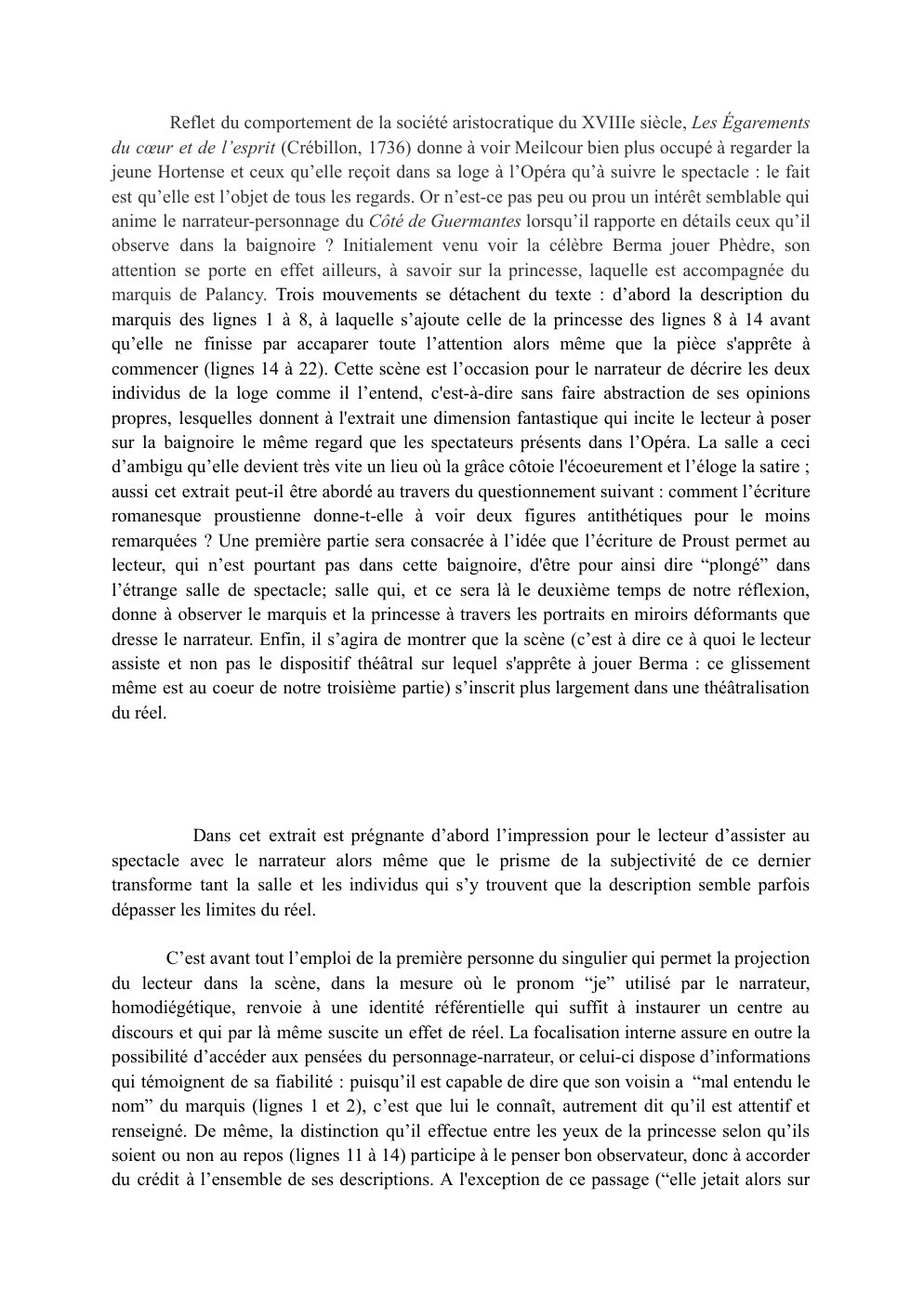commentaire composé Du coté de Guermantes, Proust
Publié le 23/07/2025
Extrait du document
«
Reflet du comportement de la société aristocratique du XVIIIe siècle, Les Égarements
du cœur et de l’esprit (Crébillon, 1736) donne à voir Meilcour bien plus occupé à regarder la
jeune Hortense et ceux qu’elle reçoit dans sa loge à l’Opéra qu’à suivre le spectacle : le fait
est qu’elle est l’objet de tous les regards.
Or n’est-ce pas peu ou prou un intérêt semblable qui
anime le narrateur-personnage du Côté de Guermantes lorsqu’il rapporte en détails ceux qu’il
observe dans la baignoire ? Initialement venu voir la célèbre Berma jouer Phèdre, son
attention se porte en effet ailleurs, à savoir sur la princesse, laquelle est accompagnée du
marquis de Palancy.
Trois mouvements se détachent du texte : d’abord la description du
marquis des lignes 1 à 8, à laquelle s’ajoute celle de la princesse des lignes 8 à 14 avant
qu’elle ne finisse par accaparer toute l’attention alors même que la pièce s'apprête à
commencer (lignes 14 à 22).
Cette scène est l’occasion pour le narrateur de décrire les deux
individus de la loge comme il l’entend, c'est-à-dire sans faire abstraction de ses opinions
propres, lesquelles donnent à l'extrait une dimension fantastique qui incite le lecteur à poser
sur la baignoire le même regard que les spectateurs présents dans l’Opéra.
La salle a ceci
d’ambigu qu’elle devient très vite un lieu où la grâce côtoie l'écoeurement et l’éloge la satire ;
aussi cet extrait peut-il être abordé au travers du questionnement suivant : comment l’écriture
romanesque proustienne donne-t-elle à voir deux figures antithétiques pour le moins
remarquées ? Une première partie sera consacrée à l’idée que l’écriture de Proust permet au
lecteur, qui n’est pourtant pas dans cette baignoire, d'être pour ainsi dire “plongé” dans
l’étrange salle de spectacle; salle qui, et ce sera là le deuxième temps de notre réflexion,
donne à observer le marquis et la princesse à travers les portraits en miroirs déformants que
dresse le narrateur.
Enfin, il s’agira de montrer que la scène (c’est à dire ce à quoi le lecteur
assiste et non pas le dispositif théâtral sur lequel s'apprête à jouer Berma : ce glissement
même est au coeur de notre troisième partie) s’inscrit plus largement dans une théâtralisation
du réel.
Dans cet extrait est prégnante d’abord l’impression pour le lecteur d’assister au
spectacle avec le narrateur alors même que le prisme de la subjectivité de ce dernier
transforme tant la salle et les individus qui s’y trouvent que la description semble parfois
dépasser les limites du réel.
C’est avant tout l’emploi de la première personne du singulier qui permet la projection
du lecteur dans la scène, dans la mesure où le pronom “je” utilisé par le narrateur,
homodiégétique, renvoie à une identité référentielle qui suffit à instaurer un centre au
discours et qui par là même suscite un effet de réel.
La focalisation interne assure en outre la
possibilité d’accéder aux pensées du personnage-narrateur, or celui-ci dispose d’informations
qui témoignent de sa fiabilité : puisqu’il est capable de dire que son voisin a “mal entendu le
nom” du marquis (lignes 1 et 2), c’est que lui le connaît, autrement dit qu’il est attentif et
renseigné.
De même, la distinction qu’il effectue entre les yeux de la princesse selon qu’ils
soient ou non au repos (lignes 11 à 14) participe à le penser bon observateur, donc à accorder
du crédit à l’ensemble de ses descriptions.
A l'exception de ce passage (“elle jetait alors sur
lui un regard de ses beaux yeux taillés dans un diamant que semblaient bien fluidifier, à ces
moments-là, l’intelligence et l’amitié, mais qui, quand ils étaient au repos […]) qui repose sur
une différenciation entre le temps du récit et celui de la scène (“à ces moments-là” et “quand
ils étaient au repos” renvoient à deux temporalités distinctes que le narrateur rapporte
simultanément), à l'exception de ce passage donc, l’extrait est construit sur ce que Gérard
Genette appelle le “mode de la scène”, soit l’illusion d’une coïncidence temporelle parfaite
entre notre lecture et le déroulement de ce que nous lisons.
Cette illusion est d’autant plus
forte ici que les verbes au passé simple (“vint” ligne 15, “vis” ligne 17, “apparut” ligne 19,
entre autres) sont marqués de l’aspect inaccompli propre à donner une impression de “direct”.
Lesdits verbes participent par ailleurs à changer le rythme de la phrase (l’accélère), de telle
sorte que celui-ci se fait miroir des émotions du narrateur, qui, d’une certaine manière, nous
prête son regard, en l'occurrence fasciné.
Les yeux du lecteur suivent en somme le même
déplacement progressif que ceux du narrateur : observant d’abord le marquis des lignes 1 à 9,
notre attention est déviée sur l'interaction (ou l’absence de) entre lui et la princesse des lignes
9 à 11 , pour finalement ne voir plus qu’elle jusqu’à la fin de l’extrait ; le lecteur assiste donc
strictement au même spectacle que le narrateur.
Et quel spectacle !
La description qui est faite des deux personnages leur confère à chacun une aura certes
bien différente, nous y reviendrons, mais, du reste, il se dégage de l’ensemble l’impression
générale d’un réel aux portes du fantastique.
La princesse, par exemple, a des yeux “taillés
dans un diamant” (ligne 11), ce qui, d’abord, souligne leur beauté hors-norme, et qui, ensuite,
n’est pas sans faire écho aux sculptures (par le verbe “tailler”), lesquelles étaient initialement
érigées en l’honneur d’une divinité et cette idée de quasi-divinisation est renforcée par la
comparaison de la princesse à une “néréide” ligne 19.
La splendeur de ce personnage (du
moins celle que le narrateur lui accorde) est également perceptible à travers l’évocation des
“feux inhumains” (fruits de son regard) à la ligne 14, ainsi que par la récurrence d’adjectifs
laudatifs hyperboliques tels que “splendides” (ligne 14), “merveilleuse” (ligne 20),
“immense” (ligne 22) … Plus encore peut être que l’aspect divin de la princesse, la
transformation de la salle en aquarium et, avec elle, celle du marquis en poisson, donnent à ce
spectacle une dimension fantastique.
La première occurence de cette métamorphose marine
survient dès la ligne 5 avec la comparaison du marquis à “un poisson qui passe” et dont “le
verre du monocle” (ligne 4) devient “la cloison vitrée d’un aquarium” (ligne 6).
L’ensemble
du texte est ensuite marqué du sceau de cette métamorphose (qu’on peut donc qualifiée de
“suivie”) dans la mesure où on trouve un effet de récurrence syntagmatique d’un même sème
avec les mots “”nageait” (ligne 7), “baignoire” (ligne 9), “fluidifier” (ligne 11), le “monde
des eaux” (ligne 18), “néréide” (ligne 19) ...
Parmi eux, le mot “baignoire”, précisément, fait
office d’embrayeur d’isotopie, c’est à dire qu’il est un pivot, en tant que terme polysémique,
permettant l’association de plusieurs isotopies et assurant ainsi un relais entre l’espace
comparé et l’espace comparant ainsi que la cohérence sémantique du texte.
L’eau qui déjà faisait se déformer (plus exactement se casser) le bâton de Descartes par
réfraction semble ici aussi avoir pour conséquence la déformation de la réalité eu égard au
portrait que le narrateur dresse du marquis puis de la princesse.
Tous deux soumis à la
subjectivité de qui les regarde et les décrit, ils ne jouissent cependant pas du même biais de
vision, voire sont présentés de manière opposée, physiquement d’abord,
comportementalement ensuite.
La description des personnages est éminemment partiale, le narrateur ne cache
d’ailleurs pas sa jalousie à l’égard du marquis (l’exagère même, avec la formule hyperbolique
“Personne n’excitait en moi autant d’envie que lui” ligne 8) ce qui du même coup souligne
son attirance pour la princesse.
Le tour de force de Proust consiste ainsi en cette capacité à
faire cohabiter le meilleur et le pire en créant un contraste entre ce qui s’apparente à une
célébration d’un côté et à un portrait à charge de l’autre.
La périphrase par laquelle est
désigné le marquis pour la première fois, “ce gros-là” (ligne 1), non seulement le réduit à son
physique, mais en plus le déprécie, et ce d’autant plus que le qualificatif “gros”, vecteur sinon
de dégoût du moins de mépris, est de nouveau utilisé pour qualifier son oeil à la ligne 3 (“son
gros oeil rond collé contre le verre du monocle”).
Par opposition, les yeux de la princesse
sont, comme nous l’avons déjà relevé, “taillés dans un diamant” (ligne 11) et même la....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire composé : la sonate de Vinteuil dans Un amour de Swann de Proust (p. 33 à 35: de« L'année précédente dans une soirée |...] » à « dont il ignore jusqu'au nom ».)
- Vous présenterez de ce texte un commentaire composé. Vous pourrez par exemple étudier l'art de Proust, metteur en scène; montrer comment rythme, cadrage, proximité ou éloignement contribuent à renforcer la satire sociale.
- Marcel Proust, A la Recherche du Temps perdu. Dans un commentaire composé que vous organiserez à votre gré, vous pourrez, en particulier, montrer comment Proust renouvelle le genre descriptif en transformant une flânerie de touriste en une féerie ininterrompue.
- Commentaire d'un extrait de Marcel Proust, Du côté de Guermantes
- M. Proust, A l'ombre des jeunes filles en fleurs. Vous ferez de ce texte un commentaire composé. Vous pourrez montrer par exemple, comment le réalisme et le fantastique caricatural s'unissent dans la vision que Proust prête aux spectateurs.