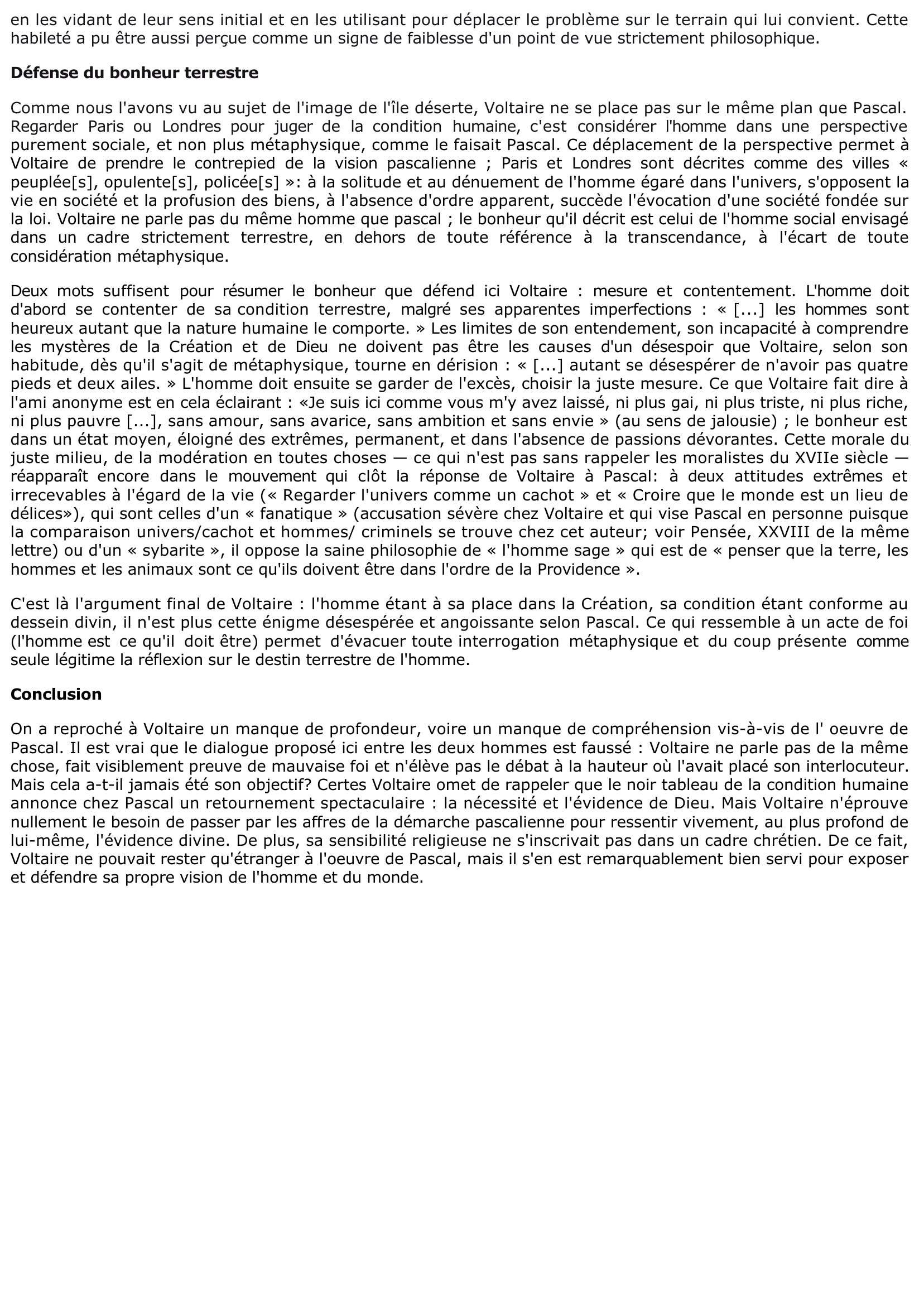COMMENTAIRE COMPOSÉ : Lettre XXV, Sur les Pensées de M. Pascal
Publié le 22/02/2012

Extrait du document


«
en les vidant de leur sens initial et en les utilisant pour déplacer le problème sur le terrain qui lui convient.
Cettehabileté a pu être aussi perçue comme un signe de faiblesse d'un point de vue strictement philosophique.
Défense du bonheur terrestre
Comme nous l'avons vu au sujet de l'image de l'île déserte, Voltaire ne se place pas sur le même plan que Pascal.Regarder Paris ou Londres pour juger de la condition humaine, c'est considérer l'homme dans une perspectivepurement sociale, et non plus métaphysique, comme le faisait Pascal.
Ce déplacement de la perspective permet àVoltaire de prendre le contrepied de la vision pascalienne ; Paris et Londres sont décrites comme des villes «peuplée[s], opulente[s], policée[s] »: à la solitude et au dénuement de l'homme égaré dans l'univers, s'opposent lavie en société et la profusion des biens, à l'absence d'ordre apparent, succède l'évocation d'une société fondée surla loi.
Voltaire ne parle pas du même homme que pascal ; le bonheur qu'il décrit est celui de l'homme social envisagédans un cadre strictement terrestre, en dehors de toute référence à la transcendance, à l'écart de touteconsidération métaphysique.
Deux mots suffisent pour résumer le bonheur que défend ici Voltaire : mesure et contentement.
L'homme doitd'abord se contenter de sa condition terrestre, malgré ses apparentes imperfections : « [...] les hommes sontheureux autant que la nature humaine le comporte.
» Les limites de son entendement, son incapacité à comprendreles mystères de la Création et de Dieu ne doivent pas être les causes d'un désespoir que Voltaire, selon sonhabitude, dès qu'il s'agit de métaphysique, tourne en dérision : « [...] autant se désespérer de n'avoir pas quatrepieds et deux ailes.
» L'homme doit ensuite se garder de l'excès, choisir la juste mesure.
Ce que Voltaire fait dire àl'ami anonyme est en cela éclairant : «Je suis ici comme vous m'y avez laissé, ni plus gai, ni plus triste, ni plus riche,ni plus pauvre [...], sans amour, sans avarice, sans ambition et sans envie » (au sens de jalousie) ; le bonheur estdans un état moyen, éloigné des extrêmes, permanent, et dans l'absence de passions dévorantes.
Cette morale dujuste milieu, de la modération en toutes choses — ce qui n'est pas sans rappeler les moralistes du XVIIe siècle —réapparaît encore dans le mouvement qui clôt la réponse de Voltaire à Pascal: à deux attitudes extrêmes etirrecevables à l'égard de la vie (« Regarder l'univers comme un cachot » et « Croire que le monde est un lieu dedélices»), qui sont celles d'un « fanatique » (accusation sévère chez Voltaire et qui vise Pascal en personne puisquela comparaison univers/cachot et hommes/ criminels se trouve chez cet auteur; voir Pensée, XXVIII de la mêmelettre) ou d'un « sybarite », il oppose la saine philosophie de « l'homme sage » qui est de « penser que la terre, leshommes et les animaux sont ce qu'ils doivent être dans l'ordre de la Providence ».
C'est là l'argument final de Voltaire : l'homme étant à sa place dans la Création, sa condition étant conforme audessein divin, il n'est plus cette énigme désespérée et angoissante selon Pascal.
Ce qui ressemble à un acte de foi(l'homme est ce qu'il doit être) permet d'évacuer toute interrogation métaphysique et du coup présente commeseule légitime la réflexion sur le destin terrestre de l'homme.
Conclusion
On a reproché à Voltaire un manque de profondeur, voire un manque de compréhension vis-à-vis de l' oeuvre dePascal.
Il est vrai que le dialogue proposé ici entre les deux hommes est faussé : Voltaire ne parle pas de la mêmechose, fait visiblement preuve de mauvaise foi et n'élève pas le débat à la hauteur où l'avait placé son interlocuteur.Mais cela a-t-il jamais été son objectif? Certes Voltaire omet de rappeler que le noir tableau de la condition humaineannonce chez Pascal un retournement spectaculaire : la nécessité et l'évidence de Dieu.
Mais Voltaire n'éprouvenullement le besoin de passer par les affres de la démarche pascalienne pour ressentir vivement, au plus profond delui-même, l'évidence divine.
De plus, sa sensibilité religieuse ne s'inscrivait pas dans un cadre chrétien.
De ce fait,Voltaire ne pouvait rester qu'étranger à l'oeuvre de Pascal, mais il s'en est remarquablement bien servi pour exposeret défendre sa propre vision de l'homme et du monde..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire composé : Pascal Pensées (1670 posth) : « comme un homme qu’on aurait porté endormi sur une île déserte et effroyable et qui s’éveillerait »
- LETTRE XXV: Sur les Pensées de M. Pascal (Lettres philosophiques de Voltaire)
- Les Pensées (commentaire) de BLAISE PASCAL : Imagination, maîtresse d'erreur et de fausseté.
- commentaire composé les lettre persanne
- Commentaire de texte Pascal, Les Pensées