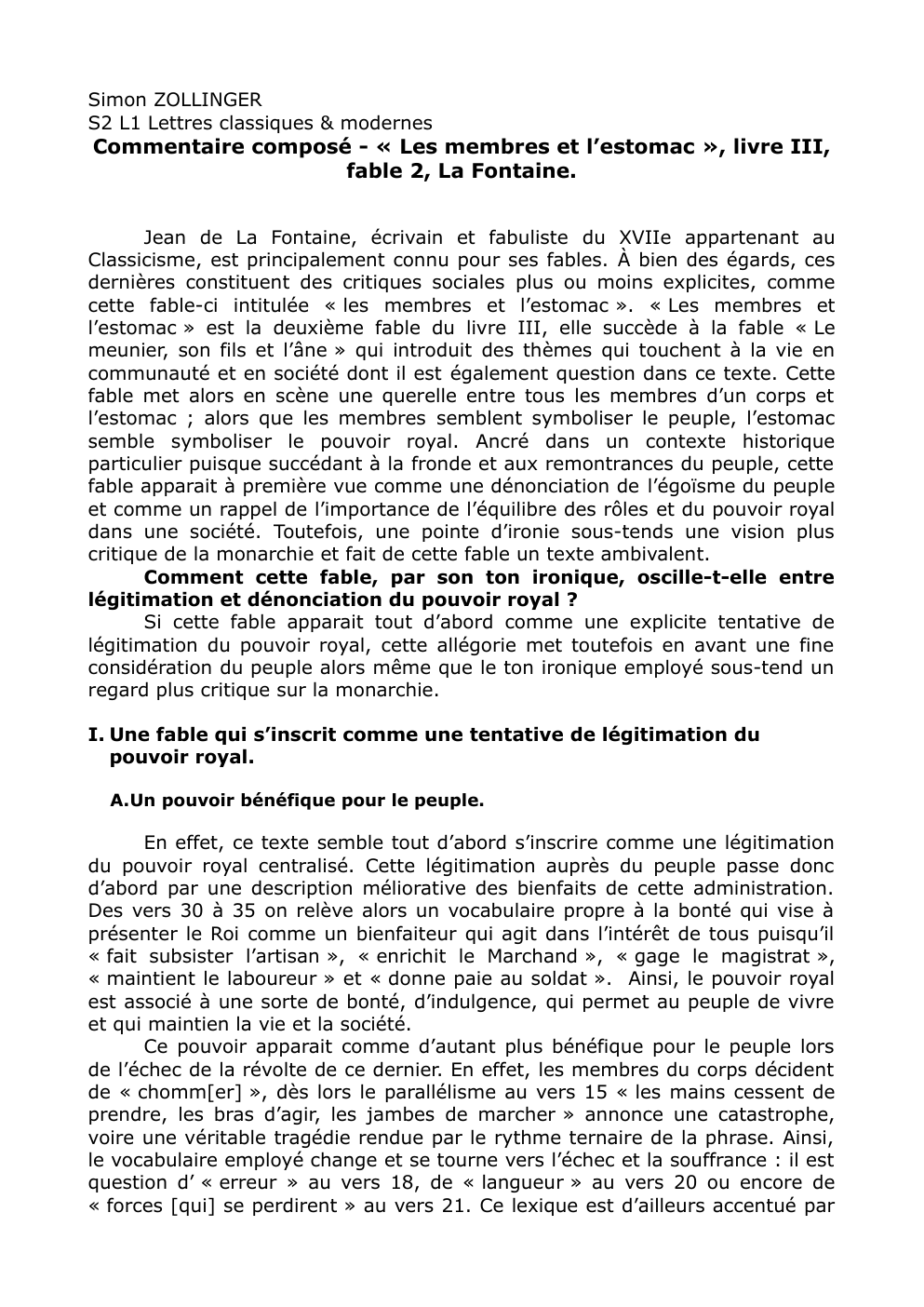Commentaire composé sur le fable "Les Membres et l'Estomac" de La Fontaine.
Publié le 03/03/2025
Extrait du document
«
S2 L1 Lettres classiques & modernes
Commentaire composé - « Les membres et l’estomac », livre III,
fable 2, La Fontaine.
Jean de La Fontaine, écrivain et fabuliste du XVIIe appartenant au
Classicisme, est principalement connu pour ses fables.
À bien des égards, ces
dernières constituent des critiques sociales plus ou moins explicites, comme
cette fable-ci intitulée « les membres et l’estomac ».
« Les membres et
l’estomac » est la deuxième fable du livre III, elle succède à la fable « Le
meunier, son fils et l’âne » qui introduit des thèmes qui touchent à la vie en
communauté et en société dont il est également question dans ce texte.
Cette
fable met alors en scène une querelle entre tous les membres d’un corps et
l’estomac ; alors que les membres semblent symboliser le peuple, l’estomac
semble symboliser le pouvoir royal.
Ancré dans un contexte historique
particulier puisque succédant à la fronde et aux remontrances du peuple, cette
fable apparait à première vue comme une dénonciation de l’égoïsme du peuple
et comme un rappel de l’importance de l’équilibre des rôles et du pouvoir royal
dans une société.
Toutefois, une pointe d’ironie sous-tends une vision plus
critique de la monarchie et fait de cette fable un texte ambivalent.
Comment cette fable, par son ton ironique, oscille-t-elle entre
légitimation et dénonciation du pouvoir royal ?
Si cette fable apparait tout d’abord comme une explicite tentative de
légitimation du pouvoir royal, cette allégorie met toutefois en avant une fine
considération du peuple alors même que le ton ironique employé sous-tend un
regard plus critique sur la monarchie.
I.
Une fable qui s’inscrit comme une tentative de légitimation du
pouvoir royal.
A.Un pouvoir bénéfique pour le peuple.
En effet, ce texte semble tout d’abord s’inscrire comme une légitimation
du pouvoir royal centralisé.
Cette légitimation auprès du peuple passe donc
d’abord par une description méliorative des bienfaits de cette administration.
Des vers 30 à 35 on relève alors un vocabulaire propre à la bonté qui vise à
présenter le Roi comme un bienfaiteur qui agit dans l’intérêt de tous puisqu’il
« fait subsister l’artisan », « enrichit le Marchand », « gage le magistrat »,
« maintient le laboureur » et « donne paie au soldat ».
Ainsi, le pouvoir royal
est associé à une sorte de bonté, d’indulgence, qui permet au peuple de vivre
et qui maintien la vie et la société.
Ce pouvoir apparait comme d’autant plus bénéfique pour le peuple lors
de l’échec de la révolte de ce dernier.
En effet, les membres du corps décident
de « chomm[er] », dès lors le parallélisme au vers 15 « les mains cessent de
prendre, les bras d’agir, les jambes de marcher » annonce une catastrophe,
voire une véritable tragédie rendue par le rythme ternaire de la phrase.
Ainsi,
le vocabulaire employé change et se tourne vers l’échec et la souffrance : il est
question d’ « erreur » au vers 18, de « langueur » au vers 20 ou encore de
« forces [qui] se perdirent » au vers 21.
Ce lexique est d’ailleurs accentué par
S2 L1 Lettres classiques & modernes
l’utilisation de formes négatives, particulièrement au vers 20 qui précise « il ne
se forma plus de nouveau sang au coeur » et associe ainsi directement
l’éviction du pouvoir royal à la mort et à la faillite de la société.
Par ces
procédés, l’auteur nous montre la nécessité de ce pouvoir mais surtout les
bienfaits qu’il engendre pour le peuple.
Ainsi, cette fable s’inscrit d’abord comme une tentative de légitimation
du pouvoir royal dans la mesure où elle donne à voir les bénéfices que le
peuple gagne à obéir : qu’il s’agisse de moyens de subsistance ou d’un
équilibre plus global.
A.Un pouvoir mesuré.
Mais cette fable s’inscrit aussi comme une légitimation du pouvoir royal
dans la mesure où elle cherche à donner de celui-ci une image de mesure,
d’équilibre et d’égalité.
Il s’agit alors de montrer le pouvoir royal comme
porteur d’une juste rétribution et garant d’un ordre, d’une stabilité.
Ainsi,
l’antithèse au vers 25 qui articule « elle reçoit » et « elle donne » vient opposer
les deux termes afin de présenter le pouvoir royal comme un système complet
et sain.
De la même manière, au vers suivant, on oppose le pronom « tout »
au pronom « elle » pour montrer que le travail de tout un peuple est dévoué à
ce pouvoir mais surtout pour souligner la réciprocité (le terme est directement
utilisé) de cette dévotion : le peuple donne mais le roi tout autant.
La monarchie semble si sensible à ce maintien de l’ordre, de l’équilibre et
de la stabilité qu’elle participerait même davantage que le peuple lui-même à
son propre bien-être, en témoigne la rime pauvre qui articule aux vers 24 et
25 « Que celui qu’ils croyaient oisifs et paresseux, à l’intérêt commun
contribuait plus qu’eux » qui présente la monarchie comme plus soucieuse de
l’intérêt commun mais surtout plus active de ce bien commun.
Ainsi, cette fable s’inscrit également comme une tentative de légitimation
du pouvoir royal dans la mesure où elle présente cette administration comme
garante d’un ordre, d’une organisation, d’un équilibre et d’une stabilité saine
pour la société.
II.
Une allégorie qui montre toutefois une fine compréhension du
peuple.
A.
Un fabuliste adopte le point de vue populaire.
Toutefois, l’ambiguïté du texte se dessine lorsque que l’on prête un peu
plus attention au point de vue du fabuliste.
En effet, dans cette fable, il est
question avant tout du peuple qui constitue le sujet du texte, l’acteur principal
de la fable (là où d’ailleurs le pouvoir royal métaphorisé en estomac est pointé
du doigt pour sa passivité).
En effet, l’impératif utilisé au vers 13
« Chommons » caractérise bien cette activité et cette initiative du peuple, tout
autant que le parallélisme « ainsi dit, ainsi fait » au vers 11 qui, par le
contraste entre dire et faire, montre la valeur performative du langage du
peuple et donc sa capacité à s’ancrer dans la société par des actes et des faits.
S2 L1 Lettres classiques & modernes
Ainsi, cette fable semble, malgré son éloge du pouvoir royal, afficher une fine
considération du peuple.
De la même manière, on remarque que le point de vue narratif interne
employé par le fabuliste semble l’inclure dans la masse du peuple : en
témoigne les marques de la première personne du pluriel des vers 10 à 12
telles que « Nous suons, nous peinons », « nous n’en profitons pas » ou encore
« notre soin n’aboutit qu’a fournir ses repas ».
Ainsi, le fabuliste lui-même
semble porteur d’un autre point de vue : celui du peuple avec lequel s’instaure
une sorte de complicité.
Cette fable, bien que d’abord tournée vers une légitimation du pouvoir
royal semble donc également, par le point de vue narratif....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire composé d'une fable de la Fontaine. Le Villageois et le Serpent
- Commentaire composé sur la Fable « Le philosophe Scythe » De Jean de La Fontaine
- Commentaire composé "L'ermite" de Jean de la Fontaine
- Lecture Analytique "Les Membres et l'Estomac" de Jean de La Fontaine
- Commentaire composé sur la fable des "animaux malades de la peste"