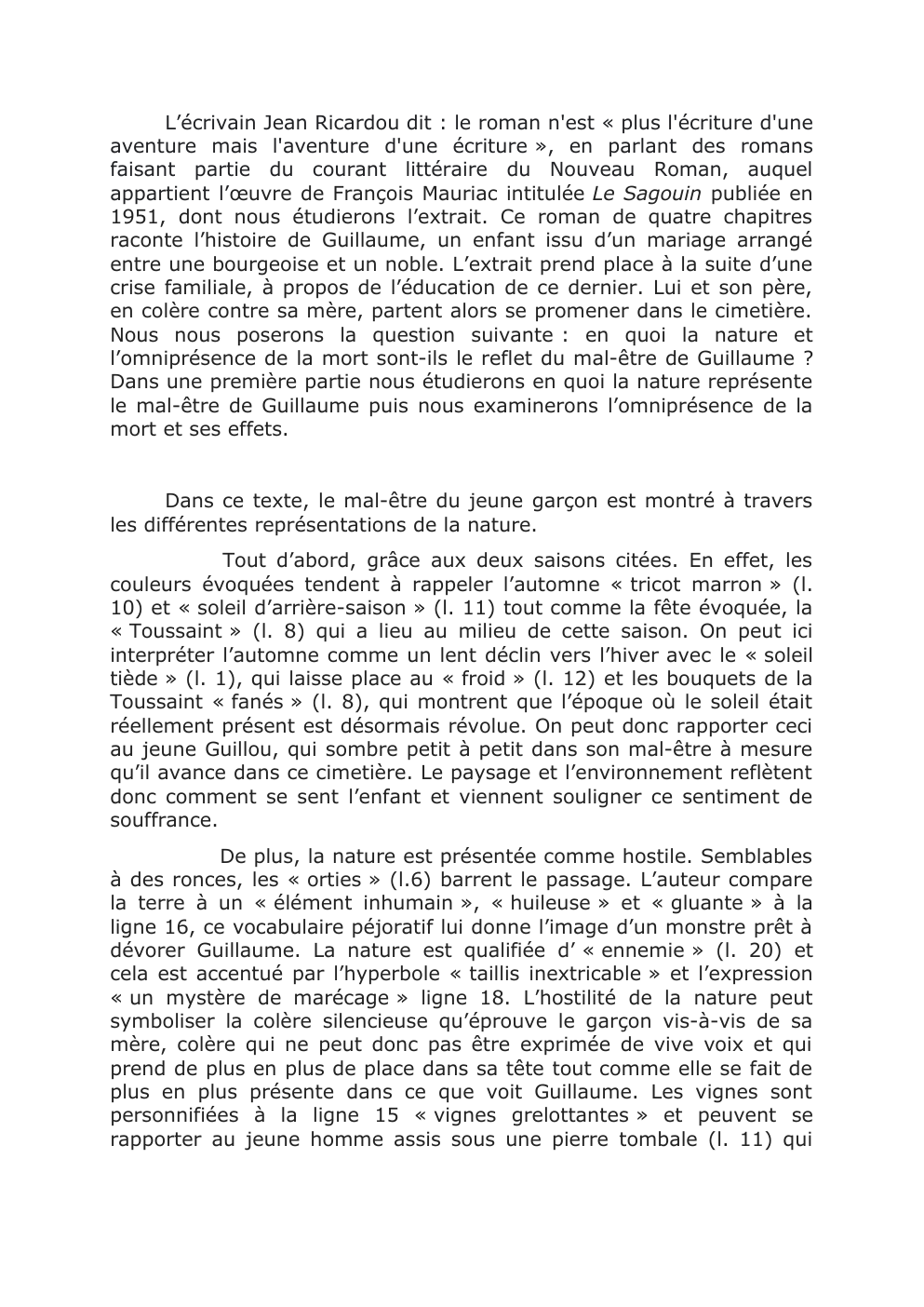Commentaire de texte: Le Sagouin de François Mauriac
Publié le 30/12/2022
Extrait du document
«
L’écrivain Jean Ricardou dit : le roman n'est « plus l'écriture d'une
aventure mais l'aventure d'une écriture », en parlant des romans
faisant partie du courant littéraire du Nouveau Roman, auquel
appartient l’œuvre de François Mauriac intitulée Le Sagouin publiée en
1951, dont nous étudierons l’extrait.
Ce roman de quatre chapitres
raconte l’histoire de Guillaume, un enfant issu d’un mariage arrangé
entre une bourgeoise et un noble.
L’extrait prend place à la suite d’une
crise familiale, à propos de l’éducation de ce dernier.
Lui et son père,
en colère contre sa mère, partent alors se promener dans le cimetière.
Nous nous poserons la question suivante : en quoi la nature et
l’omniprésence de la mort sont-ils le reflet du mal-être de Guillaume ?
Dans une première partie nous étudierons en quoi la nature représente
le mal-être de Guillaume puis nous examinerons l’omniprésence de la
mort et ses effets.
Dans ce texte, le mal-être du jeune garçon est montré à travers
les différentes représentations de la nature.
Tout d’abord, grâce aux deux saisons citées.
En effet, les
couleurs évoquées tendent à rappeler l’automne « tricot marron » (l.
10) et « soleil d’arrière-saison » (l.
11) tout comme la fête évoquée, la
« Toussaint » (l.
8) qui a lieu au milieu de cette saison.
On peut ici
interpréter l’automne comme un lent déclin vers l’hiver avec le « soleil
tiède » (l.
1), qui laisse place au « froid » (l.
12) et les bouquets de la
Toussaint « fanés » (l.
8), qui montrent que l’époque où le soleil était
réellement présent est désormais révolue.
On peut donc rapporter ceci
au jeune Guillou, qui sombre petit à petit dans son mal-être à mesure
qu’il avance dans ce cimetière.
Le paysage et l’environnement reflètent
donc comment se sent l’enfant et viennent souligner ce sentiment de
souffrance.
De plus, la nature est présentée comme hostile.
Semblables
à des ronces, les « orties » (l.6) barrent le passage.
L’auteur compare
la terre à un « élément inhumain », « huileuse » et « gluante » à la
ligne 16, ce vocabulaire péjoratif lui donne l’image d’un monstre prêt à
dévorer Guillaume.
La nature est qualifiée d’ « ennemie » (l.
20) et
cela est accentué par l’hyperbole « taillis inextricable » et l’expression
« un mystère de marécage » ligne 18.
L’hostilité de la nature peut
symboliser la colère silencieuse qu’éprouve le garçon vis-à-vis de sa
mère, colère qui ne peut donc pas être exprimée de vive voix et qui
prend de plus en plus de place dans sa tête tout comme elle se fait de
plus en plus présente dans ce que voit Guillaume.
Les vignes sont
personnifiées à la ligne 15 « vignes grelottantes » et peuvent se
rapporter au jeune homme assis sous une pierre tombale (l.
11) qui
tremble de froid et semble s’éteindre lentement, au même titre que la
nature environnante.
L’auteur insiste ainsi sur la nature et ses différents aspects pour
en faire un portrait presque personnifié, à l’image de Guillou : souffrant
et vacillant vers la mort.
La nature prend des caractéristiques
humaines semblant appartenir au jeune garçon, l’ancrant d’autant plus
dans ce tableau douloureux.
François Mauriac insiste sur la présence de la mort dans ce récit,
en faisant une caractéristique omniprésente, non sans conséquences.
En premier lieu, l’endroit dans lequel se trouve Guillaume est
représentatif de la mort elle-même, puisque c’est un cimetière.
On y
retrouve un champ lexical relatif à la mort « cimetière », « tombes »,
« pierre tombale »,....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire de texte François Guizot - Du gouvernement représentatif de l'état actuel de la France (1816)
- Commentaire littéraire Thérèse Desqueyroux, François Mauriac Chapitre IV de « Ce dernier soir avant le retour au pays » à « déjà il se rapprochait.
- SAGOUIN (le), de François Mauriac
- Commentaire composé Incipit - Thérèse Desqueyroux – François Mauriac
- Commentaire composé du chapitre III du Baiser au lépreux de François Mauriac, éditions du Livre de poche, pages 51 à 57.