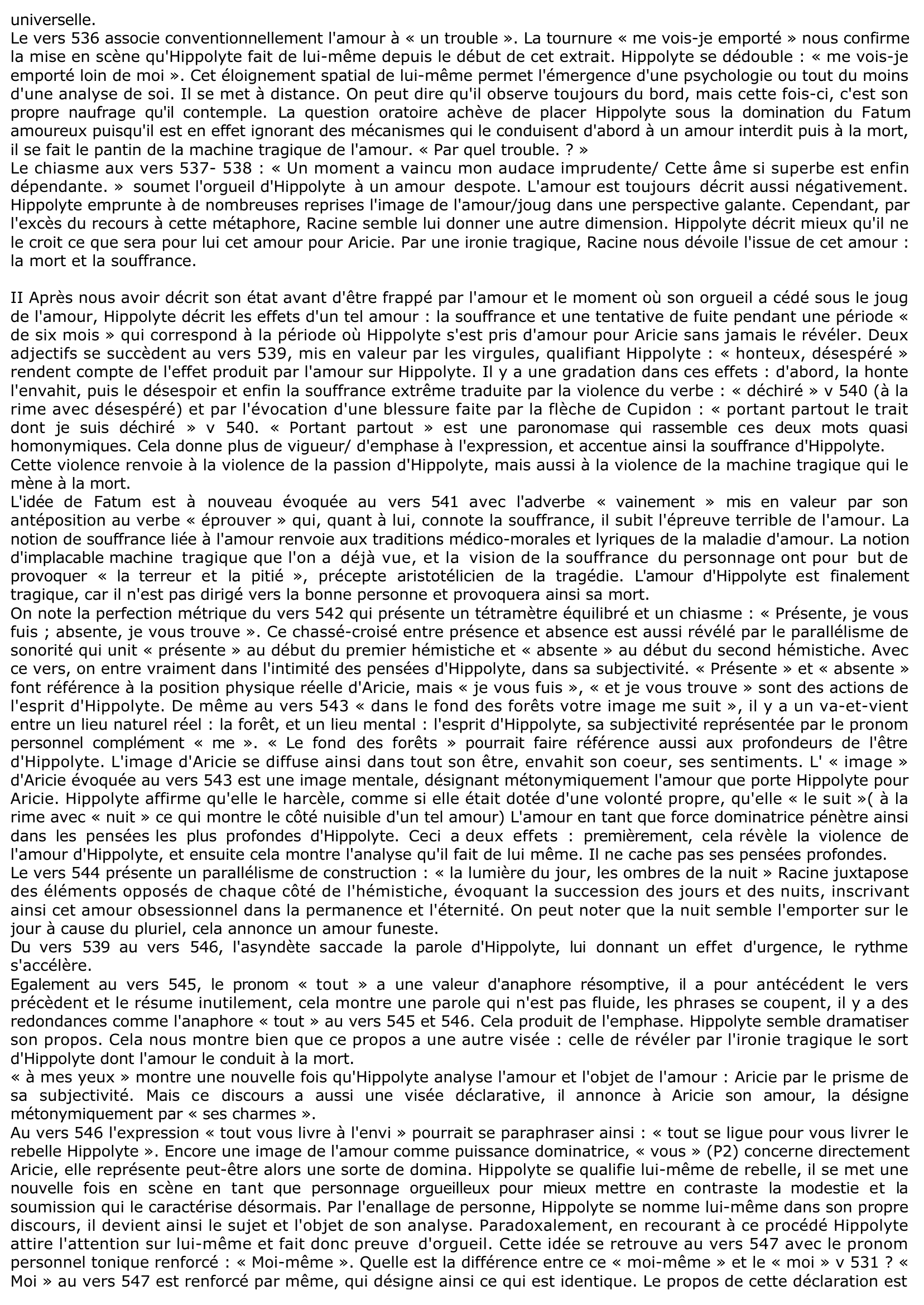Commentaire Phèdre Acte II scène 2
Publié le 22/02/2012

Extrait du document
«
universelle.Le vers 536 associe conventionnellement l'amour à « un trouble ».
La tournure « me vois-je emporté » nous confirmela mise en scène qu'Hippolyte fait de lui-même depuis le début de cet extrait.
Hippolyte se dédouble : « me vois-jeemporté loin de moi ».
Cet éloignement spatial de lui-même permet l'émergence d'une psychologie ou tout du moinsd'une analyse de soi.
Il se met à distance.
On peut dire qu'il observe toujours du bord, mais cette fois-ci, c'est sonpropre naufrage qu'il contemple.
La question oratoire achève de placer Hippolyte sous la domination du Fatumamoureux puisqu'il est en effet ignorant des mécanismes qui le conduisent d'abord à un amour interdit puis à la mort,il se fait le pantin de la machine tragique de l'amour.
« Par quel trouble.
? »Le chiasme aux vers 537- 538 : « Un moment a vaincu mon audace imprudente/ Cette âme si superbe est enfindépendante.
» soumet l'orgueil d'Hippolyte à un amour despote.
L'amour est toujours décrit aussi négativement.Hippolyte emprunte à de nombreuses reprises l'image de l'amour/joug dans une perspective galante.
Cependant, parl'excès du recours à cette métaphore, Racine semble lui donner une autre dimension.
Hippolyte décrit mieux qu'il nele croit ce que sera pour lui cet amour pour Aricie.
Par une ironie tragique, Racine nous dévoile l'issue de cet amour :la mort et la souffrance.
II Après nous avoir décrit son état avant d'être frappé par l'amour et le moment où son orgueil a cédé sous le jougde l'amour, Hippolyte décrit les effets d'un tel amour : la souffrance et une tentative de fuite pendant une période «de six mois » qui correspond à la période où Hippolyte s'est pris d'amour pour Aricie sans jamais le révéler.
Deuxadjectifs se succèdent au vers 539, mis en valeur par les virgules, qualifiant Hippolyte : « honteux, désespéré »rendent compte de l'effet produit par l'amour sur Hippolyte.
Il y a une gradation dans ces effets : d'abord, la hontel'envahit, puis le désespoir et enfin la souffrance extrême traduite par la violence du verbe : « déchiré » v 540 (à larime avec désespéré) et par l'évocation d'une blessure faite par la flèche de Cupidon : « portant partout le traitdont je suis déchiré » v 540.
« Portant partout » est une paronomase qui rassemble ces deux mots quasihomonymiques.
Cela donne plus de vigueur/ d'emphase à l'expression, et accentue ainsi la souffrance d'Hippolyte.Cette violence renvoie à la violence de la passion d'Hippolyte, mais aussi à la violence de la machine tragique qui lemène à la mort.L'idée de Fatum est à nouveau évoquée au vers 541 avec l'adverbe « vainement » mis en valeur par sonantéposition au verbe « éprouver » qui, quant à lui, connote la souffrance, il subit l'épreuve terrible de l'amour.
Lanotion de souffrance liée à l'amour renvoie aux traditions médico-morales et lyriques de la maladie d'amour.
La notiond'implacable machine tragique que l'on a déjà vue, et la vision de la souffrance du personnage ont pour but deprovoquer « la terreur et la pitié », précepte aristotélicien de la tragédie.
L'amour d'Hippolyte est finalementtragique, car il n'est pas dirigé vers la bonne personne et provoquera ainsi sa mort.On note la perfection métrique du vers 542 qui présente un tétramètre équilibré et un chiasme : « Présente, je vousfuis ; absente, je vous trouve ».
Ce chassé-croisé entre présence et absence est aussi révélé par le parallélisme desonorité qui unit « présente » au début du premier hémistiche et « absente » au début du second hémistiche.
Avecce vers, on entre vraiment dans l'intimité des pensées d'Hippolyte, dans sa subjectivité.
« Présente » et « absente »font référence à la position physique réelle d'Aricie, mais « je vous fuis », « et je vous trouve » sont des actions del'esprit d'Hippolyte.
De même au vers 543 « dans le fond des forêts votre image me suit », il y a un va-et-viententre un lieu naturel réel : la forêt, et un lieu mental : l'esprit d'Hippolyte, sa subjectivité représentée par le pronompersonnel complément « me ».
« Le fond des forêts » pourrait faire référence aussi aux profondeurs de l'êtred'Hippolyte.
L'image d'Aricie se diffuse ainsi dans tout son être, envahit son coeur, ses sentiments.
L' « image »d'Aricie évoquée au vers 543 est une image mentale, désignant métonymiquement l'amour que porte Hippolyte pourAricie.
Hippolyte affirme qu'elle le harcèle, comme si elle était dotée d'une volonté propre, qu'elle « le suit »( à larime avec « nuit » ce qui montre le côté nuisible d'un tel amour) L'amour en tant que force dominatrice pénètre ainsidans les pensées les plus profondes d'Hippolyte.
Ceci a deux effets : premièrement, cela révèle la violence del'amour d'Hippolyte, et ensuite cela montre l'analyse qu'il fait de lui même.
Il ne cache pas ses pensées profondes.Le vers 544 présente un parallélisme de construction : « la lumière du jour, les ombres de la nuit » Racine juxtaposedes éléments opposés de chaque côté de l'hémistiche, évoquant la succession des jours et des nuits, inscrivantainsi cet amour obsessionnel dans la permanence et l'éternité.
On peut noter que la nuit semble l'emporter sur lejour à cause du pluriel, cela annonce un amour funeste.Du vers 539 au vers 546, l'asyndète saccade la parole d'Hippolyte, lui donnant un effet d'urgence, le rythmes'accélère.Egalement au vers 545, le pronom « tout » a une valeur d'anaphore résomptive, il a pour antécédent le versprécèdent et le résume inutilement, cela montre une parole qui n'est pas fluide, les phrases se coupent, il y a desredondances comme l'anaphore « tout » au vers 545 et 546.
Cela produit de l'emphase.
Hippolyte semble dramatiserson propos.
Cela nous montre bien que ce propos a une autre visée : celle de révéler par l'ironie tragique le sortd'Hippolyte dont l'amour le conduit à la mort.« à mes yeux » montre une nouvelle fois qu'Hippolyte analyse l'amour et l'objet de l'amour : Aricie par le prisme desa subjectivité.
Mais ce discours a aussi une visée déclarative, il annonce à Aricie son amour, la désignemétonymiquement par « ses charmes ».Au vers 546 l'expression « tout vous livre à l'envi » pourrait se paraphraser ainsi : « tout se ligue pour vous livrer lerebelle Hippolyte ».
Encore une image de l'amour comme puissance dominatrice, « vous » (P2) concerne directementAricie, elle représente peut-être alors une sorte de domina.
Hippolyte se qualifie lui-même de rebelle, il se met unenouvelle fois en scène en tant que personnage orgueilleux pour mieux mettre en contraste la modestie et lasoumission qui le caractérise désormais.
Par l'enallage de personne, Hippolyte se nomme lui-même dans son proprediscours, il devient ainsi le sujet et l'objet de son analyse.
Paradoxalement, en recourant à ce procédé Hippolyteattire l'attention sur lui-même et fait donc preuve d'orgueil.
Cette idée se retrouve au vers 547 avec le pronompersonnel tonique renforcé : « Moi-même ».
Quelle est la différence entre ce « moi-même » et le « moi » v 531 ? «Moi » au vers 547 est renforcé par même, qui désigne ainsi ce qui est identique.
Le propos de cette déclaration est.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- COMMENTAIRE DE PHèdre acte 2 scène 5
- ? Commentaire littéraire Phèdre, Acte IV scène 6
- Conclusion du Commentaire Littéraire de la Scène 7 de l’Acte V de Phèdre de Racine.
- Phèdre - Acte I, scène 3 (plan de commentaire)
- COMMENTAIRE COMPOSE: Phèdre, Acte V, Scène 7.