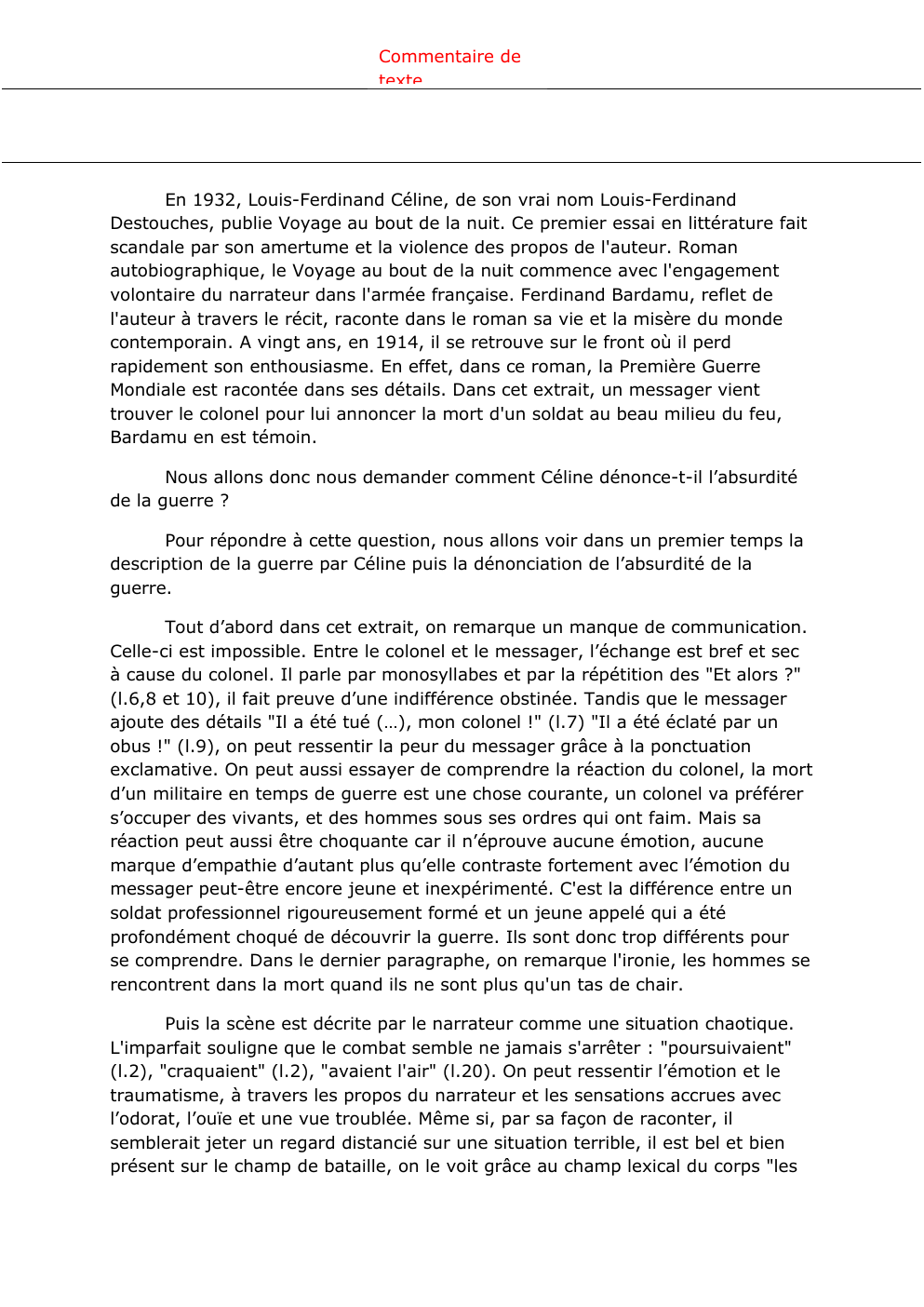Commentaire Voyage au bout de la nuit: absurdité de la guerre
Publié le 18/02/2023
Extrait du document
«
Commentaire de
texte
En 1932, Louis-Ferdinand Céline, de son vrai nom Louis-Ferdinand
Destouches, publie Voyage au bout de la nuit.
Ce premier essai en littérature fait
scandale par son amertume et la violence des propos de l'auteur.
Roman
autobiographique, le Voyage au bout de la nuit commence avec l'engagement
volontaire du narrateur dans l'armée française.
Ferdinand Bardamu, reflet de
l'auteur à travers le récit, raconte dans le roman sa vie et la misère du monde
contemporain.
A vingt ans, en 1914, il se retrouve sur le front où il perd
rapidement son enthousiasme.
En effet, dans ce roman, la Première Guerre
Mondiale est racontée dans ses détails.
Dans cet extrait, un messager vient
trouver le colonel pour lui annoncer la mort d'un soldat au beau milieu du feu,
Bardamu en est témoin.
Nous allons donc nous demander comment Céline dénonce-t-il l’absurdité
de la guerre ?
Pour répondre à cette question, nous allons voir dans un premier temps la
description de la guerre par Céline puis la dénonciation de l’absurdité de la
guerre.
Tout d’abord dans cet extrait, on remarque un manque de communication.
Celle-ci est impossible.
Entre le colonel et le messager, l’échange est bref et sec
à cause du colonel.
Il parle par monosyllabes et par la répétition des "Et alors ?"
(l.6,8 et 10), il fait preuve d’une indifférence obstinée.
Tandis que le messager
ajoute des détails "Il a été tué (…), mon colonel !" (l.7) "Il a été éclaté par un
obus !" (l.9), on peut ressentir la peur du messager grâce à la ponctuation
exclamative.
On peut aussi essayer de comprendre la réaction du colonel, la mort
d’un militaire en temps de guerre est une chose courante, un colonel va préférer
s’occuper des vivants, et des hommes sous ses ordres qui ont faim.
Mais sa
réaction peut aussi être choquante car il n’éprouve aucune émotion, aucune
marque d’empathie d’autant plus qu’elle contraste fortement avec l’émotion du
messager peut-être encore jeune et inexpérimenté.
C'est la différence entre un
soldat professionnel rigoureusement formé et un jeune appelé qui a été
profondément choqué de découvrir la guerre.
Ils sont donc trop différents pour
se comprendre.
Dans le dernier paragraphe, on remarque l'ironie, les hommes se
rencontrent dans la mort quand ils ne sont plus qu'un tas de chair.
Puis la scène est décrite par le narrateur comme une situation chaotique.
L'imparfait souligne que le combat semble ne jamais s'arrêter : "poursuivaient"
(l.2), "craquaient" (l.2), "avaient l'air" (l.20).
On peut ressentir l’émotion et le
traumatisme, à travers les propos du narrateur et les sensations accrues avec
l’odorat, l’ouïe et une vue troublée.
Même si, par sa façon de raconter, il
semblerait jeter un regard distancié sur une situation terrible, il est bel et bien
présent sur le champ de bataille, on le voit grâce au champ lexical du corps "les
yeux, les oreilles, le nez, la bouche" (l.17) et "ma tête, et puis les bras et les
jambes" (l.19), "la fumée me piqua les yeux" (l 30) et "l’odeur pointue de la
poudre et du soufre" (l 30).
Il ne peut pas vraiment voir ce qui se passe, son
corps et ses membres subit la guerre, le narrateur utilise le registre pathétique
"et puis ils me sont restés quand même mes membres" (l.20-21) pour que le
lecteur entre en empathie avec lui.
L’obus qui tombe sur eux est désigné par
métonymie "le feu" et "le bruit", ceux-ci peuvent faire penser à l’Enfer.
Ils
ravagent et envahissent tout comme nous le montre la phrase "plein les (…) la
bouche" (l.17) et se propagent jusqu’au narrateur lui-même "j’étais devenu du
bruit et du feu moi-même" (l.18).
Cet obus arrive brusquement, créant la
rupture dans le dialogue "Et puis ce fut tout.
Après ça, rien que du feu et puis du
bruit avec" (l.15-16) c’est terrifiant car il est imperceptible et imprévisible.
On
n’en perçoit en fait que les "résultats" et les dégâts lorsqu’il est trop tard pour
s’en protéger.
La description va se terminer par la dépossession de soi que le narrateur a
voulu montrer.
Tous les hommes sont considérés comme les mêmes, ils ne
représentent qu’une seule masse, quelque chose d'indéfini.
Ils n'ont pas de réelle
identité, on le voit avec la répétition du mot "colonel", "cavalier pied",
"Allemands" mais on ne voit jamais de prénoms justes des grades qui nous
montre que dans la guerre on....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire sur Voyage au bout de la nuit de LouisFerdinand Céline Extrait de la page 13 « Le colonel, c’était donc un monstre !
- commentaire voyage au bout de la nuit
- Question de corpus : comparez et commentez l’art de l’argumentation d ans ces trois textes. Texte A . VOLTAIRE, Candide (1759),Texte B. VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique , article « guerre » (1764) et Texte C. CELINE, Voyage au bout de la nuit (1932)
- Commentaire Voyage au bout de la Nuit, Louis-Ferdinand Céline
- Commentaire Voyage au bout de la Nuit, Louis-Ferdinand Céline