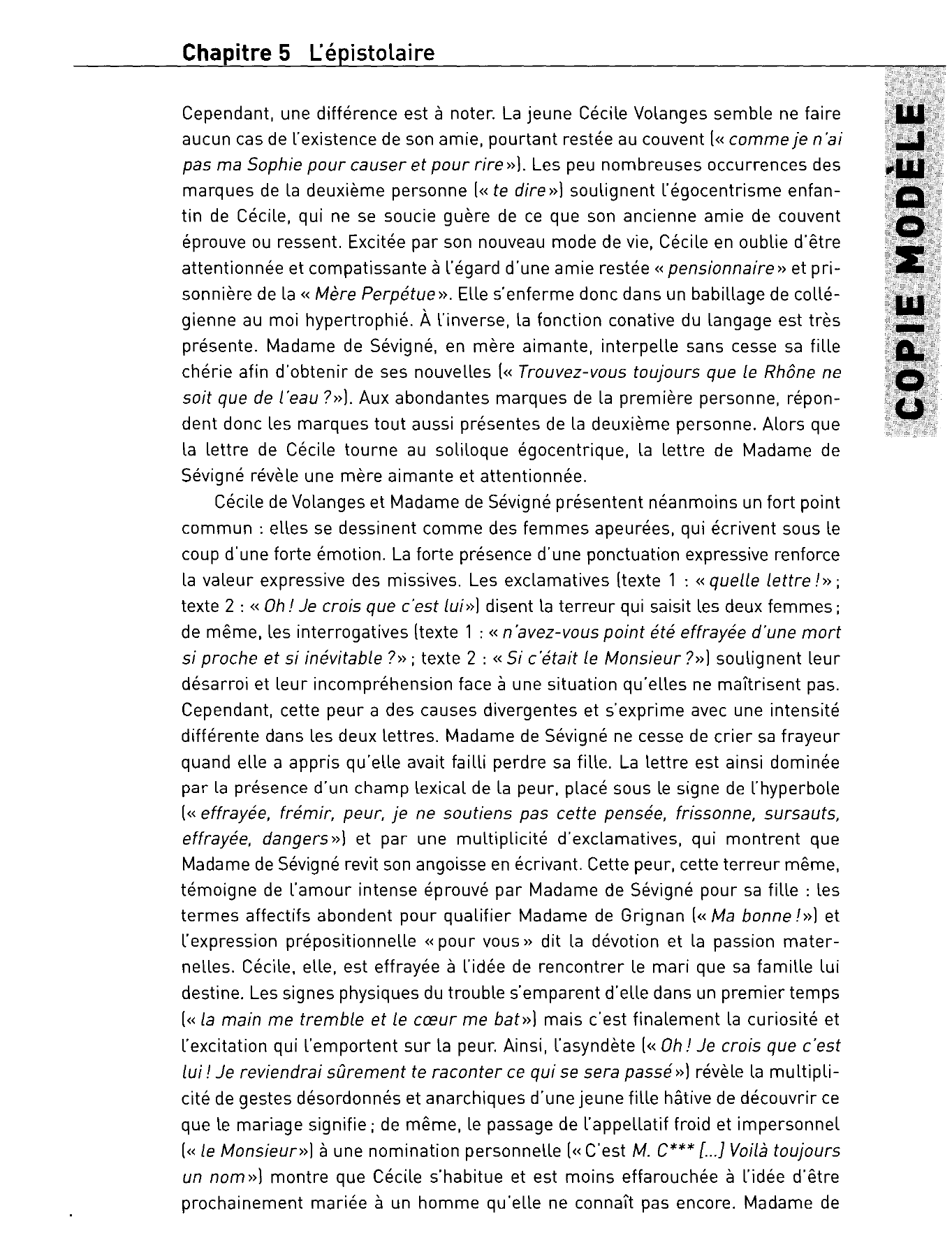Comparez les textes de Madame de Sévigné, Lettre à Madame de Grignan, et de Choderlos de Laclos, Lettre 1, Les Liaisons dangereuses.
Publié le 31/08/2014

Extrait du document


«
Chapitre 5 L.:épistolaire
Cependant, une différence est à noter.
La jeune Cécile Volanges semble ne faire
aucun
cas de l'existence de son amie, pourtant restée au couvent(« comme je n'ai
pas ma Sophie pour causer et pour rire »l.
Les peu nombreuses occurrences des
marques
de la deuxième personne («te dire »l soulignent l'égocentrisme enfan
tin
de Cécile, qui ne se soucie guère de ce que son ancienne amie de couvent
éprouve
ou ressent.
Excitée par son nouveau mode de vie, Cécile en oublie d'être
attentionnée et compatissante
à l'égard d'une amie restée« pensionnaire» et pri
sonnière de la« Mère Perpétue».
Elle s'enferme donc dans un babillage de collé
gienne
au moi hypertrophié.
À l'inverse, la fonction conative du langage est très
présente.
Madame
de Sévigné, en mère aimante, interpelle sans cesse sa fille
chérie afin d'obtenir
de ses nouvelles («Trouvez-vous toujours que le Rhône ne
soit que de l'eau ?»l.
Aux abondantes marques de la première personne, répon
dent donc les marques tout aussi présentes
de la deuxième personne.
Alors que
la lettre
de Cécile tourne au soliloque égocentrique, la lettre de Madame de
Sévigné révèle une mère aimante et attentionnée.
Cécile de Volanges et Madame de Sévigné présentent néanmoins un fort point
commun : elles
se dessinent comme des femmes apeurées, qui écrivent sous le
coup d'une forte émotion.
La forte présence d'une ponctuation expressive renforce
la valeur expressive des missives.
Les exclamatives (texte 1 : «quelle lettre!»;
texte 2 : «Oh! Je crois que c'est lui »l disent la terreur qui saisit les deux femmes;
de même, les interrogatives (texte 1 :«n'avez-vous point été effrayée d'une mort
si proche et si inévitable?»; texte 2 :«Si c'était le Monsieur?») soulignent leur
désarroi et
leur incompréhension face à une situation qu'elles ne maîtrisent pas.
Cependant, cette peur a des causes divergentes et s'exprime avec une intensité
différente dans les deux lettres.
Madame
de Sévigné ne cesse de crier sa frayeur
quand elle a appris qu'elle avait failli perdre
sa fille.
La lettre est ainsi dominée
par
la présence d'un champ lexical de la peur, placé sous le signe de l'hyperbole
(«effrayée, frémir, peur, je ne soutiens pas cette pensée, frissonne, sursauts,
effrayée, dangers>>)
et par une multiplicité d'exclamatives, qui montrent que
Madame
de Sévigné revit son angoisse en écrivant.
Cette peur, cette terreur même,
témoigne
de l'amour intense éprouvé par Madame de Sévigné pour sa fille : les
termes affectifs abondent pour qualifier Madame
de Grignan («Ma bonne'») et
l'expression prépositionnelle
«pour vous>> dit la dévotion et la passion mater
nelles.
Cécile, elle, est effrayée à l'idée de rencontrer le mari que sa famille lui
destine.
Les signes physiques
du trouble s'emparent d'elle dans un premier temps
(«la main me tremble et le cœur me bat») mais c'est finalement la curiosité et
l'excitation qui l'emportent
sur la peur.
Ainsi, l'asyndète(« Oh! Je crois que c'est
lui! Je reviendrai sûrement te raconter ce qui se sera passé »l révèle la multipli
cité de gestes désordonnés et anarchiques d'une jeune fille hâtive de découvrir ce
que le mariage signifie; de même, le passage de l'appellatif froid et impersonnel
(«le Monsieur>>) à une nomination personnelle(« C'est M.
C*** [...]Voilà toujours
un nom
>>l montre que Cécile s'habitue et est moins effarouchée à l'idée d'être
prochainement mariée
à un homme qu'elle ne connaît pas encore.
Madame de.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Texte 4 : Les Liaisons dangereuses (1782), Choderlos de Laclos (1741- 1803) - Lettre 81
- Lettre 81 - Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos,1782
- Choderlos de Laclos, Les liaisons dangereuses, Lettre 175
- Choderlos de Laclos, Les liaisons dangereuses, analyse de la lettre 81
- Les Liaisons dangereuses Choderlos de Laclos Lettre 47