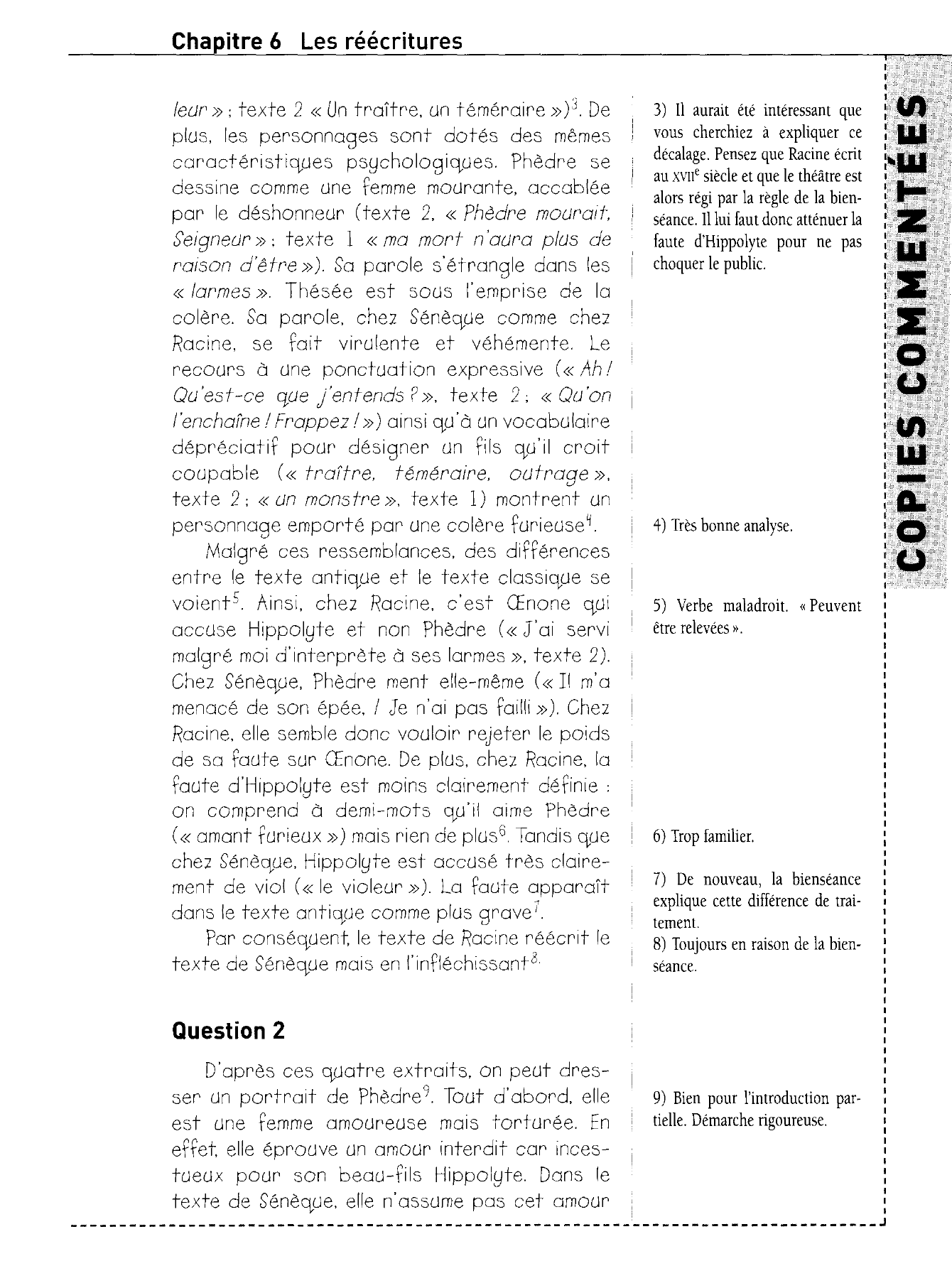Comparez l'extrait de Sénèque (texte 1) et celui de Racine (texte 2).
Publié le 29/08/2014

Extrait du document

Analyse du corpus

«
Chapitre 6 Les réécritures
leur»: texte 2 «Un traître.
un téméraire» )3 De
plus.
les personnages sont dotés des mêmes
caractéristiques p5f:Jchologiques.
Phèdre se
dessine comme une femme mourante.
accablée
par le déshonneur (texte 2.
« Phèdre mourait.
Seigneur» : texte l « ma mort n'aura plus de
raison
d'être»).
Sa parole s'étrangle dans les
« larmes» Thésée est sous l'emprise de la
colère.
Sa parole.
che:z Sénèque comme che:z
Racine.
se tait virulente et véhémente.
Le
recours à une ponctuation expressive ( « Ah 1
Qu'est-ce que fentends? ».
texte 2: «Qu'on
l'enchaÎne 1 Frappe2 1 »)ainsi qu'à un vocabulaire
dépréciatif pour désigner un tils qu'il croit
coupable ( « traÎtre.
téméraire.
outrage».
texte 2 : « un monstre».
texte l) montrent un
personnage emporté par une colère furieuse~.
Malgré ces ressemblances.
des dittérences
entre le texte antique et le texte classique se
3) Il aurait été intéressant que
vous cherchiez à expliquer ce
décalage.
Pensez que Racine écrit
au xvn' siècle et que le théâtre est
alors régi par la règle de la bien
séance.
Il lui faut donc atténuer la
faute d'Hippolyte pour ne pas
choquer le public.
1 4) Très bonne analyse.
voientS Ainsi.
che:z Racine.
c'est Œnone qui 5) Verbe maladroit.
«Peuvent
accuse HippOif:jte et non Phèdre ( « J'ai servi i être relevées>>.
malgré moi d'interprète à ses larmes».
texte 2).
1
Che:z Sénèque.
Phèdre ment elle-même («Il m'a
menacé de son épée.
1 Je n ·ai pas failli » ).
Che:z
Racine.
elle semble donc vouloir rejeter le poids
de sa faute sur Œnone.
De plus.
che:z Racine.
la !
faute d'Hippolt~te est moins clairement détinie :
on comprend à
demi-mot5 qu'il aime Phèdre
(«amont furieux») mais rien de plus 6 Tandis que
che:z Sénèque.
HippoltJte est accusé très claire
ment de viol ( « le violeur » ).
La faute apparaît
dans le texte antique comme plus grave 7
Par conséquent.
le texte de Racine réécrit le
texte de Sénèque mais en l'intléchissont 8
Question 2
6) Trop familier.
7) De nouveau, la bienséance
explique cette différence de trai-
tement.
8) Toujours en raison de la bien-
séance.
D'après ces quatre extraits.
on peut dres
ser un portrait de Phèdre 9
.
Tout d'abord.
elle
est une femme amoureuse mois torturée.
En
eHet.
elle éprouve un amour interdit car inces
tueux pour son beau-fils HippoltJte.
Dons le
texte de Sénèque.
elle n'assume pas cet amour
9) Bien pour l'introduction par
' tielle.
Démarche rigoureuse..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Introduction Ce texte de Bergson, extrait du chapitre IV de L’Evolution créatrice, a pour objet d’exposer la racine d’une illusion trop répandue en ce qui concerne notre rapport au réel.
- Vous commenterez l’extrait de Racine (texte 1), du vers 27 ("Vous êtes en des lieux tous pleins de sa puissance") jusqu’à la fin.
- TEXTE D'ETUDE : extrait du récit de Théramène, acte V, scène 6 (v. 1498-1546) - RACINE
- Texte 1: Gargantua, 1534 (extrait 2 ) chapitre XXIII
- analyse linéaire Molière - Texte 1 : Acte II scène 5 (extrait du Malade Imaginaire)