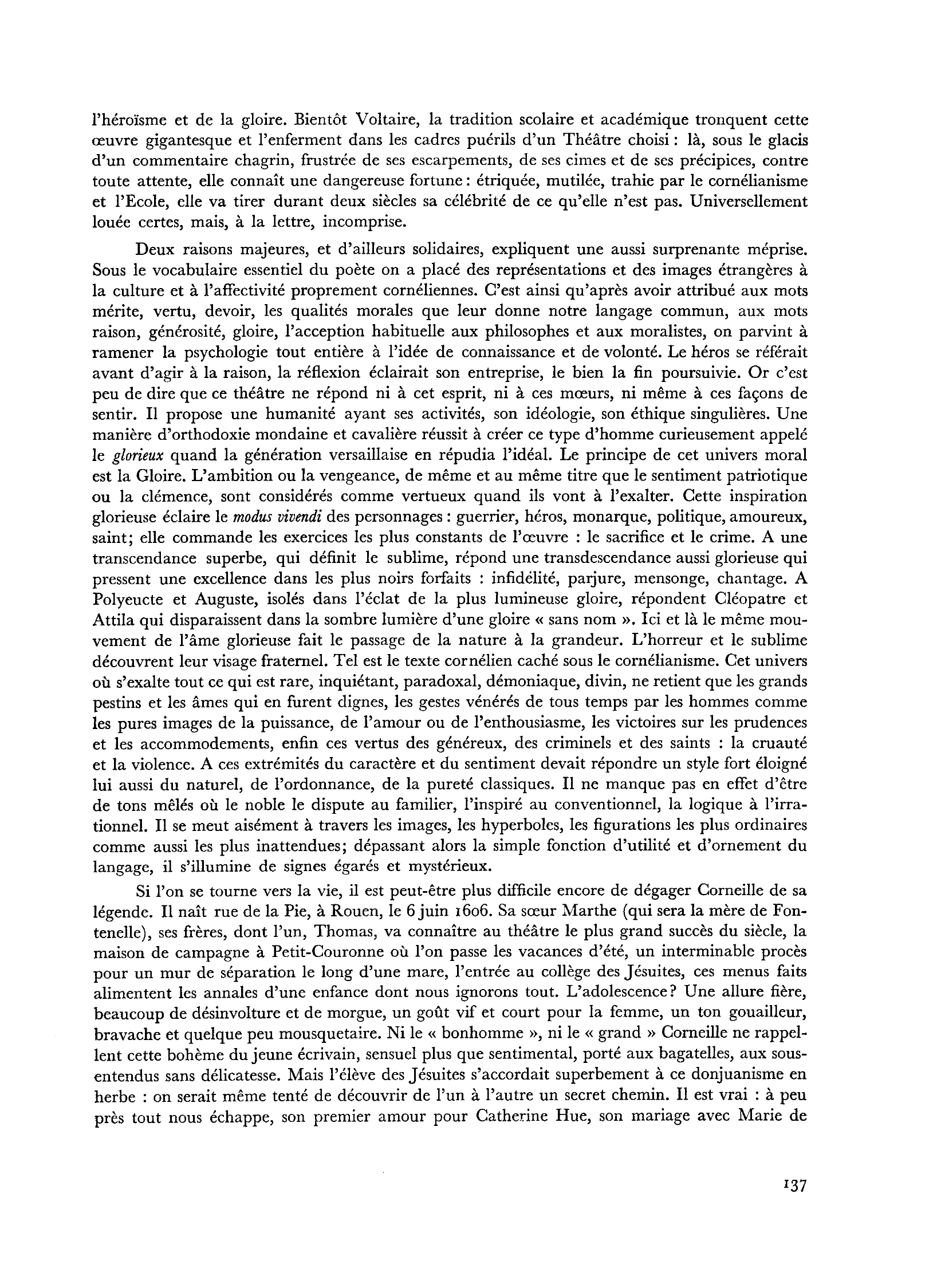CORNEILLE
Publié le 02/09/2013

Extrait du document
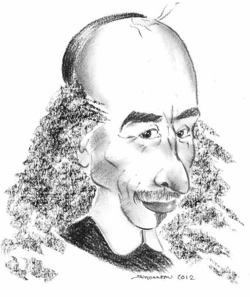
1606-1684
CORNEILLE est l'écrivain de toutes les chances : bonnes ou mauvaises il fut comblé ; l'histoire a gravé son visage dans le bronze de la médaille romaine; elle nous a imposé à la fois la légende d'une vie bonhomme et celle d'une oeuvre exemplaire, illustration et maxime des vertus morales, patriotiques et civiques. Double mythe, critique et biographique, sur quoi s'est établie une universelle renommée. Heureuse fortune après tout si Corneille peut aujourd'hui vaincre sa légende, rentrer dans ses domaines et commencer enfin une authentique carrière.
A vingt-trois ans il remet au comédien Mondory son manuscrit de Mélite (1629) qui inau¬gure avant Molière la comédie de moeurs et de caractères, remplace le décor de rocaille, le costume et l'âme de l'idylle pastorale qui n'en finissaient plus d'être à la mode, par une intrigue parisienne, jouée dans la langue et sous l'habit bourgeois des contemporains. Dans cette neuve formule il donne coup sur coup la Veuve, la Galerie du Palais, la Suivante ; puis deux comédies, forte : la Place Royale et étrange : l'Illusion comique ; et entre temps deux essais de tragédie disparate et sans aplomb : Clitandre et Médée. Huit ans après Mélite, second coup de gong du génie : le Cid (1637) fonde la tragédie française. Suivent des chefs-d'œuvre : Horace, Cinna, Polyeucte, Pompée, le Menteur, Rodogune, Don Sanche d'Aragon et ce peu convaincant mais singulier Nicomède où la tragédie s'exténue et refuse le tragique. A ces succès s'ajoute une précieuse disgrâce : le triomphe du Cid suscite l'Histoire de la critique en France par ces Sentiments de l'Académie française sur le Cid où des gens de métier, pour la première fois, exercent l'art de donner des conseils au génie, et quelques années plus tard, cette magistrale réplique des Discours sur le poème dramatique, qui demeurent un des exposés les plus lucides de la dramaturgie classique. Sans désemparer, Corneille confère la noblesse du drame à la pièce à camouflage d'identité, imbroglio et reconnaissances, découvre la formule et la technique de la pièce à machines (Andromède), puis celle de l'opéra (OEdipe, la Toison d'or) et jusqu'au livret d'opérette (Agésilas). Dans cette dernière pièce, en novateur toujours, il abandonne le distique alexandrin et la rime suivie, use avec bonheur du vers libre et fait l'essai d'un nouvel équilibre rythmique. On lui doit même l'invention du programme officiel du spectacle qu'il met à la mode dans ces sortes de Dessein dont il fait précéder les représentations d' Andromède et de la Toison d'or.
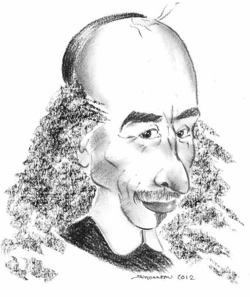
«
.
Li
l'héroïsme et de la gloire.
Bientôt Voltaire, la tradition scolaire et académique tronquent cette
œuvre gigantesque et l'enferment dans les cadres puérils d'un Théâtre choisi: là, sous le glacis
d'un commentaire chagrin, frustrée de ses escarpements, de ses cimes et de ses précipices, contre
toute attente, elle connaît une dangereuse fortune: étriquée, mutilée, trahie par le cornélianisme
et !'Ecole, elle va tirer durant deux siècles sa célébrité de ce qu'elle n'est pas.
Universellement
louée certes, mais, à
la lettre, incomprise.
Deux raisons majeures, et d'ailleurs solidaires, expliquent une aussi surprenante méprise.
Sous le vocabulaire essentiel du poète on a placé des représentations et des images étrangères à
la culture et à l'affectivité proprement cornéliennes.
C'est ainsi qu'après avoir attribué aux mots
mérite, vertu, devoir, les qualités morales
que leur donne notre langage commun, aux mots
raison, générosité, gloire, l'acception habituelle
aux philosophes et aux moralistes, on parvint à
ramener la psychologie tout entière à l'idée de connaissance et de volonté.
Le héros se référait
avant d'agir à la raison, la réflexion éclairait son entreprise, le bien la fin poursuivie.
Or c'est
peu de dire que ce théâtre ne répond ni à cet esprit, ni à ces mœurs, ni même à ces façons de
sentir.
Il propose une humanité ayant ses activités, son idéologie, son éthique singulières.
Une
manière d'orthodoxie mondaine et cavalière réussit à créer ce type d'homme curieusement appelé
le
glorieux quand la génération versaillaise en répudia l'idéal.
Le principe de cet univers moral
est la Gloire.
L'ambition ou la vengeance, de même et au même titre que le sentiment patriotique
ou la clémence, sont considérés comme vertueux quand ils vont à l'exalter.
Cette inspiration
glorieuse éclaire le
modus vivendi des personnages : guerrier, héros, monarque, politique, amoureux,
saint; elle commande les exercices les plus constants de l'œuvre : le sacrifice et le crime.
A une
transcendance superbe, qui définit le sublime, répond une transdescendance aussi glorieuse qui
pressent une excellence dans les plus noirs forfaits : infidélité, parjure, mensonge, chantage.
A
Polyeucte et Auguste, isolés dans l'éclat de la plus lumineuse gloire, répondent Cléopatre et
Attila qui disparaissent dans la sombre lumière d'une gloire « sans nom ».
Ici et là le même mou
vement de l'âme glorieuse fait le passage de la nature à la grandeur.
L'horreur et le sublime
découvrent
leur visage fraternel.
Tel est le texte cornélien caché sous le cornélianisme.
Cet univers
où s'exalte tout ce qui est rare, inquiétant, paradoxal, démoniaque, divin, ne retient que les grands
pestins et les âmes qui en furent dignes, les gestes vénérés de tous temps par les hommes comme
les pures images
de la puissance, de l'amour ou de l'enthousiasme, les victoires sur les prudences
et les accommodements, enfin ces vertus des généreux, des criminels et des saints : la cruauté
et la violence.
A ces extrémités du caractère et du sentiment devait répondre un style fort éloigné
lui aussi
du naturel, de l'ordonnance, de la pureté classiques.
Il ne manque pas en effet d'être
de tons mêlés où le noble le dispute au familier, l'inspiré au conventionnel, la logique à l'irra
tionnel.
Il se meut aisément à travers les images, les hyperboles, les figurations les plus ordinaires
comme aussi les plus inattendues; dépassant alors la simple fonction d'utilité et d'ornement du
langage, il s'illumine de signes égarés et mystérieux.
Si l'on se tourne vers la vie, il est peut-être plus difficile encore de dégager Corneille de sa
légende.
Il naît rue de la Pie, à Rouen, le 6 juin 1606.
Sa sœur Marthe (qui sera la mère de Fon
tenelle),
ses frères, dont l'un, Thomas, va connaître au théâtre le plus grand succès du siècle, la
maison de campagne à Petit-Couronne où l'on passe les vacances d'été, un interminable procès
pour un mur de séparation le long d'une mare, l'entrée au collège des Jésuites, ces menus faits
alimentent les annales d'une enfance dont nous ignorons tout.
L'adolescence? Une allure fière,
beaucoup de désinvolture et de morgue, un goût vif et court pour la femme, un ton gouailleur,
bravache et quelque peu mousquetaire.
Ni le « bonhomme », ni le « grand » Corneille ne rappel
lent cette bohème du jeune écrivain, sensuel plus que sentimental, porté aux bagatelles, aux sous
entendus sans délicatesse.
Mais l'élève des Jésuites s'accordait superbement à ce donjuanisme en
herbe : on serait même tenté de découvrir de l'un à l'autre un secret chemin.
Il est vrai : à peu
près tout nous échappe, son premier amour pour Catherine Hue, son mariage avec Marie de
137.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Etude linéaire; La Médée de corneille
- C. E. 20 juin 1913, TERY, Rec. 736, concl. Corneille
- Médée de Corneille Résumé scène par scène
- Corrigé Commentaire de texte L’Illusion comique, Corneille, 1634
- LA : Médée de Corneille