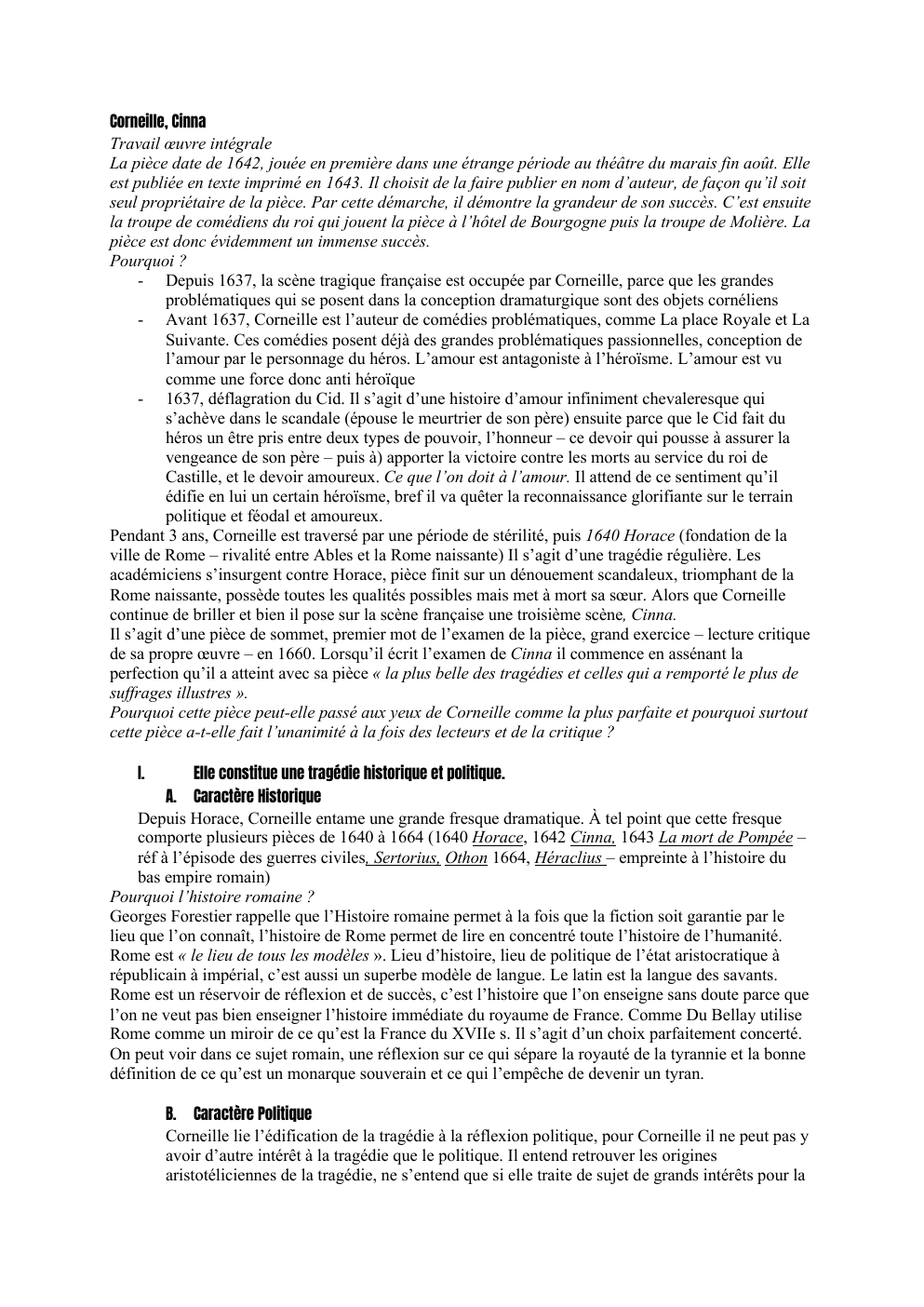Corneille, Cinna Travail œuvre intégrale
Publié le 08/10/2023
Extrait du document
«
Corneille, Cinna
Travail œuvre intégrale
La pièce date de 1642, jouée en première dans une étrange période au théâtre du marais fin août.
Elle
est publiée en texte imprimé en 1643.
Il choisit de la faire publier en nom d’auteur, de façon qu’il soit
seul propriétaire de la pièce.
Par cette démarche, il démontre la grandeur de son succès.
C’est ensuite
la troupe de comédiens du roi qui jouent la pièce à l’hôtel de Bourgogne puis la troupe de Molière.
La
pièce est donc évidemment un immense succès.
Pourquoi ?
- Depuis 1637, la scène tragique française est occupée par Corneille, parce que les grandes
problématiques qui se posent dans la conception dramaturgique sont des objets cornéliens
- Avant 1637, Corneille est l’auteur de comédies problématiques, comme La place Royale et La
Suivante.
Ces comédies posent déjà des grandes problématiques passionnelles, conception de
l’amour par le personnage du héros.
L’amour est antagoniste à l’héroïsme.
L’amour est vu
comme une force donc anti héroïque
- 1637, déflagration du Cid.
Il s’agit d’une histoire d’amour infiniment chevaleresque qui
s’achève dans le scandale (épouse le meurtrier de son père) ensuite parce que le Cid fait du
héros un être pris entre deux types de pouvoir, l’honneur – ce devoir qui pousse à assurer la
vengeance de son père – puis à) apporter la victoire contre les morts au service du roi de
Castille, et le devoir amoureux.
Ce que l’on doit à l’amour.
Il attend de ce sentiment qu’il
édifie en lui un certain héroïsme, bref il va quêter la reconnaissance glorifiante sur le terrain
politique et féodal et amoureux.
Pendant 3 ans, Corneille est traversé par une période de stérilité, puis 1640 Horace (fondation de la
ville de Rome – rivalité entre Ables et la Rome naissante) Il s’agit d’une tragédie régulière.
Les
académiciens s’insurgent contre Horace, pièce finit sur un dénouement scandaleux, triomphant de la
Rome naissante, possède toutes les qualités possibles mais met à mort sa sœur.
Alors que Corneille
continue de briller et bien il pose sur la scène française une troisième scène, Cinna.
Il s’agit d’une pièce de sommet, premier mot de l’examen de la pièce, grand exercice – lecture critique
de sa propre œuvre – en 1660.
Lorsqu’il écrit l’examen de Cinna il commence en assénant la
perfection qu’il a atteint avec sa pièce « la plus belle des tragédies et celles qui a remporté le plus de
suffrages illustres ».
Pourquoi cette pièce peut-elle passé aux yeux de Corneille comme la plus parfaite et pourquoi surtout
cette pièce a-t-elle fait l’unanimité à la fois des lecteurs et de la critique ?
I.
A.
Elle constitue une tragédie historique et politique.
Caractère Historique
Depuis Horace, Corneille entame une grande fresque dramatique.
À tel point que cette fresque
comporte plusieurs pièces de 1640 à 1664 (1640 Horace, 1642 Cinna, 1643 La mort de Pompée –
réf à l’épisode des guerres civiles, Sertorius, Othon 1664, Héraclius – empreinte à l’histoire du
bas empire romain)
Pourquoi l’histoire romaine ?
Georges Forestier rappelle que l’Histoire romaine permet à la fois que la fiction soit garantie par le
lieu que l’on connaît, l’histoire de Rome permet de lire en concentré toute l’histoire de l’humanité.
Rome est « le lieu de tous les modèles ».
Lieu d’histoire, lieu de politique de l’état aristocratique à
républicain à impérial, c’est aussi un superbe modèle de langue.
Le latin est la langue des savants.
Rome est un réservoir de réflexion et de succès, c’est l’histoire que l’on enseigne sans doute parce que
l’on ne veut pas bien enseigner l’histoire immédiate du royaume de France.
Comme Du Bellay utilise
Rome comme un miroir de ce qu’est la France du XVIIe s.
Il s’agit d’un choix parfaitement concerté.
On peut voir dans ce sujet romain, une réflexion sur ce qui sépare la royauté de la tyrannie et la bonne
définition de ce qu’est un monarque souverain et ce qui l’empêche de devenir un tyran.
B.
Caractère Politique
Corneille lie l’édification de la tragédie à la réflexion politique, pour Corneille il ne peut pas y
avoir d’autre intérêt à la tragédie que le politique.
Il entend retrouver les origines
aristotéliciennes de la tragédie, ne s’entend que si elle traite de sujet de grands intérêts pour la
cité pour la collectivité.
Corneille ajoute une définition très particulière de la tragédie – action
qui permet d’exhausser l’être humain au-dessus de lui-même, vise à faire admirer comment un
individu peut se dépasser lui-même en oubliant ses propres intérêts et en se dévouant à l’ordre
public ou à la raison d’état.
Les grands intérêts à mettre en place la tragédie, sont pour Aristote les sujets des grands du monde.
Le
contexte historique oppose une autre puissance, la puissance de l’état est le grand conflit qui selon
Corneille définit les enjeux tragiques c’est le conflit entre eux et l’état.
C.
Cohérence politique des premières pièces de Corneille
-
Le Cid 1637, on a affaire à une progressive institution de la monarchie absolue de droit divin.
Le roi précédent, Henri IV, obtient le titre au prix d’une conversion (protestant).
La légitimité
du règne d’Henri IV était une légitimité de conflit.
Le successeur doit donc consolider cette
monarchie des Bourbon.
D’abord Cardinal de Richelieu en premier ministre qui ne fait pas du
tout l’unanimité pour lui, mais trouve un bras armé en lui.
En 1637 donc dans toute cette réflexion d’institution, Le Cid pose la grande question de savoir ce qu’il
faut faire de l’éthique nobiliaire.
La réponse idéale à cette question politique qui interroge la solubilité
du héros du grand féodal puissant dans le système étatique de la monarchie absolue.
Rodrigue achève
de conquérir un aristocratisme indubitable en tuant l’offenseur – va jusqu’au bout de la logique
féodale- puis accepte de se soumettre au duel judiciaire (roi de Castille) faire preuve de son excellence
aristocratique et sa soumission au roi.
Ce duel montre comment l'État de la monarchie peut utiliser la
valeur des grands féodaux.
Le héros se soumet et cette volonté royale devient un serviteur de l'État.
Avec Horace, même problème.
Que faire d’un héros dont la gloire des armes ne fait aucun doute, que faire quand il est capable au
nom de la raison d’état de transcender les liens d’amitié, d’amour, de parenté, de sang, est-ce que
cette condition-là, sorte de héros « surhumain » est-ce que le problème du héros redoutable n’est pas
d’en poser un nouveau ?
Au nom de la raison d’état, le héros peut-il se détacher de tous liens communs ? Déroger aux
contraintes familiales, sorte de ferment antisocial.
Que faire de ces héros aristocrates ?
Période de complot contre Richelieu de conspirations contre Louis XIII.
- Lorsque Cinna arrive, continue cette réflexion
Chez Horace, désordre de l’histoire vers l’ordre, apparaît finalement comme une sorte de solution
au climat de guerre civile.
Quand Cinna arrive, le contexte est similaire, le héros Auguste sort d’une période de grand
trouble.
Il a d’abord été octave et l’un des grands triumvirats.
La légitimité de l’empire d’auguste,
la légitimité monarchique est très problématique.
Il a pratiqué les proscriptions : la torture, la mise
à mort des opposants, l’exil, le bannissement, il sort d’une période tyrannique – au sens
contemporain du terme – c’est Octave le tyran et c’est le geste de clémence vis-à-vis des conjurés
autour de Cinna qui le transforme en monarche absolu.
La fin de règne et de vie le conduit à
l’apothéose et place les empereurs romains au rang des dieux.
Cette apothéose pour auguste est la
fondation symbolique de cette monarchie de droits divins.
En face d’Auguste, un individu – aristocrate valeureux guerrier conseiller du roi – Cinna.
La pièce
le présente comme un héros problématique au sens propre, il n’y a plus de progression
ascensionnelle.
Il y a un Cinna en tout déstabilisé, incertain, un héros qui s’interroge même sur
l’héroïsme de l’action dans laquelle il se projette.
La balance s’oriente progressivement vers la gloire du monarque.
Cette très forte cohérence explique évidemment que d’une certaine façon pour le public de
Corneille il y est à la fois une représentation analogique et en même temps un modèle supérieur qui
peut aider non seulement la monarchie à conquérir les cœurs et réfléchir sur les ferments entre
ordre et désordre.
D.
Le contexte immédiat
Ce succès éclatant lui apporte une gloire à la fois littéraire et sociale.
En 1642 dans les années 40, on est à une fin de règne, Richelieu meurt en 1642 entre la première et la
publication de Cinna.
Louis XIII meurt en 1643.
C’est une fin de règne très troublée par la
multiplication de fin de règne et de complots.
Parmi ces complots : la grande conspiration de Chalais
en 1626, la conspiration de Henri II de Montmorency décapité à Toulouse en 1632, conspiration
marquis de Cinq-Mars exécuté en 1642.
Tous ces troubles intérieurs développent une double image, à la fois l’image tyrannique de Richelieu
et simultanément l’image insurrectionnel des factions féodales.
À cela s'ajoutent les problèmes de
guerres extérieures, la guerre de 30 ans, et....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Etude d’une œuvre intégrale : Phèdre de Racine
- TRAVAIL DE L’œUVRE, MACHIAVEL (LE), 1972. Claude Lefort (résumé & analyse)
- Cinna ou la Clémence d’Auguste 1642 Pierre Corneille (analyse détaillée)
- CINNA ou La clémence d’Auguste. (résumé & analyse) de Pierre Corneille
- CINNA de Corneille (résumé & analyse)