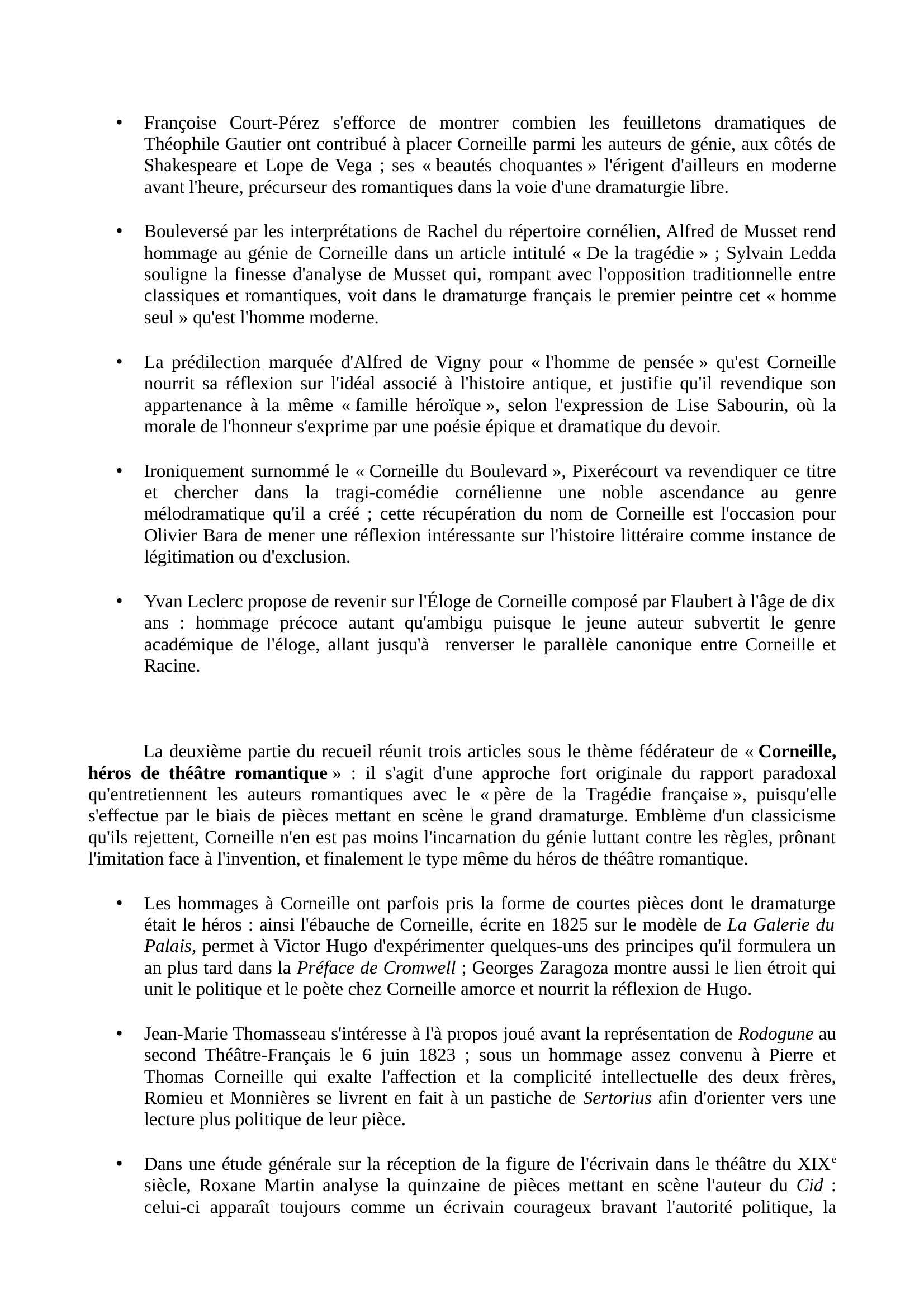Corneille des romantiques
Publié le 22/10/2012

Extrait du document
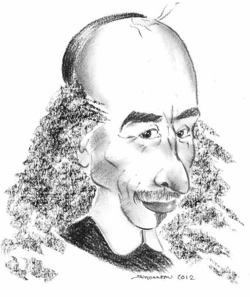
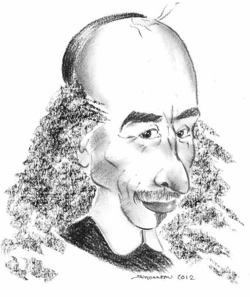
«
• Françoise Court-Pérez s'efforce de montrer combien les feuilletons dramatiques de
Théophile Gautier ont contribué à placer Corneille parmi les auteurs de génie, aux côtés de
Shakespeare et Lope de Vega ; ses « beautés choquantes » l'érigent d'ailleurs en moderne
avant l'heure, précurseur des romantiques dans la voie d'une dramaturgie libre.
• Bouleversé par les interprétations de Rachel du répertoire cornélien, Alfred de Musset rend
hommage au génie de Corneille dans un article intitulé « De la tragédie » ; Sylvain Ledda
souligne la finesse d'analyse de Musset qui, rompant avec l'opposition traditionnelle entre
classiques et romantiques, voit dans le dramaturge français le premier peintre cet « homme
seul » qu'est l'homme moderne.
• La prédilection marquée d'Alfred de Vigny pour « l'homme de pensée » qu'est Corneille
nourrit sa réflexion sur l'idéal associé à l'histoire antique, et justifie qu'il revendique son
appartenance à la même « famille héroïque », selon l'expression de Lise Sabourin, où la
morale de l'honneur s'exprime par une poésie épique et dramatique du devoir.
• Ironiquement surnommé le « Corneille du Boulevard », Pixerécourt va revendiquer ce titre
et chercher dans la tragi-comédie cornélienne une noble ascendance au genre
mélodramatique qu'il a créé ; cette récupération du nom de Corneille est l'occasion pour
Olivier Bara de mener une réflexion intéressante sur l'histoire littéraire comme instance de
légitimation ou d'exclusion.
• Yvan Leclerc propose de revenir sur l'Éloge de Corneille composé par Flaubert à l'âge de dix
ans : hommage précoce autant qu'ambigu puisque le jeune auteur subvertit le genre
académique de l'éloge, allant jusqu'à renverser le parallèle canonique entre Corneille et
Racine.
La deuxième partie du recueil réunit trois articles sous le thème fédérateur de « Corneille,
héros de théâtre romantique » : il s'agit d'une approche fort originale du rapport paradoxal
qu'entretiennent les auteurs romantiques avec le « père de la Tragédie française », puisqu'elle
s'effectue par le biais de pièces mettant en scène le grand dramaturge.
Emblème d'un classicisme qu'ils rejettent, Corneille n'en est pas moins l'incarnation du génie luttant contre les règles, prônant l'imitation face à l'invention, et finalement le type même du héros de théâtre romantique. • Les hommages à Corneille ont parfois pris la forme de courtes pièces dont le dramaturge était le héros : ainsi l'ébauche de Corneille, écrite en 1825 sur le modèle de La Galerie du Palais , permet à Victor Hugo d'expérimenter quelques-uns des principes qu'il formulera un an plus tard dans la Préface de Cromwell ; Georges Zaragoza montre aussi le lien étroit qui unit le politique et le poète chez Corneille amorce et nourrit la réflexion de Hugo. • Jean-Marie Thomasseau s'intéresse à l'à propos joué avant la représentation de Rodogune au second Théâtre-Français le 6 juin 1823 ; sous un hommage assez convenu à Pierre et Thomas Corneille qui exalte l'affection et la complicité intellectuelle des deux frères, Romieu et Monnières se livrent en fait à un pastiche de Sertorius afin d'orienter vers une lecture plus politique de leur pièce. • Dans une étude générale sur la réception de la figure de l'écrivain dans le théâtre du XIX e siècle, Roxane Martin analyse la quinzaine de pièces mettant en scène l'auteur du Cid : celui-ci apparaît toujours comme un écrivain courageux bravant l'autorité politique, la. »
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les Romantiques ont mis Corneille fort au-dessus de Racine. Comment vous expliquez-vous cette préférence ?
- Etude linéaire; La Médée de corneille
- C. E. 20 juin 1913, TERY, Rec. 736, concl. Corneille
- Médée de Corneille Résumé scène par scène
- Corrigé Commentaire de texte L’Illusion comique, Corneille, 1634