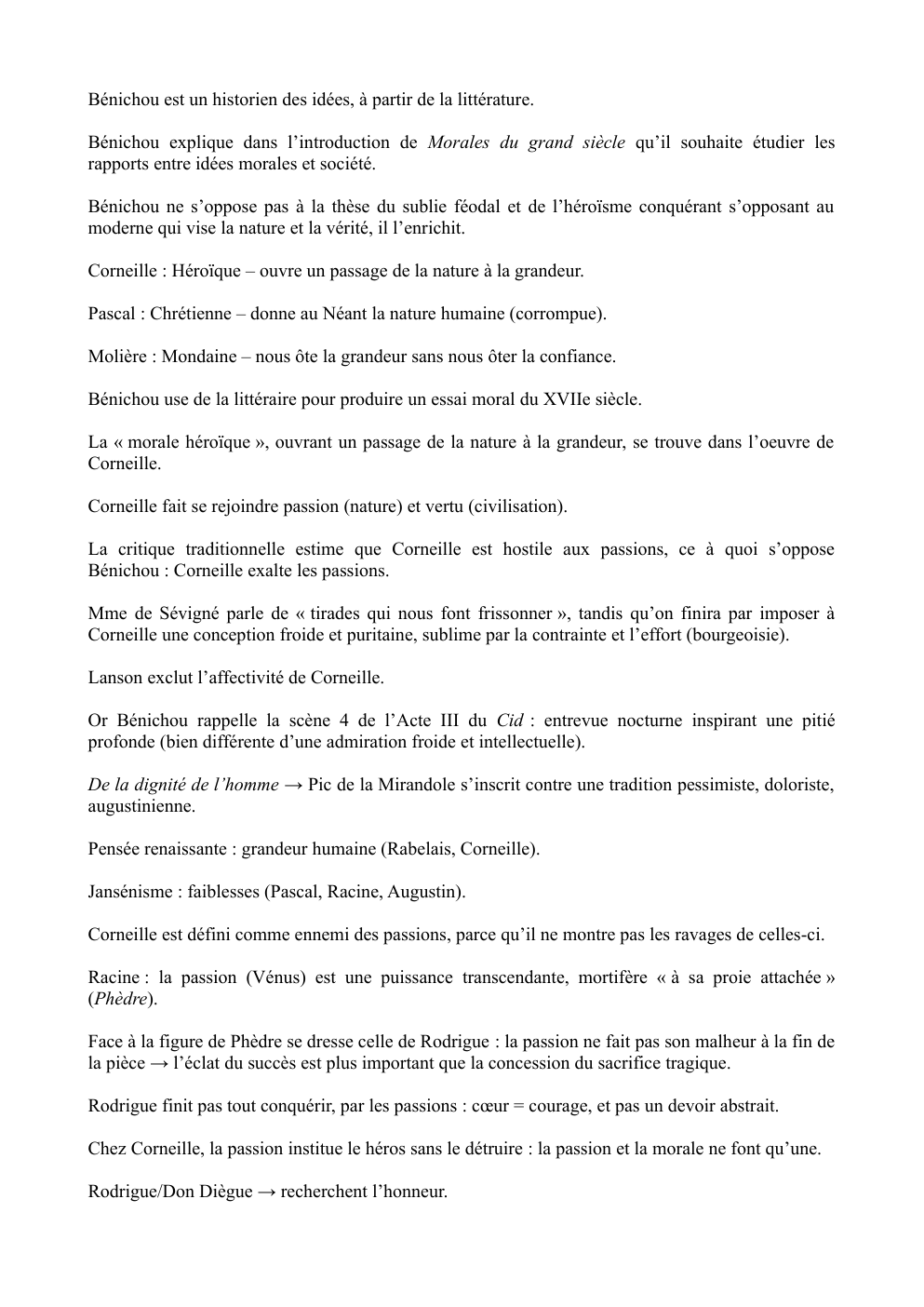Corneille vu par Bénichou
Publié le 06/11/2023
Extrait du document
« Bénichou est un historien des idées, à partir de la littérature. Bénichou explique dans l’introduction de Morales du grand siècle qu’il souhaite étudier les rapports entre idées morales et société. Bénichou ne s’oppose pas à la thèse du sublie féodal et de l’héroïsme conquérant s’opposant au moderne qui vise la nature et la vérité, il l’enrichit. Corneille : Héroïque – ouvre un passage de la nature à la grandeur. Pascal : Chrétienne – donne au Néant la nature humaine (corrompue). Molière : Mondaine – nous ôte la grandeur sans nous ôter la confiance. Bénichou use de la littéraire pour produire un essai moral du XVIIe siècle. La « morale héroïque », ouvrant un passage de la nature à la grandeur, se trouve dans l’oeuvre de Corneille. Corneille fait se rejoindre passion (nature) et vertu (civilisation). La critique traditionnelle estime que Corneille est hostile aux passions, ce à quoi s’oppose Bénichou : Corneille exalte les passions. Mme de Sévigné parle de « tirades qui nous font frissonner », tandis qu’on finira par imposer à Corneille une conception froide et puritaine, sublime par la contrainte et l’effort (bourgeoisie). Lanson exclut l’affectivité de Corneille. Or Bénichou rappelle la scène 4 de l’Acte III du Cid : entrevue nocturne inspirant une pitié profonde (bien différente d’une admiration froide et intellectuelle). De la dignité de l’homme → Pic de la Mirandole s’inscrit contre une tradition pessimiste, doloriste, augustinienne. Pensée renaissante : grandeur humaine (Rabelais, Corneille). Jansénisme : faiblesses (Pascal, Racine, Augustin). Corneille est défini comme ennemi des passions, parce qu’il ne montre pas les ravages de celles-ci. Racine : la passion (Vénus) est une puissance transcendante, mortifère « à sa proie attachée » (Phèdre). Face à la figure de Phèdre se dresse celle de Rodrigue : la passion ne fait pas son malheur à la fin de la pièce → l’éclat du succès est plus important que la concession du sacrifice tragique. Rodrigue finit pas tout conquérir, par les passions : cœur = courage, et pas un devoir abstrait. Chez Corneille, la passion institue le héros sans le détruire : la passion et la morale ne font qu’une. Rodrigue/Don Diègue → recherchent l’honneur. Le grand récit de la bataille contre les Maures est une auto-célébration de Rodrigue. Bénichou soutient que les femmes expriment cette gloire dans la conquête d’un époux puissant : l’Infante n’aime pas Rodrigue mais Le Cid. Bénichou cite Voltaire : celui-ci voit dans Rodrigue un nouveau capitan, un soldat fanfaron. Bénichou montre que les grands contemporains et les héros du théâtre usent de la même morale spetaculaire. Dans Le Cid, la gloire vient du spectacle de la réussite dans un « défi à la force ». La barbarie, chez Bénichou, est le contraire de la civilisation : volonté de puissance individuelle → négation du partage de l’humanité. Bénichou parle de « grandeur d’âme dans la crime ». Don Gormas ne tue pas Don Diègue : ce n’est pas de la clémence, mais une humiliation. Sublimation : l’orgueil devant l’échec potentiel, l’« héroïsme barbare » (→ Rodrigue est le représentant de l’honneur familial). Cléopâtre, dans Rodogune, est dominée par son objet de désir (trône) → elle ne peut dominer son désir de puissance. Auguste, dans Cinna, surpasse son désir de vengeance et par là en tire une gloire supérieure (« Je suis maître de moi et de l’univers »). Auguste rejette la clémence par calcul de Livie (politique), sublimant ainsi l’« orgueil » et se faisant son propre thuriféraire (célébrateur). Amadis, l’avatar de tous les chevaliers, cherche à être digne d’Oriane..... »
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Etude linéaire; La Médée de corneille
- C. E. 20 juin 1913, TERY, Rec. 736, concl. Corneille
- Médée de Corneille Résumé scène par scène
- Corrigé Commentaire de texte L’Illusion comique, Corneille, 1634
- LA : Médée de Corneille