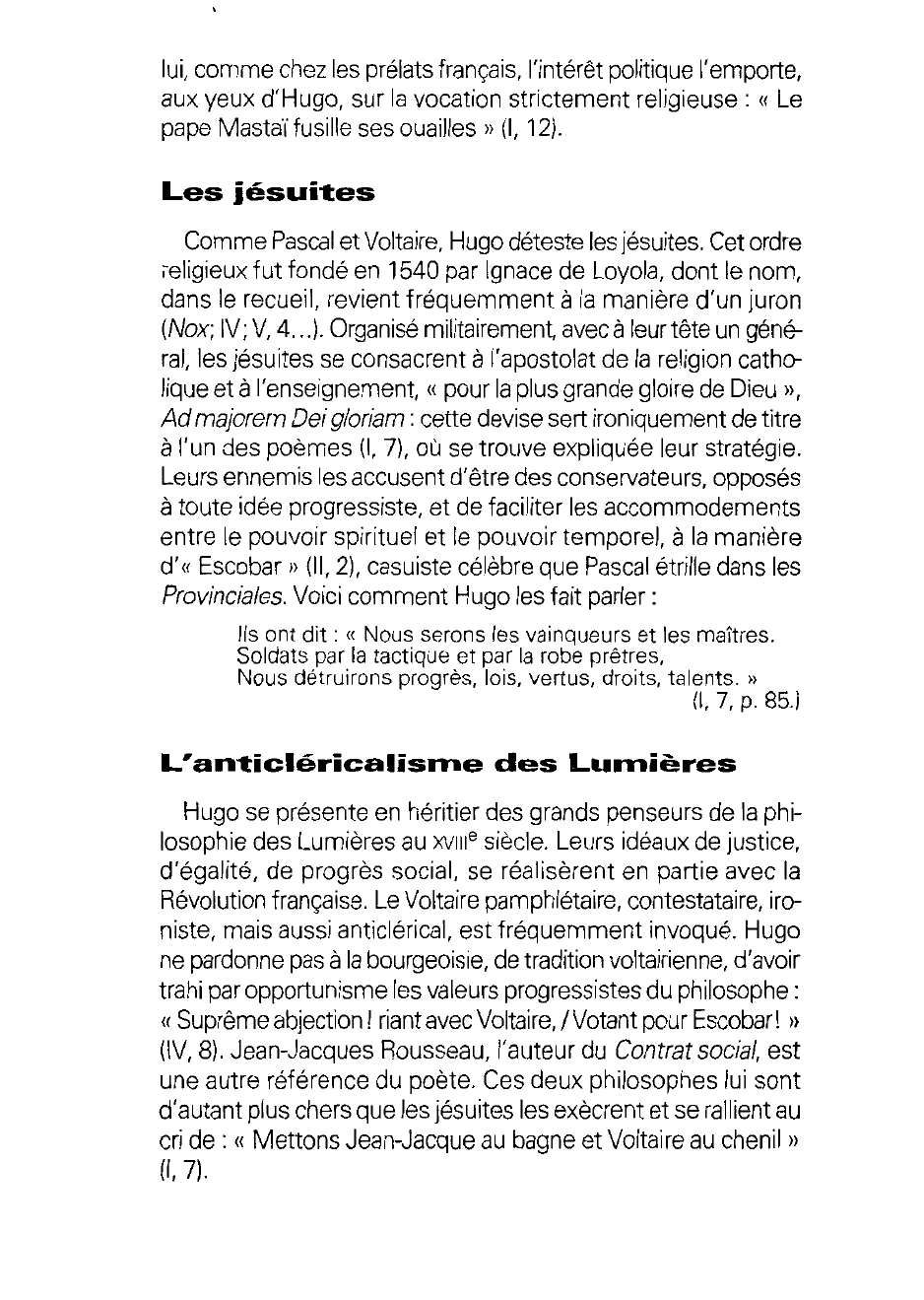Dieu et la religion DANS Les ''Châtiments'' de Victor Hugo
Publié le 14/03/2015

Extrait du document


«
lui, comme chez les prélats français, l'intérêt politique l'emporte,
aux yeux d'Hugo, sur la vocation strictement religieuse: « Le
pape Mastaï fusille ses ouailles » (1, 12).
Les jésuites
Comme Pascal et Voltaire, Hugo déteste les jésuites.
Cet ordre
ïeligieux fut fondé en 1540 par Ignace de Loyola, dont le nom,
dans le recueil, revient fréquemment à la manière d'un juron
(Nox; IV; V, 4 ...
).
Organisé militairement, avec à leur tête un géné
ral, les jésuites se consacrent à l'apostolat de la religion catho
lique et à l'enseignement,« pour la plus grande gloire de Dieu»,
Ad majorem Dei gloriam: cette devise sert ironiquement de titre
à l'un des poèmes (1, 7).
où se trouve expliquée leur stratégie.
Leurs ennemis les accusent d'être des conservateurs, opposés
à toute idée progressiste, et de faciliter les accommodements
entre
le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, à la manière
d'
« Escobar» (Il, 2), casuiste célèbre que Pascal étrille dans les
Provinciales.
Voici comment Hugo les fait parler:
Ils ont dit: " Nous serons les vainqueurs et les maîtres.
Soldats par la tactique et par la robe prêtres,
Nous détruirons progrès, lois, vertus, droits, talents.
» (1, 7, p.
85.)
L'anticléricalisme des Lumières
Hugo se présente en héritier des grands penseurs de la phi
losophie des Lumières au xv111 8 siècle.
Leurs idéaux de justice,
d'égalité, de progrès social, se réalisèrent en partie avec la
Révolution française.
Le Voltaire pamphlétaire, contestataire, iro
niste, mais aussi anticlérical, est fréquemment invoqué.
Hugo
ne pardonne pas à la bourgeoisie, de tradition voltairienne, d'avoir
trahi par opportunisme les valeurs progressistes du philosophe :
« Suprême abjection ! riant avec Voltaire,/ Votant pour Escobar! »
(IV, 8).
Jean-Jacques Rousseau, l'auteur du Contrat social, est
une autre référence du poète.
Ces deux philosophes lui sont
d'autant
plus chers que les jésuites les exècrent et se rallient au
cri de : « Mettons Jean-Jacque au bagne et Voltaire au chenil »
(1, 7).
53.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Livre IV: La religion est glorifiée - Les Châtiments de Victor HUGO (Résumé & Analyse)
- DIEU Victor Hugo (résumé & analyse)
- CHÂTIMENTS de Victor Hugo (résume et analyse complète)
- DIEU de Victor Hugo (résumé et analyse)
- CHÂTIMENTS (Les) Victor Hugo - résumé de l'oeuvre