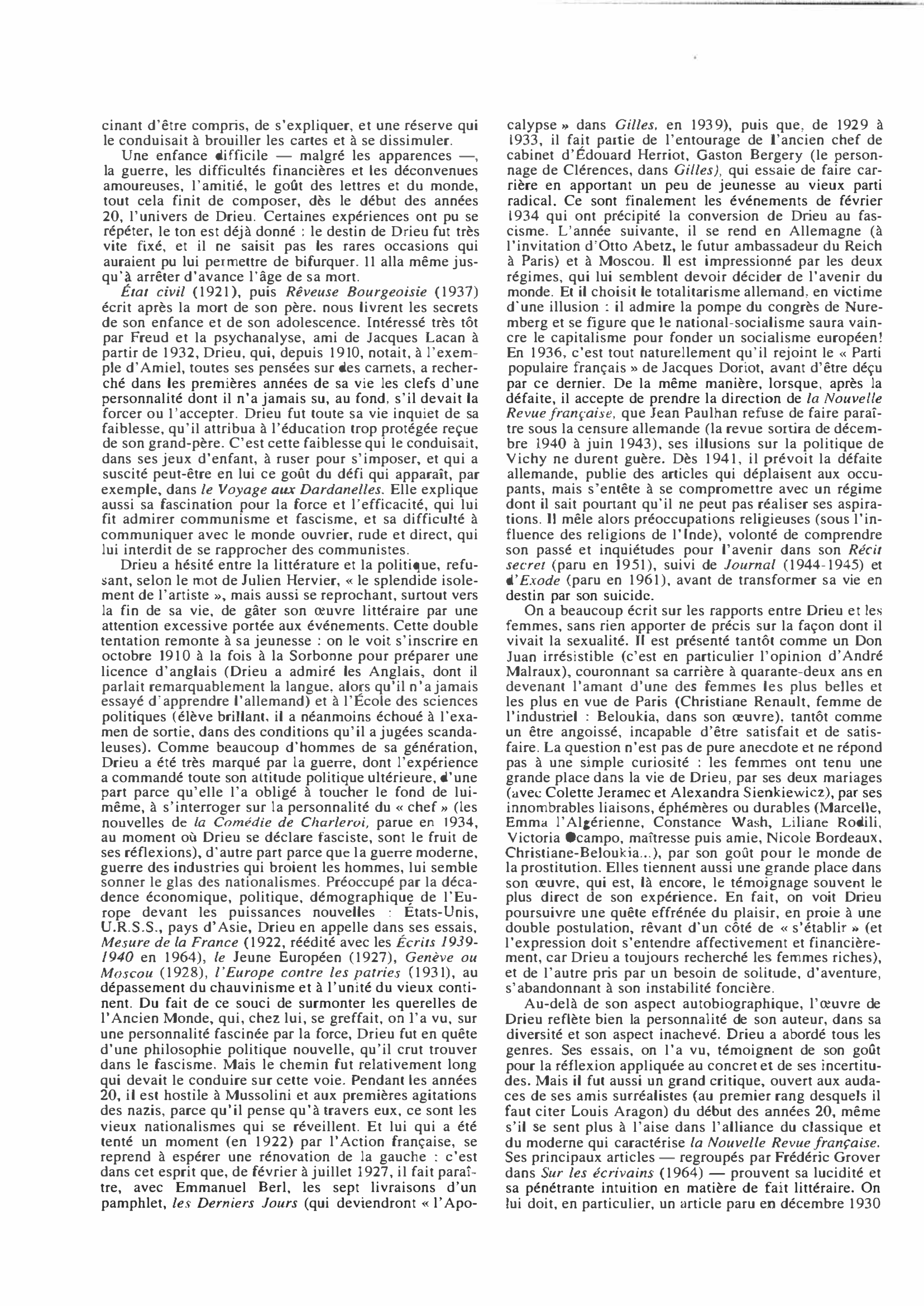DRIEU LA ROCHELLE Pierre : sa vie et son oeuvre
Publié le 22/11/2018

Extrait du document
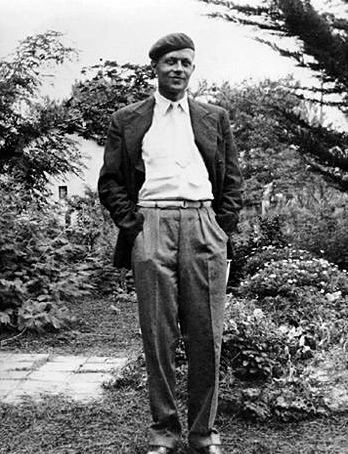
DRIEU LA ROCHELLE Pierre (1893-1945). Il est encore difficile de parler de Drieu La Rochelle : peu de personnalités de son époque sont aussi contestées que la sienne, même si d’autres sont plus radicalement condamnées; et de cet état de choses, son engagement politique est, pour l’essentiel, responsable. Mais c’est aussi que la nature même de son œuvre conduit à faire dépendre le jugement que l’on porte sur elle de celui que l’on a sur l’homme : « J’ai envie de raconter une histoire. Saurai-je un jour raconter autre chose que mon histoire? » sont les deux phrases qui ouvrent, en 1921, État civil. Il est presque impossible, chez Drieu, de séparer la vie de l’œuvre, tant son œuvre s’est nourrie de sa vie et tant il s’est appliqué à vivre sur un mode esthétique et littéraire.
Difficile à saisir, Drieu l’est aussi par ses contradictions : contradictions personnelles, mais aussi de l’époque, dont on dirait qu'il la fait jouer en lui pour en livrer toutes les résonances. Drieu fut un des témoins les plus intéressants de son temps, car peu d’hommes sentirent autant ce monde par intuition, sans arriver toujours à l’expliquer. De plus, il était déchiré entre un besoin lancinant d’être compris, de s’expliquer, et une réserve qui le conduisait à brouiller les cartes et à se dissimuler.
Une enfance difficile — malgré les apparences —, la guerre, les difficultés financières et les déconvenues amoureuses, l’amitié, le goût des lettres et du monde, tout cela finit de composer, dès le début des années 20, l’univers de Drieu. Certaines expériences ont pu se répéter, le ton est déjà donné : le destin de Drieu fut très vite fixé, et il ne saisit pas les rares occasions qui auraient pu lui permettre de bifurquer. Il alla même jusqu’à arrêter d’avance l’âge de sa mort.
État civil (1921), puis Rêveuse Bourgeoisie (1937) écrit après la mort de son père, nous livrent les secrets de son enfance et de son adolescence. Intéressé très tôt par Freud et la psychanalyse, ami de Jacques Lacan à partir de 1932, Drieu, qui, depuis 1910, notait, à l’exemple d’Amiel, toutes ses pensées sur des carnets, a recherché dans les premières années de sa vie les clefs d’une personnalité dont il n’a jamais su, au fond, s’il devait la forcer ou l’accepter. Drieu fut toute sa vie inquiet de sa faiblesse, qu’il attribua à l’éducation trop protégée reçue de son grand-père. C’est cette faiblesse qui le conduisait, dans ses jeux d’enfant, à ruser pour s’imposer, et qui a suscité peut-être en lui ce goût du défi qui apparaît, par exemple, dans le Voyage aux Dardanelles. Elle explique aussi sa fascination pour la force et l’efficacité, qui lui fit admirer communisme et fascisme, et sa difficulté à communiquer avec le monde ouvrier, rude et direct, qui lui interdit de se rapprocher des communistes.
Drieu a hésité entre la littérature et la politique, refusant, selon le mot de Julien Hervier, « le splendide isolement de l’artiste », mais aussi se reprochant, surtout vers la fin de sa vie, de gâter son œuvre littéraire par une attention excessive portée aux événements. Cette double tentation remonte à sa jeunesse : on le voit s’inscrire en octobre 1910 à la fois à la Sorbonne pour préparer une licence d’anglais (Drieu a admiré les Anglais, dont il parlait remarquablement la langue, alors qu’il n’a jamais essayé d’apprendre l’allemand) et à l’École des sciences politiques (élève brillant, il a néanmoins échoué à l’examen de sortie, dans des conditions qu’il a jugées scandaleuses). Comme beaucoup d’hommes de sa génération, Drieu a été très marqué par la guerre, dont l’expérience a commandé toute son attitude politique ultérieure, d’une part parce qu’elle l’a obligé à toucher le fond de lui-même, à s’interroger sur la personnalité du « chef » (les nouvelles de la Comédie de Charleroi, parue en 1934, au moment où Drieu se déclare fasciste, sont le fruit de ses réflexions), d’autre part parce que la guerre moderne, guerre des industries qui broient les hommes, lui semble sonner le glas des nationalismes. Préoccupé par la décadence économique, politique, démographique de l'Europe devant les puissances nouvelles : États-Unis, U.R.S.S., pays d’Asie, Drieu en appelle dans ses essais, Mesure de la France (1922, réédité avec les Écrits 1939-1940 en 1964), le Jeune Européen (1927), Genève ou Moscou (1928), F Europe contre les patries (1931), au dépassement du chauvinisme et à l’unité du vieux continent. Du fait de ce souci de surmonter les querelles de l’Ancien Monde, qui, chez lui, se greffait, on l’a vu, sur une personnalité fascinée par la force, Drieu fut en quête d’une philosophie politique nouvelle, qu’il crut trouver dans le fascisme. Mais le chemin fut relativement long qui devait le conduire sur cette voie. Pendant les années 20, il est hostile à Mussolini et aux premières agitations des nazis, parce qu’il pense qu’à travers eux, ce sont les vieux nationalismes qui se réveillent. Et lui qui a été tenté un moment (en 1922) par l’Action française, se reprend à espérer une rénovation de la gauche : c’est dans cet esprit que, de février à juillet 1927, il fait paraître, avec Emmanuel Berl, les sept livraisons d’un pamphlet, les Derniers Jours (qui deviendront « l’Apo
calypse » dans Gilles, en 1939), puis que, de 1929 à 1933, il fait partie de l'entourage de l’ancien chef de cabinet d’Édouard Herriot, Gaston Bergery (le personnage de Clérences, dans Gilles), qui essaie de faire carrière en apportant un peu de jeunesse au vieux parti radical. Ce sont finalement les événements de février 1934 qui ont précipité la conversion de Drieu au fascisme. L’année suivante, il se rend en Allemagne (à l’invitation d'Otto Abetz, le futur ambassadeur du Reich à Paris) et à Moscou. Il est impressionné par les deux régimes, qui lui semblent devoir décider de l’avenir du monde. Et il choisit le totalitarisme allemand, en victime d’une illusion : il admire la pompe du congrès de Nuremberg et se figure que le national-socialisme saura vaincre le capitalisme pour fonder un socialisme européen! En 1936, c’est tout naturellement qu’il rejoint le « Parti populaire français » de Jacques Doriot, avant d’être déçu par ce dernier. De la même manière, lorsque, après la défaite, il accepte de prendre la direction de la Nouvelle Revue française, que Jean Paulhan refuse de faire paraître sous la censure allemande (la revue sortira de décembre 1940 à juin 1943), ses illusions sur la politique de Vichy ne durent guère. Dès 1941, il prévoit la défaite allemande, publie des articles qui déplaisent aux occupants, mais s’entête à se compromettre avec un régime dont il sait pourtant qu'il ne peut pas réaliser ses aspirations. Il mêle alors préoccupations religieuses (sous l’influence des religions de l’Inde), volonté de comprendre son passé et inquiétudes pour l’avenir dans son Récit secret (paru en 1951), suivi de Journal (1944-1945) et à'Exode (paru en 1961), avant de transformer sa vie en destin par son suicide.
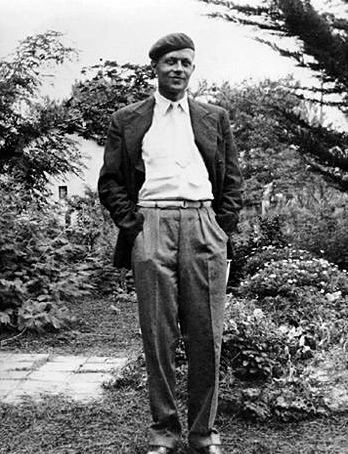
«
cinant
d'être compris, de s'expliquer, et une réserve qui
le conduisait à brouiller les cartes et à se dissimuler.
Une enfance difficile -malgré les apparences -,
la guerre, les difficultés financières et les déconvenues
amoureuses, l'amitié, le goOt des lettres et du monde,
tout cela finit de composer, dès le début des années
20, l'univers de Drieu.
Certaines expériences ont pu se
répéter, le ton est déjà donné : le destin de Drieu fut très
vite fixé, et il ne saisit pas les rares occasions qui
auraient pu lui permettre de bifurquer.
11 alla même jus
qu'� arrêter d'avance l'âge de sa mort.
Etat civil (1921), puis Rêveuse Bourgeoisie (1937)
écrit après la mort de son père, nous livrent les secrets
de son enfance et de son adolescence.
Intéressé très tôt
par Freud et la psychanalyse, ami de Jacques Lacan à
partir de 1932, Drieu, qui, depuis 1910, notait, à l'exem
ple d'Amie!, toutes ses pensées sur des carnets, a recher
ché dans les premières années de sa vie les clefs d'une
personnalité dont il n'a jamais su, au fond, s'il devait la
forcer ou 1' accepter.
Drieu fut toute sa vie inquiet de sa
faiblesse, qu'il attribua à l'éducation trop protégée reçue
de son grand-père.
C'est cette faiblesse qui le conduisait,
dans ses jeux d'enfant, à ruser pour s'imposer, et qui a
suscité peut-être en lui ce goOt du défi qui apparaît, par
exemple, dans le Voyage aux Dardanelles.
Elle explique
aussi sa fascination pour la force et l'efficacité, qui lui
fit admirer communisme et fascisme, et sa difficulté à
communiquer avec le monde ouvrier, rude et direct, qui
lui interdit de se rapprocher des communistes.
Drieu a hésité entre la littérature et la politique, refu
sant, selon le mot de Julien Hervier, «le splendide isole
ment de l'artiste », mais aussi se reprochant, surtout vers
la fin de sa vie, de gâter son œuvre littéraire par une
attention excessive portée aux événements.
Cette double
tentation remonte à sa jeunesse : on le voit s'inscrire en
octobre 191 0 à la fois à la Sorbonne pour préparer une
licence d'anglais (Drieu a admiré les Anglais, dont il
parlait remarquablement la langue, alors qu'il n'a jamais
essayé d'apprendre l'allemand) et à l'Ecole des sciences
politiques (élève brillant, il a néanmoins échoué à l'exa
men de sortie, dans des conditions qu'il a jugées scanda
leuses).
Comme beaucoup d'hommes de sa génération,
Drieu a été très marqué par la guerre, dont l'expérience
a commandé toute son attitude politique ultérieure, d'une
part parce qu'elle l'a obligé à toucher le fond de lui
même, à s'interroger sur la personnalité du «chef» (les
nouvelles de la Comédie de Charleroi, parue en 1934,
au moment où Drieu se déclare fasciste, sont le fruit de
ses réflexions), d'autre part parce que la guerre moderne,
guerre des industries qui broient les hommes, lui semble
sonner le glas des nationalismes.
Préoccupé par la déca
dence économique, politique, démographique de l'Eu
rope devant les puissances nouvelles : États-Unis,
U.R.S.S., pays d'Asie, Drieu en appelle dans ses essais,
Mesure de la France (1922, réédité avec les Écrits 1939-
1940 en 1964), le Jeune Européen (1927), Genève ou
Moscou (1928), l'Europe contre les patries (1931), au
dépassement du chauvinisme et à l'unité du vieux conti
nent.
Du fait de ce souci de surmonter les querelles de
l'Ancien Monde, qui, chez lui, se greffait, on J'a vu, sur
une personnalité fascinée par la force, Drieu fut en quête
d'une philosophie politique nouvelle, qu'il crut trouver
dans le fascisme.
Mais le chemin fut relativement long
qui devait le conduire sur cette voie.
Pendant les années
20, il est hostile à Mussolini et aux premières agitations
des nazis, parce qu'il pense qu'à travers eux, ce sont les
vieux nationalismes qui se réveillent.
Et lui qui a été
tenté un moment (en 1922) par l'Action française, se
reprend à espérer une rénovation de la gauche : c'est
dans cet esprit que, de février à juillet 1927, il fait paraî
tre, avec Emmanuel Berl, les sept livraisons d'un
pamphlet, les Derniers Jours (qui deviendront «l' Apo- calypse
» dans Gilles, en 1939), puis que, de 1929 à
1933, il fait partie de l'entourage de 1' ancien chef de
cabinet d'Édouard Herriot, Gaston Bergery (le person
nage de Clérences, dans Gilles), qui essaie de faire car
rière en apportant un peu de jeunesse au vieux parti
radical.
Ce sont finalement les événements de février
1934 qui ont précipité la conversion de Drieu au fas
cisme.
L'année suivante, il se rend en Allemagne (à
l'invitation d'Otto Abetz, le futur ambassadeur du Reich
à Paris) et à Moscou.
Il est impressionné par les deux
régimes, qui lui semblent devoir décider de l'avenir du
monde.
Et il choisit le totalitarisme allemand, en victime
d'une illusion : il admire la pompe du congrès de Nure
mberg et se figure que le national-socialisme saura vain
cre le capitalisme pour fonder un socialisme européen!
En 1936, c'est tout naturellement qu'il rejoint le« Parti
populaire français» de Jacques Doriot, avant d'être déçu
par ce dernier.
De la même manière, lorsque, après la
défaite, il accepte de prendre la direction de la Nouvelle
Revue française, que Jean Paulhan refuse de faire paraî
tre sous la censure allemande (la revue sortira de décem
bre 1940 à juin 1943), ses illusions sur la politique de
Vichy ne durent guère.
Dès 1941, il prévoit la défaite
allemande, publie des articles qui déplaisent aux occu
pants, mais s'entête à se compromettre avec un régime
dont il sait pourtant qu'il ne peut pas réaliser ses aspira
tions.
Il mêle alors préoccupations religieuses (sous l'in
fluence des religions de l'Inde), volonté de comprendre
son passé et inquiétudes pour l'avenir dans son Récit
secret (paru en 1951), suivi de Journal (1944-1945) et
d'Exode (paru en 1961 ), avant de transformer sa vie en
destin par son suicide.
On a beaucoup écrit sur les rapports entre Drieu et les
femmes, sans rien apporter de précis sur la façon dont il
vivait la sexualité.
JI est présenté tantôt comme un Don
Juan irrésistible (c'est en particulier l'opinion d'André
Malraux), couronnant sa carrière à quarante-deux ans en
devenant l'amant d'une des femmes les plus belles et
les plus en vue de Paris (Christiane Renault, femme de
l'industriel : Beloukia, dans son œuvre), tantôt comme
un être angoissé, incapable d'être satisfait et de satis
faire.
La question n'est pas de pure anecdote et ne répond
pas à une simple curiosité : les femmes ont tenu une
grande place dans la vie de Drieu, par ses deux mariages
(avec Colette Jeramec et Alexandra Sienkiewicz), par ses
innombrables liaisons, éphémères ou durables (Marcelle,
Emma l'Algérienne, Constance Wash, Liliane Rodili,
Victoria Ocampo, maîtresse puis amie, Nicole Bordeaux,
Christiane-Beloukia ...
), par son goût pour le monde de
la prostitution.
Elles tiennent aussi une grande place dans
son œuvre, qui est, là encore, le témoignage souvent le
plus direct de son expérience.
En fait, on voit Drieu
poursuivre une quête effrénée du plaisir, en proie à une
double postulation, rêvant d'un côté de «s'établir» (et
l'expression doit s'entendre affectivement et financière
ment, car Drieu a toujours recherché les femmes riches),
et de l'autre pris par un besoin de solitude, d'aventure,
s'abandonnant à son instabilité foncière.
Au-delà de son aspect autobiographique, l'œuvre de
Drieu reflète bien la personnalité de son auteur, dans sa
diversité et son aspect inachevé.
Drieu a abordé tous les
genres.
Ses essais, on l'a vu, témoignent de son goOt
pour la réflexion appliquée au concret et de ses incertitu
des.
Mais il fut aussi un grand critique, ouvert aux auda
ces de ses amis surréalistes (au premier rang desquels il
faut citer Louis Aragon) du début des années 20, même
s'il se sent plus à l'aise dans l'alliance du classique et
du moderne qui caractérise la Nouvelle Revue française.
Ses principaux articles -regroupés par Frédéric Grover
dans Sur les écrivains (1964)-prouvent sa lucidité et
sa pénétrante intuition en matière de fait littéraire.
On
lui doit, en particulier, un article paru en décembre 1930.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- FEU FOLLET (le). Roman de Pierre Drieu la Rochelle (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- TEILHARD DE CHARDIN Pierre (vie et oeuvre)
- SAINT-PIERRE, Charles Irénée Castel, abbé de (vie et oeuvre)
- BLÈCHE de Pierre Drieu La Rochelle (résumé & analyse)
- RÊVEUSE BOURGEOISIE. de Pierre Drieu la Rochelle