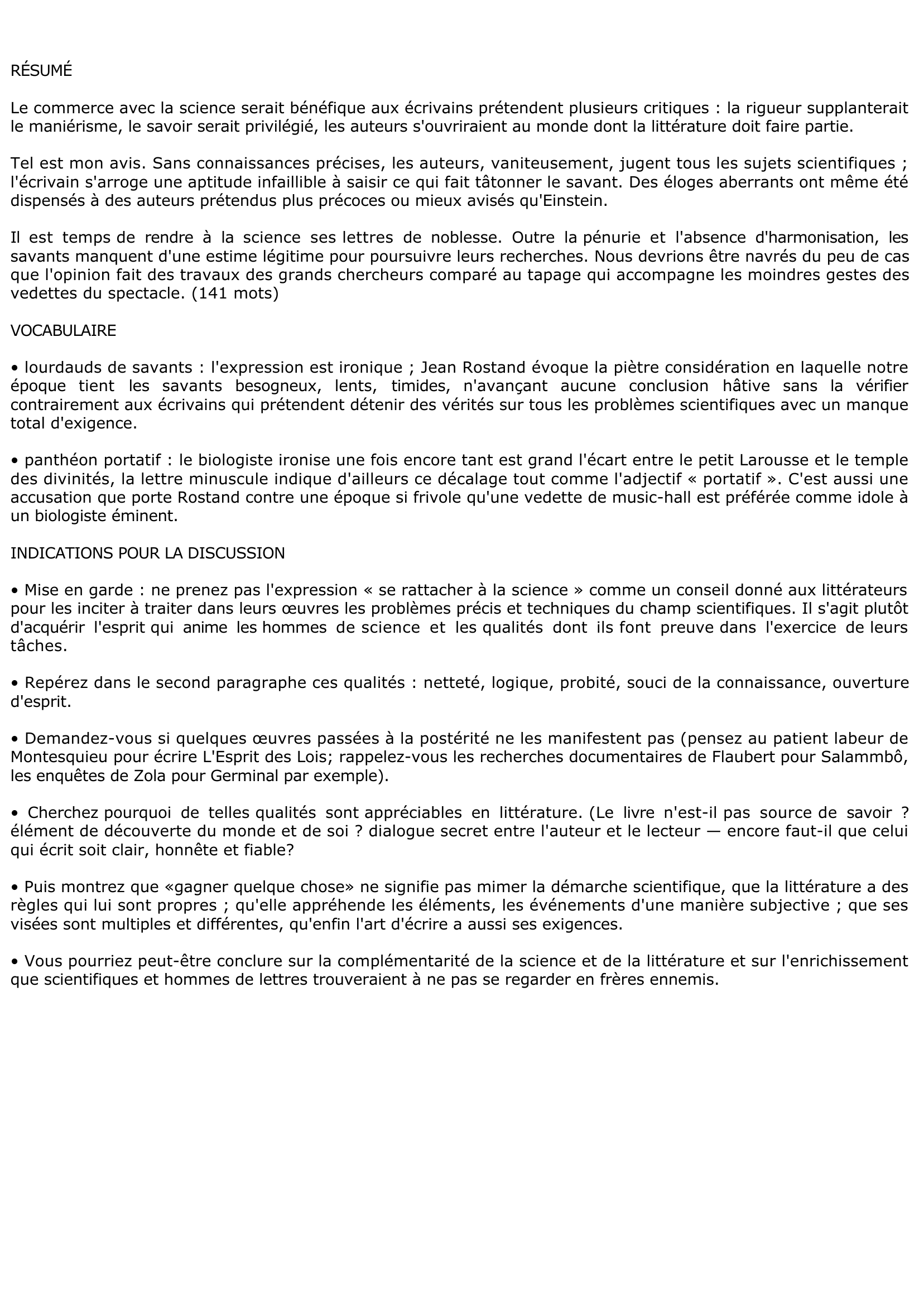DU RÔLE ET DE LA PLACE DE LA SCIENCE DANS LA VIE MODERNE
Publié le 28/03/2011

Extrait du document
Si je vous disais, Messieurs, que même la littérature de notre temps semble parfois pâtir d'être restée à l'écart du mouvement scientifique, vous m'accuseriez sans doute de partialité. Et telle est cependant l'opinion que soutiennent, chez nous, de brillants critiques littéraires. Etiemble déplore, chez les écrivains d'aujourd'hui, l'absence des qualités scientifiques — netteté, logique, probité — où il voit l'antidote d'une certaine préciosité formelle. Daniel Guérin leur reproche de sacrifier au souci esthétique le souci de la connaissance. Albérès dénonce leur étroitesse de vision, le confinement de leurs préoccupations, par rapport aux grands auteurs du XVIIIe et du XIXe. Si la littérature, dit-il, doit nous aider à vivre, il convient qu'elle s'intègre à la totalité de la vie, à la totalité du monde. Comme ces experts, j'estime que les lettres elles-mêmes pourraient gagner quelque chose à se rattacher à la science autrement que par la « science-fiction «. Et aussi je pense qu'un minimum de culture scientifique épargnerait à certains littérateurs de regrettables bévues. Car l'ignorance est présomptueuse et ne se prive point de juger. Nous la voyons qui opine, qui tranche sur les problèmes les plus délicats ; elle prend parti bruyamment sur les mécanismes de l'évolution, sur la génétique mendélienne, sur l'origine de l'homme, sur la transmission de l'acquis, sur la valeur de la psychanalyse, sur la métapsychie2 ou la radiesthésie. L'écrivain n'est-il pas apte à tout connaître sans rien savoir, pour peu qu'il possède le flair, l'intuition, les «antennes«, grâce à quoi il appréhende directement le réel et arrive, de prime saut, à des conclusions où ces lourdauds de savants n'atteignent — s'ils y atteignent — que tout essoufflés, à bout d'expériences, de mesures ou d'équations ? Confusionnisme qui puérilise les plus légitimes admirations ! N'a-t-on pas poussé le ridicule jusqu'à écrire très sérieusement que Paul Claude4 avait devancé Einstein et que Jean Cocteau4 avait «transposé en clair ce que les théories de la relativité proposaient en formules obscures. « ? Nous avons beaucoup à faire, — du moins chez nous, car il va de soi que je ne me permettrai, ici, de parler que de la France — nous avons beaucoup à faire avant que la science occupe, non pas la place qui lui reviendrait de droit, mais simplement une place un peu décente. Et, ce disant, je ne songe pas à l'insuffisance dérisoire des moyens matériels mis à la disposition des chercheurs, ni à l'incoordination des efforts individuels. Non, je songe à l'atmosphère spirituelle, au climat moral dans lequel travaillent ces hommes qui, ayant choisi un si haut métier et si bénéfique à leur prochain, ne reçoivent de l'opinion qu'un si piètre encouragement. Volontiers on déplore la raréfaction des chercheurs, la disparition des prix Nobel... et l'on incrimine la seule misère des laboratoires, alors que la faute en retombe plutôt sur la légèreté, la futilité collectives. Affaire d'âme autant que de crédits. L'étonnant, pour moi, voyez-vous, c'est qu'il y ait encore, chez nous, autant de vocations scientifiques. Nous n'avons pas de quoi être bien fiers lorsque, ouvrant le petit Larousse — ce panthéon portatif — nous y trouvons le nom de Mistinguett mais non pas celui de Bataillon. Nous n'avons pas de quoi être fiers quand nous voyons que la mort d'un grand savant a un moindre retentissement dans notre presse que celle d'un fox-terrier de vedette, quand nous voyons que les «demeures sacrées « — comme disait Pasteur — ne sont pas les laboratoires, mais les studios de cinéma, que les amuseurs passent avant les sauveurs, les gens qui font la mode avant ceux qui changent le monde, et que la découverte d'un nouvel antibiotique agite moins l'opinion que l'émergence d'un nouveau chanteur de charme... Jean Rostand, Discours à l'Académie internationale de Culture française, 1956.
1. Vous ferez de ce texte un résumé en 135 mots. Une marge de 10 % en plus ou en moins est toutefois admise. Vous indiquerez à la fin de votre résumé le nombre de mots employés (8 points).
2. Vous expliquerez le sens dans le texte des expressions suivantes : — « lourdauds de savants «, — « panthéon portatif «. Votre réponse devra être entièrement rédigée (2 points).
3. Pensez-vous, comme Jean Rostand, que « les lettres elles-mêmes pourraient gagner quelque chose à se rattacher à la science « ? Vous exprimerez votre avis de façon ordonnée et argumentée, en vous référant à votre expérience personnelle et à vos lectures (10 points).
«
RÉSUMÉ
Le commerce avec la science serait bénéfique aux écrivains prétendent plusieurs critiques : la rigueur supplanteraitle maniérisme, le savoir serait privilégié, les auteurs s'ouvriraient au monde dont la littérature doit faire partie.
Tel est mon avis.
Sans connaissances précises, les auteurs, vaniteusement, jugent tous les sujets scientifiques ;l'écrivain s'arroge une aptitude infaillible à saisir ce qui fait tâtonner le savant.
Des éloges aberrants ont même étédispensés à des auteurs prétendus plus précoces ou mieux avisés qu'Einstein.
Il est temps de rendre à la science ses lettres de noblesse.
Outre la pénurie et l'absence d'harmonisation, lessavants manquent d'une estime légitime pour poursuivre leurs recherches.
Nous devrions être navrés du peu de casque l'opinion fait des travaux des grands chercheurs comparé au tapage qui accompagne les moindres gestes desvedettes du spectacle.
(141 mots)
VOCABULAIRE
• lourdauds de savants : l'expression est ironique ; Jean Rostand évoque la piètre considération en laquelle notreépoque tient les savants besogneux, lents, timides, n'avançant aucune conclusion hâtive sans la vérifiercontrairement aux écrivains qui prétendent détenir des vérités sur tous les problèmes scientifiques avec un manquetotal d'exigence.
• panthéon portatif : le biologiste ironise une fois encore tant est grand l'écart entre le petit Larousse et le templedes divinités, la lettre minuscule indique d'ailleurs ce décalage tout comme l'adjectif « portatif ».
C'est aussi uneaccusation que porte Rostand contre une époque si frivole qu'une vedette de music-hall est préférée comme idole àun biologiste éminent.
INDICATIONS POUR LA DISCUSSION
• Mise en garde : ne prenez pas l'expression « se rattacher à la science » comme un conseil donné aux littérateurspour les inciter à traiter dans leurs œuvres les problèmes précis et techniques du champ scientifiques.
Il s'agit plutôtd'acquérir l'esprit qui anime les hommes de science et les qualités dont ils font preuve dans l'exercice de leurstâches.
• Repérez dans le second paragraphe ces qualités : netteté, logique, probité, souci de la connaissance, ouvertured'esprit.
• Demandez-vous si quelques œuvres passées à la postérité ne les manifestent pas (pensez au patient labeur deMontesquieu pour écrire L'Esprit des Lois; rappelez-vous les recherches documentaires de Flaubert pour Salammbô,les enquêtes de Zola pour Germinal par exemple).
• Cherchez pourquoi de telles qualités sont appréciables en littérature.
(Le livre n'est-il pas source de savoir ?élément de découverte du monde et de soi ? dialogue secret entre l'auteur et le lecteur — encore faut-il que celuiqui écrit soit clair, honnête et fiable?
• Puis montrez que «gagner quelque chose» ne signifie pas mimer la démarche scientifique, que la littérature a desrègles qui lui sont propres ; qu'elle appréhende les éléments, les événements d'une manière subjective ; que sesvisées sont multiples et différentes, qu'enfin l'art d'écrire a aussi ses exigences.
• Vous pourriez peut-être conclure sur la complémentarité de la science et de la littérature et sur l'enrichissementque scientifiques et hommes de lettres trouveraient à ne pas se regarder en frères ennemis..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Rôle de l’imagination dans l'art, dans la science et dans la vie pratique.
- Le poète breton contemporain Eugène Guillevic écrit à propos de son art : « Je crois que la poésie est un moyen de connaissance, un des moyens d'apprendre le monde. Il y a toutes sortes de moyens de connaissance. Pour important que soit le rôle de la science, ce n'est pas le seul. Nous ne devons nous priver d'aucun de ces moyens. Il n'y a pas que la connaissance purement intellectuelle qui est connaissance. Après tout, le meilleur moyen de connaître une pomme, c'est de la manger... » Q
- Rôle de l'imagination dans l'art, dans la science et dans la vie pratique (PLAN)
- Le poète breton contemporain Eugène Guillevic écrit à propos de son art : « Je crois que la poésie est un moyen de connaissance, un des moyens d'apprendre le monde. Il y a toutes sortes de moyens de connaissance. Pour important que soit le rôle de la science, ce n'est pas le seul. Nous ne devons nous priver d'aucun de ces moyens. Il n'y a pas que la connaissance purement intellectuelle qui est connaissance. Après tout, le meilleur moyen de connaître une pomme, c'est de la manger... » Q
- Le Président de la République française sous la Ve République : sa place dans les institutions, son rôle dans la vie politique.