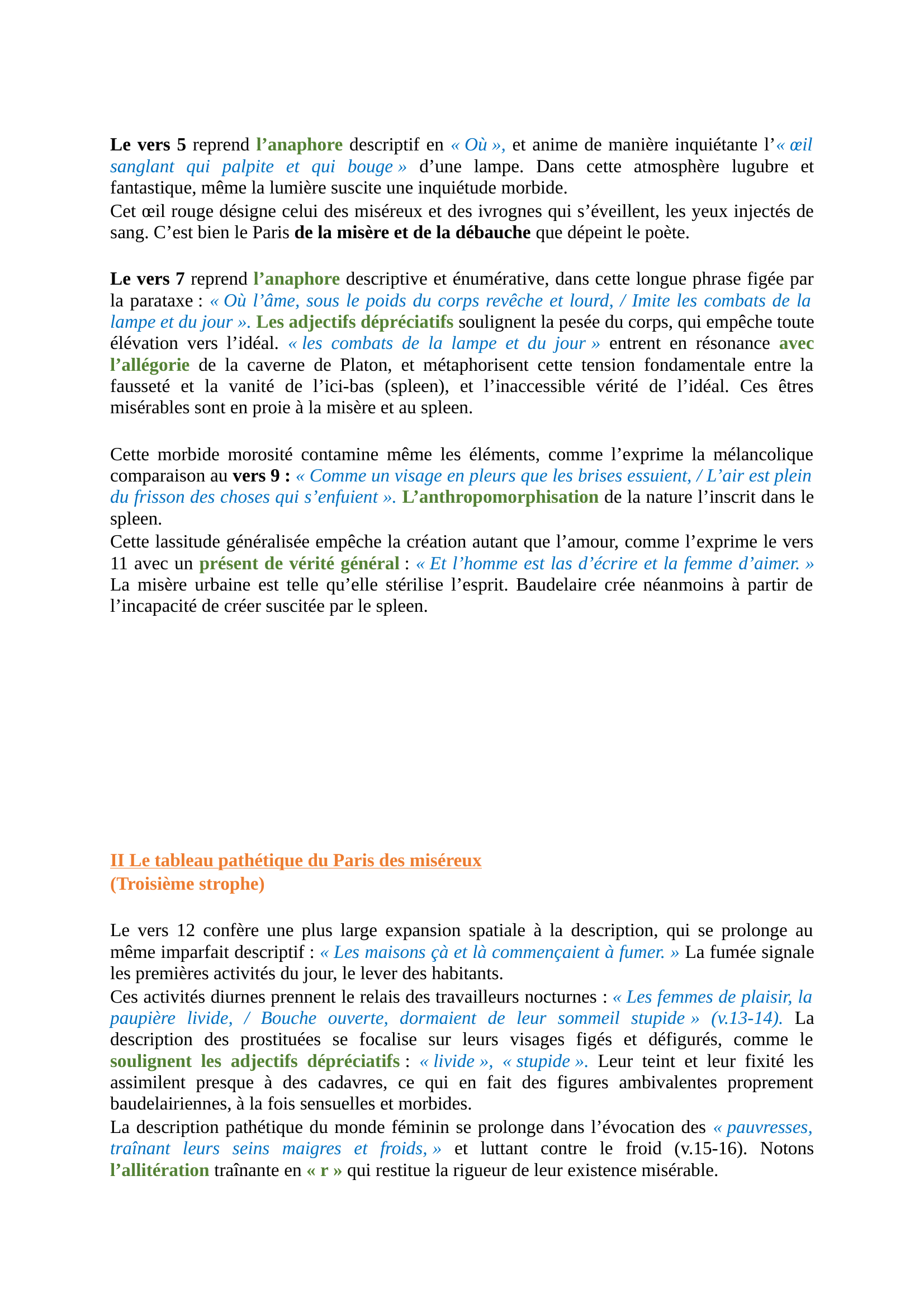explication lineaire crepuscule du matin
Publié le 26/05/2020

Extrait du document
Présentation
Baudelaire fut le témoin privilégié de l’urbanisation industrielle, dont Paris était la deuxième capitale mondiale. Le poète en souligne les beautés inédites, mais surtout l’horreur et la misère.
Les Fleurs du Mal désignent l’homme comme un être fondamentalement mélancolique, et en proie au spleen que la misère urbaine aggrave. Les « Tableaux parisiens » font de Paris une capitale infernale et impitoyable.
« Crépuscule du matin » clôt cette section, et fut d’abord publié en diptyque avec « Crépuscule du soir ». Ce poème est composé de vingt-huit alexandrins en rimes plates, et disposés en strophes inégales. Il dépeint l’atmosphère du Paris des miséreux au lever du soleil.
Problématique
Nous verrons comment ce poème, en évoquant Paris au matin, dépeint la misère pathétique de ses habitants les plus pauvres.
Plan
Dans une première partie, couvrant les deux premières strophes, un crépuscule morbide éveille des êtres en proie au spleen.
Puis, dans une deuxième partie correspondant à la troisième strophe, le poème peint le tableau pathétique du Paris des miséreux.
Enfin, dans une troisième partie, à la quatrième strophe, le poème évoque l’aurore et Paris, inquiétantes allégories de la jeune fille et de la mort.
I Un morbide crépuscule éveille des êtres en proie au spleen
(Deux premières strophes)
Le poème s’ouvre sur le chant de « La diane », tambour ou sonnerie destinées à réveiller les soldats à l’aube. Cette antonomase du nom de la déesse inscrit le poème dans un monde profane et militarisé, où la révolte sera matée.
C’est un monde vide encore : « les cours des casernes » sont vides, tandis que « le vent du matin soufflait ».
Cette première strophe s’anime déjà du vent qui souffle, annonçant l’éveil des habitants.
La deuxième strophe s’ouvre sur un imparfait itératif autant que descriptif (« C’était l’heure », v.3), et annonciateur d’un tableau parisien. Le poète se fait chroniqueur de son temps.
«
Le vers 5 reprend l’anaphore descriptif en « Où », et anime de manière inquiétante l’ « œil
sanglant qui palpite et qui bouge » d’une lampe.
Dans cette atmosphère lugubre et
fantastique, même la lumière suscite une inquiétude morbide.
Cet œil rouge désigne celui des miséreux et des ivrognes qui s’éveillent, les yeux injectés de
sang.
C’est bien le Paris de la misère et de la débauche que dépeint le poète.
Le vers 7 reprend l’anaphore descriptive et énumérative, dans cette longue phrase figée par
la parataxe : « Où l’âme, sous le poids du corps revêche et lourd, / Imite les combats de la
lampe et du jour ».
Les adjectifs dépréciatifs soulignent la pesée du corps, qui empêche toute
élévation vers l’idéal.
« les combats de la lampe et du jour » entrent en résonance avec
l’allégorie de la caverne de Platon, et métaphorisent cette tension fondamentale entre la
fausseté et la vanité de l’ici-bas (spleen), et l’inaccessible vérité de l’idéal.
Ces êtres
misérables sont en proie à la misère et au spleen.
Cette morbide morosité contamine même les éléments, comme l’exprime la mélancolique
comparaison au vers 9 : « Comme un visage en pleurs que les brises essuient, / L’air est plein
du frisson des choses qui s’enfuient ».
L’anthropomorphisation de la nature l’inscrit dans le
spleen.
Cette lassitude généralisée empêche la création autant que l’amour, comme l’exprime le vers
11 avec un présent de vérité général : « Et l’homme est las d’écrire et la femme d’aimer.
»
La misère urbaine est telle qu’elle stérilise l’esprit.
Baudelaire crée néanmoins à partir de
l’incapacité de créer suscitée par le spleen.
II Le tableau pathétique du Paris des miséreux
(Troisième strophe)
Le vers 12 confère une plus large expansion spatiale à la description, qui se prolonge au
même imparfait descriptif : « Les maisons çà et là commençaient à fumer.
» La fumée signale
les premières activités du jour, le lever des habitants.
Ces activités diurnes prennent le relais des travailleurs nocturnes : « Les femmes de plaisir, la
paupière livide, / Bouche ouverte, dormaient de leur sommeil stupide » (v.13-14).
La
description des prostituées se focalise sur leurs visages figés et défigurés, comme le
soulignent les adjectifs dépréciatifs : « livide », « stupide ».
Leur teint et leur fixité les
assimilent presque à des cadavres, ce qui en fait des figures ambivalentes proprement
baudelairiennes, à la fois sensuelles et morbides.
La description pathétique du monde féminin se prolonge dans l’évocation des « pauvresses,
traînant leurs seins maigres et froids, » et luttant contre le froid (v.15-16).
Notons
l’allitération traînante en « r » qui restitue la rigueur de leur existence misérable..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Texte : Nicolas Machiavel, Le Prince, chapitre 18
- Explication Lineaire de L'Incipit de L'Avis au Lecteur de Montaigne (bac de francais)
- explication lineaire la cour du lion
- EXPLICATION LINEAIRE MISANTHROPE MOLIERE
- EXPLICATION LINEAIRE MISANTHROPE MOLIERE