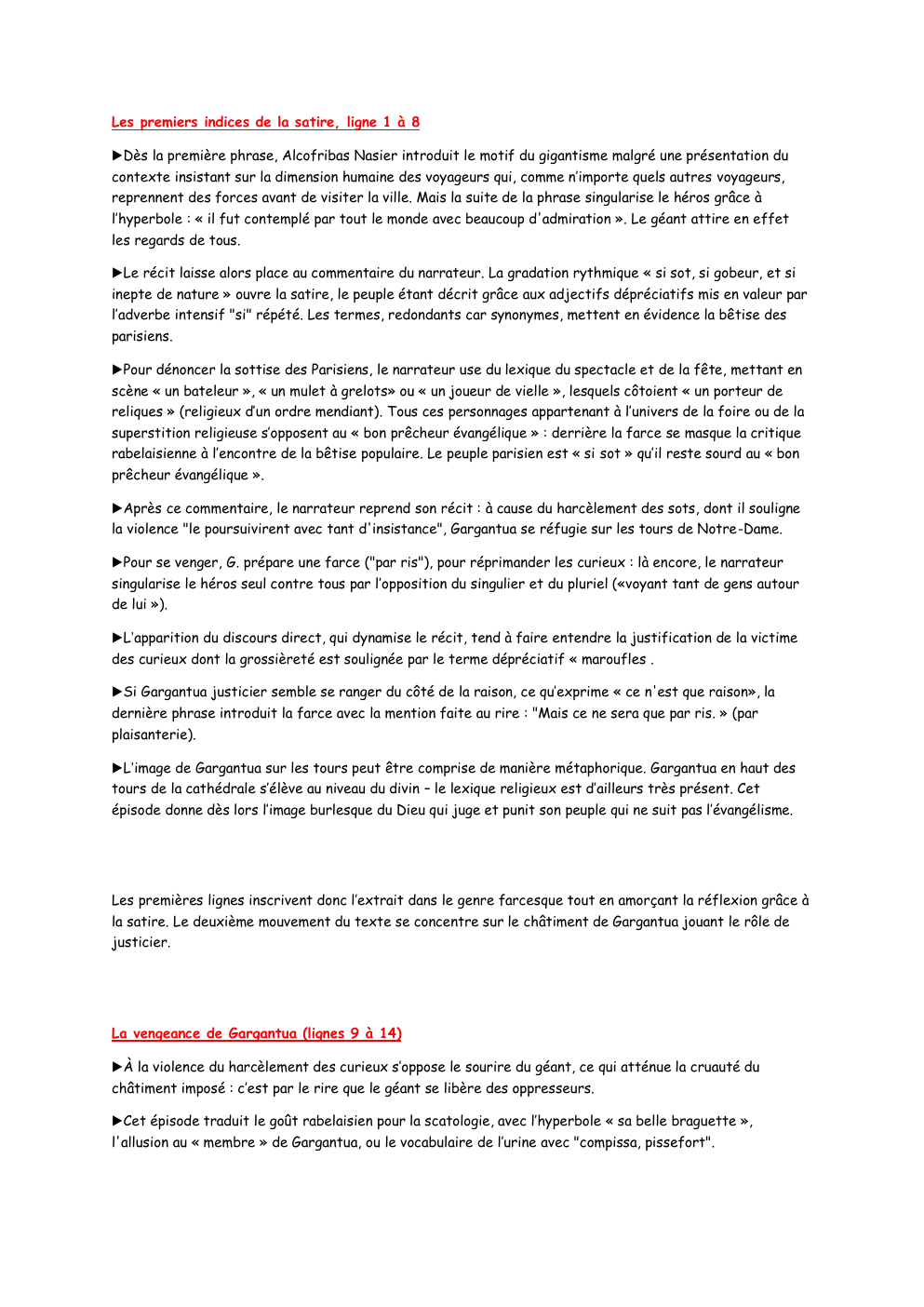explication lineaire gargantua chapitre 17
Publié le 28/02/2024
Extrait du document
«
Les premiers indices de la satire, ligne 1 à 8
▶Dès la première phrase, Alcofribas Nasier introduit le motif du gigantisme malgré une présentation du
contexte insistant sur la dimension humaine des voyageurs qui, comme n’importe quels autres voyageurs,
reprennent des forces avant de visiter la ville.
Mais la suite de la phrase singularise le héros grâce à
l’hyperbole : « il fut contemplé par tout le monde avec beaucoup d'admiration ».
Le géant attire en effet
les regards de tous.
▶Le récit laisse alors place au commentaire du narrateur.
La gradation rythmique « si sot, si gobeur, et si
inepte de nature » ouvre la satire, le peuple étant décrit grâce aux adjectifs dépréciatifs mis en valeur par
l’adverbe intensif "si" répété.
Les termes, redondants car synonymes, mettent en évidence la bêtise des
parisiens.
▶Pour dénoncer la sottise des Parisiens, le narrateur use du lexique du spectacle et de la fête, mettant en
scène « un bateleur », « un mulet à grelots» ou « un joueur de vielle », lesquels côtoient « un porteur de
reliques » (religieux d’un ordre mendiant).
Tous ces personnages appartenant à l’univers de la foire ou de la
superstition religieuse s’opposent au « bon prêcheur évangélique » : derrière la farce se masque la critique
rabelaisienne à l’encontre de la bêtise populaire.
Le peuple parisien est « si sot » qu’il reste sourd au « bon
prêcheur évangélique ».
▶Après ce commentaire, le narrateur reprend son récit : à cause du harcèlement des sots, dont il souligne
la violence "le poursuivirent avec tant d'insistance", Gargantua se réfugie sur les tours de Notre-Dame.
▶Pour se venger, G.
prépare une farce ("par ris"), pour réprimander les curieux : là encore, le narrateur
singularise le héros seul contre tous par l’opposition du singulier et du pluriel («voyant tant de gens autour
de lui »).
▶L’apparition du discours direct, qui dynamise le récit, tend à faire entendre la justification de la victime
des curieux dont la grossièreté est soulignée par le terme dépréciatif « maroufles .
▶Si Gargantua justicier semble se ranger du côté de la raison, ce qu’exprime « ce n'est que raison», la
dernière phrase introduit la farce avec la mention faite au rire : "Mais ce ne sera que par ris.
» (par
plaisanterie).
▶L’image de Gargantua sur les tours peut être comprise de manière métaphorique.
Gargantua en haut des
tours de la cathédrale s’élève au niveau du divin – le lexique religieux est d’ailleurs très présent.
Cet
épisode donne dès lors l’image burlesque du Dieu qui juge et punit son peuple qui ne suit pas l’évangélisme.
Les premières lignes inscrivent donc l’extrait dans le genre farcesque tout en amorçant la réflexion grâce à
la satire.
Le deuxième mouvement du texte se concentre sur le châtiment de Gargantua jouant le rôle de
justicier.
La vengeance de Gargantua (lignes 9 à 14)
▶À la violence du harcèlement des curieux s’oppose le sourire du géant, ce qui atténue la cruauté du
châtiment imposé : c’est par le rire que le géant se libère des oppresseurs.
▶Cet épisode traduit le goût rabelaisien pour la scatologie, avec l’hyperbole « sa belle braguette »,
l'allusion au « membre » de Gargantua, ou le vocabulaire de l’urine avec "compissa, pissefort".
▶Il s’agit ici d’une parodie d’un texte épique, puisque le flot d’urine remplace le flot de sang propre au
combat.
L’hyperbole est employée, avec la marque de l’intensif « si hardiment » et l’exagération du nombre
des victimes : 260 418 noyés.
▶À cette image relevant de l’héroïcomique se superpose la parodie d’un épisode biblique : le Déluge.
L’intertextualité biblique est d’ailleurs explicite avec la reprise d’une expression récurrente dans la Bible :
« exceptis mulieribus et parvulis », « sans compter les femmes et les petits enfants ».
▶Le narrateur oppose le nombre des victimes à celui des rescapés, lesquels se distinguent par leur lâcheté
comme le mettent en valeur le lexique de la fuite et le langage très imagé : « Quelques-uns d’entre eux
échappèrent à ce pissefort parce qu'ils avaient le pied léger.
»
▶La scène se passant au sein du quartier latin, fief de la faculté de Théologie, les fuyards se réfugient à la
Sorbonne, « au plus haut de la colline de l'université ».
S’ensuit la caricature de ces hommes « suant,
toussant, crachant, et hors d’haleine » : l’accumulation montre la satire des Sorbonnards.
La toux....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Texte 1: Gargantua, 1534 (extrait 2 ) chapitre XXIII
- GARGANTUA Chapitre XXVII
- Analyse Gargantua chapitre 27
- Analyse chapitre 23 Gargantua
- Fiche révision bac de français : Chapitre XXVII, Gargantua