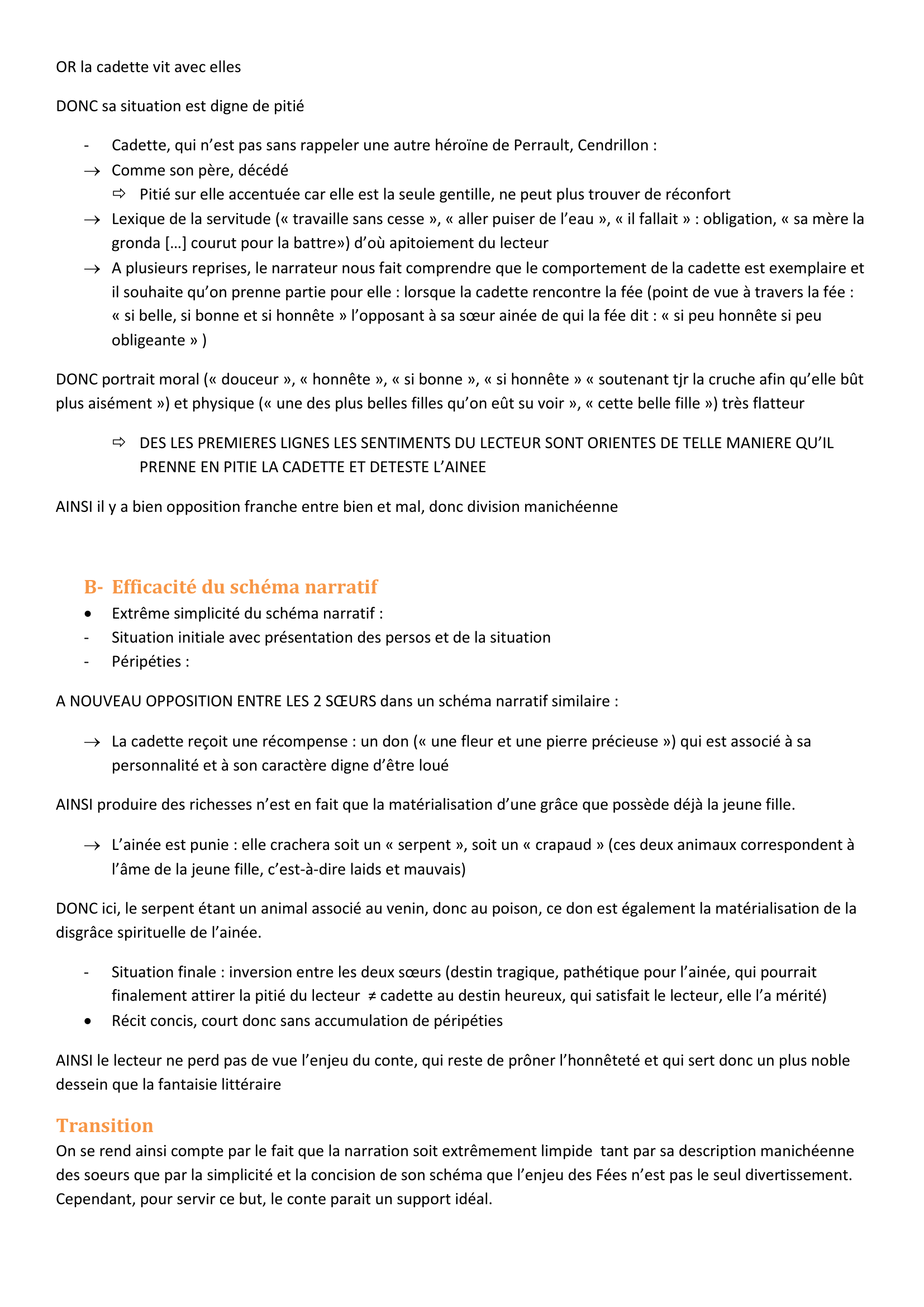Exposé Méthodologie « Les Fées », Perrault
Publié le 31/01/2016

Extrait du document

Exposé Méthodologie
« Les Fées », Perrault
Introduction
L’œuvre de Charles Perrault fut souvent comparée à celle de sa nièce, Mademoiselle Lhéritier. Ainsi en 1695, cette dernière publiait « les Enchantements de l’Eloquence », dont la morale (« Doux et courtois langage vaut mieux que riche héritage » rappelle étrangement celle du conte que son oncle écrivait la même année, « les Fées ».
Publié en 1697, ce conte traite justement des bienfaits du « doux parler », s’inscrivant ici clairement dans une optique galante, pour laquelle les gens se doivent d’être « honnêtes ». A LIRE SI PAS DE LECTURE DU CONTE (L’histoire est la suivante : une veuve a deux filles, elle adore l’une et abhorre (= déteste) l‘autre. Cette dernière, en allant chercher de l’eau à la fontaine, rencontre une fée. Face à l’innocence et à la gentillesse dont la jeune fille fait preuve envers elle, la fée la récompense en lui faisant sortir des pierres précieuses et des fleurs de la bouche à chaque parole. Voyant cela, la mère force sa préférée à y aller aussi, mais cette fois la fée se montre moins clémente, et voulant punir l’impolitesse et l’hypocrisie de « la brutale » (puisque c’est ainsi que l’ainée est nommée à plusieurs reprises), la maudit en faisant qu’elle crachera pour chaque parole, des serpents et des crapauds. La première sera ensuite aimée d’un prince et la seconde mourra seule au coin d’un bois car sa mère l’aura chassée de chez elle).
NOUS NOUS DEMANDERONS DONC COMMENT CE CONTE, PAR L’OPPOSITION QU’IL ETABLIT ENTRE 2 SŒURS, DELIVRE UNE MORALE AU LECTEUR.
Dans un premier temps, nous étudierons la division manichéenne qui s’établit dans la simplicité narrative de ce conte, dans un second temps nous verrons comment le merveilleux permet de délivrer aisément la morale et dans un dernier temps nous analyserons ce plaidoyer contre l’hypocrisie.

«
OR la cadette vit avec elles
DONC sa situation est digne de pitié
- Cadette , qui n’est pas sans rappeler une a utre héroïne de Perrault, Cendrillon :
→ Comme son père, décédé
Pitié sur elle accentuée car elle est la seule gentille, ne peut plus trouver de réconfort
→ Lexique de la servitude (« travaille sans cesse », « aller puiser de l’eau », « il fallait » : obligation , « sa mère la
gronda […] courut pour la battre») d’o ù apitoiement du lecteur
→ A plusieurs reprises, le narrateur nous fait comprendre que le comportement de la cadette est exemplaire et
il souhaite qu’on prenne partie pour elle : lorsque la cadette rencontre la fée (point de vue à travers la fée :
« si belle, si bonne et si honnête » l’opposant à sa sœur ainée de qui la fée dit : « si peu honnête si peu
obligeante » )
DONC portrait moral (« douceur », « honnête », « si bonne », « si honnête » « soutenant tjr la cruche afin qu’elle bût
plus aisément ») et physique (« une des plus belles filles qu’on eût su voir », « cette belle fille ») très flatteur
DES LES PREMIERES LIGNES LES SENTIMENTS DU LECTEUR SONT ORIENTES DE TELLE MANIERE QU’IL
PRENNE EN PITIE LA CAD ETTE ET DETESTE L’AINEE
AINSI il y a bien opposition franche entre bien et mal, donc division manichéenne
B - Efficacité du schéma narratif
• Extrême simplicité du schéma narratif :
- Situation initiale avec présentation des persos et de la situation
- Péripéties :
A NOUVEAU OPPOSITION ENTRE LES 2 SŒURS dans un schéma narratif similaire :
→ La cadette reçoit une récompense : un don (« une fleur et une pierre précieuse ») qui est associé à sa
personnalité et à son caractère digne d’être loué
AINSI produire des richesse s n’est en fait que la matérialisation d’une grâce que possède déjà la jeune fille .
→ L’ainée est punie : elle crachera soit un « serpent », soit un « crapaud » (ces deux animaux correspondent à
l’âme de la jeune fille, c’est -à -dire laids et mauvais)
DONC ici, le serpen t étant un animal associé au venin, donc au poison , ce don est également la matérialisation de la
disgrâce spirituelle de l’ainée.
- Situation finale : inversion entre les deux sœurs (destin tragique, pathétique pour l’ainée, qui pourrait
finalement attirer la pitié du lecteur ≠ cadette au destin heureux, qui satisfait le lecteur, elle l’a mérité)
• Récit concis, court donc sans accumulation de péripéties
AINSI le lecteur ne perd pas de vue l’enjeu du conte, qui reste de prôner l’honnêteté e t qui sert donc un plus noble
dessein que la fantaisie littéraire
Transition
On se rend ainsi compte par le fait que la narration soit extrêmement limpide tant par sa description manichéenne
des soeurs que par la simplicité et la concision de son schéma q ue l’enjeu des Fées n’est pas le seul divertissement.
Cependant, pour servir ce but, le conte parait un support idéal..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les fées charles perrault
- Charles Perrault, Les Fées (1695) Lecture Analytique
- Exposé sur Le chat Botté ou Le Maître Chat De Charles Perrault
- Commentaire : Les Fées de Charles Perrault
- Les Fées de Charles Perrault