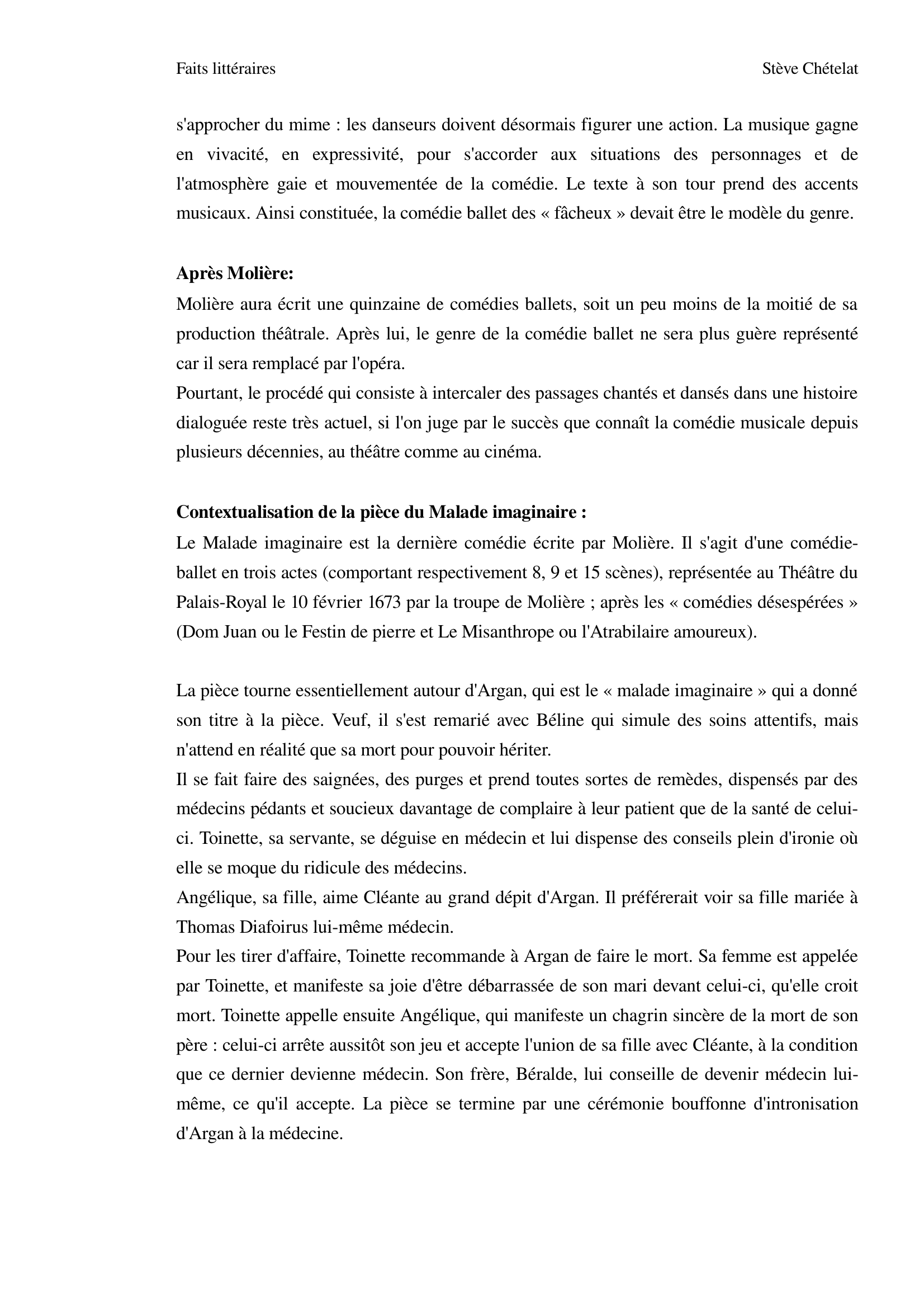Fait littéraire sur Le Malade Imaginaire
Publié le 10/12/2012

Extrait du document
Le mensonge médical OEuvre étudiée :Le Malade imaginaire, Molière (Edition folioplus, 2012) Présentation du fait littéraire : Eléments de contextualisation : Le Classicisme : Définition : "Classique" et "classicisme" désignent les auteurs de la seconde moitié du XVIIe siècle, siècle d'or de la littérature, qui développent une esthétique fondée sur l'idéal de perfection. Le classicisme français correspond à une période brève dans l'histoire de France, la première partie du règne personnel de Louis XIV (1661-1685). Ce n'est pas une école, mais l'affirmation d'un consensus autour des mêmes modèles et des mêmes goûts. Ainsi, le classicisme possède une poétique, un ensemble de règles établies par des théoriciens. Il devient un modèle artistique à suivre. Le classicisme prendra fin avec la Querelle des Anciens et des Modernes qui dicte l'émancipation des modèles antiques. La comédie-ballet : Avant Molière, la littérature et la musique ne faisaient pas bon ménage. Certains artistes, comme les poètes de la Pléiade (grand mouvement poétique du XVI e siècle), avaient bien essayé de les réconcilier, mais avec un succès limité aux « chansons « (poésies mises en musique). Au milieu du XVII e siècle, de nombreux poètes dédaignant la musique jugeaient celle-ci indigne de se mêler à leur art. Molière apaisa cette querelle en composant les « Fâcheux «, comédie mêlée de chants et de danses.
«
Faits littéraires St ève Ch ételat
s'approcher du mime : les danseurs doivent d
ésormais figurer une action. La musique gagne
en vivacit
é, en expressivit é, pour s'accorder aux situations des personnages et de
l'atmosph
ère gaie et mouvement ée de la com édie.
Le texte à son tour prend des accents
musicaux. Ainsi constitu
ée, la com édie ballet des « f âcheux » devait être le mod èle du genre.
Apr
ès Moli ère:
Moli
ère aura écrit une quinzaine de com édies ballets, soit un peu moins de la moiti é de sa
production th
éâ trale. Apr ès lui, le genre de la com édie ballet ne sera plus gu ère repr ésent é
car il sera remplac
é par l'op éra.
Pourtant, le proc
édé qui consiste à intercaler des passages chant és et dans és dans une histoire
dialogu
ée reste tr ès actuel, si l'on juge par le succ ès que conna ît la com édie musicale depuis
plusieurs d
écennies, au th éâ tre comme au cin éma.
Contextualisation de la pi
èce du Malade imaginaire :
Le Malade imaginaire est la derni
ère com édie écrite par Moli ère.
Il s'agit d'une com édie
ballet en trois actes (comportant respectivement 8, 9 et 15 sc
ènes), repr ésent ée au Th éâ tre du
PalaisRoyal le 10 f
évrier 1673 par la troupe de Moli ère ; apr ès les « com édies d ésesp érées »
(Dom Juan ou le Festin de pierre et Le Misanthrope ou l'Atrabilaire amoureux).
La pi
èce tourne essentiellement autour d'Argan, qui est le « malade imaginaire » qui a donn é
son titre
à la pi èce.
Veuf, il s'est remari é avec B éline qui simule des soins attentifs, mais
n'attend en r
éalit é que sa mort pour pouvoir h ériter.
Il se fait faire des saign
ées, des purges et prend toutes sortes de rem èdes, dispens és par des
m
édecins p édants et soucieux davantage de complaire à leur patient que de la sant é de celui
ci. Toinette, sa servante, se d
éguise en m édecin et lui dispense des conseils plein d'ironie o ù
elle se moque du ridicule des m
édecins.
Ang
élique, sa fille, aime Cl éante au grand d épit d'Argan. Il pr éférerait voir sa fille mari ée à
Thomas Diafoirus luim
ême m édecin.
Pour les tirer d'affaire, Toinette recommande
à Argan de faire le mort. Sa femme est appel ée
par Toinette, et manifeste sa joie d'
être d ébarrass ée de son mari devant celuici, qu'elle croit
mort. Toinette appelle ensuite Ang
élique, qui manifeste un chagrin sinc ère de la mort de son
p
ère : celuici arr ête aussit ôt son jeu et accepte l'union de sa fille avec Cl éante, à la condition
que ce dernier devienne m
édecin. Son fr ère, B éralde, lui conseille de devenir m édecin lui
m
ême, ce qu'il accepte.
La pi èce se termine par une c érémonie bouffonne d'intronisation
d'Argan
à la m édecine..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- analyse linéaire Molière - Texte 1 : Acte II scène 5 (extrait du Malade Imaginaire)
- Fiche d'oral du bac de français ( théatre le malade imaginaire)
- Analyse linéaire Acte 1 scène 1 Le malade imaginaire : monologue d’Argan
- dissertation malade imaginaire
- Dissert-La Malade Imaginaire-Molière: en quoi Le Malade Imaginaire de Molière est conçu comme un spectacle complet ?