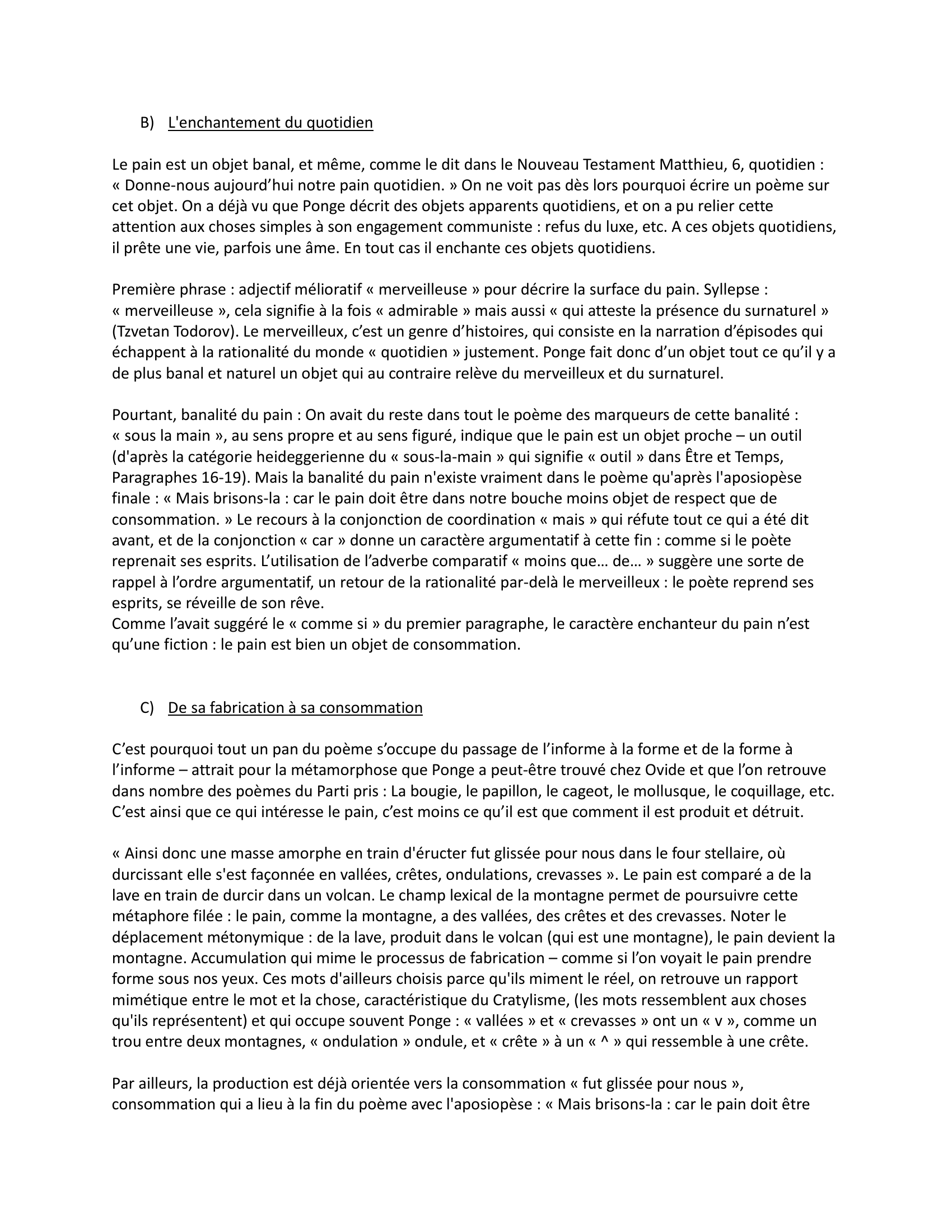Francis Ponge: Le Pain
Publié le 25/05/2012

Extrait du document
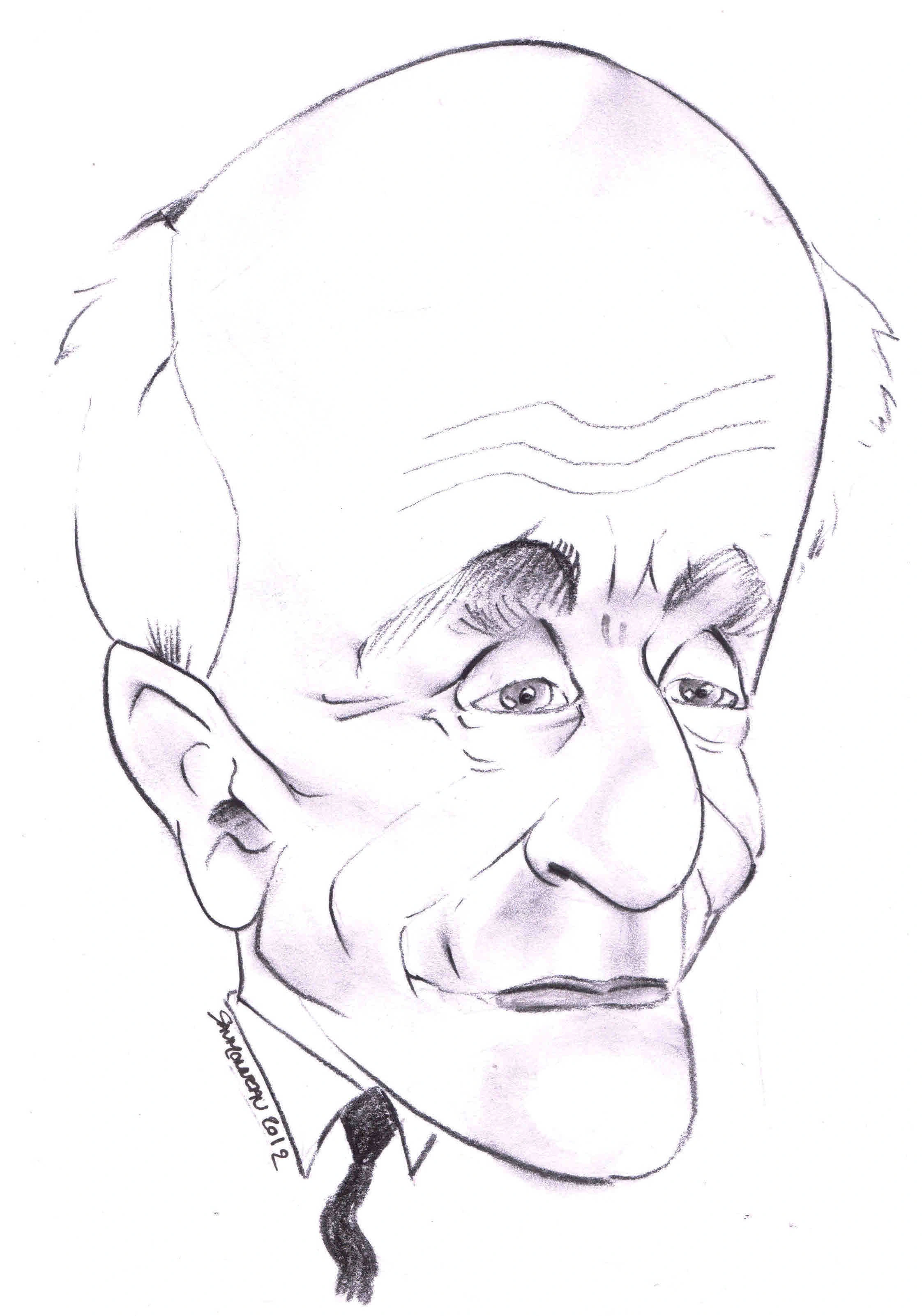
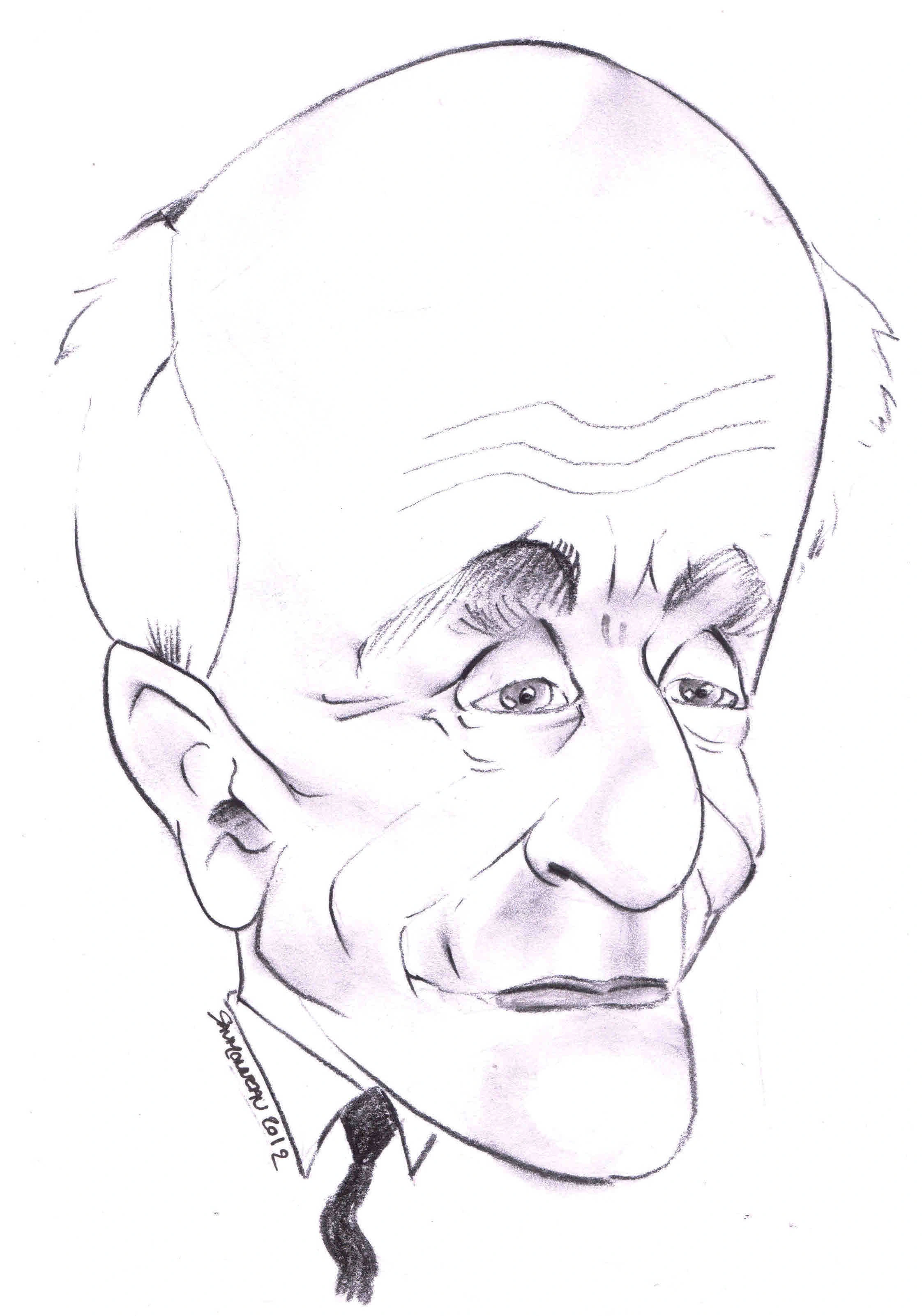
«
B) L'enchantement du quotidien
Le pain est un objet banal, et même, comme le dit dans le Nouveau Testament Matthieu, 6, quotidien :
« Donne -nous aujourd’hui notre pain quotidien.
» On ne voit pas dès lors pourquoi écrire un poème sur
cet objet.
On a déjà vu que Ponge décrit des objets apparents quotidiens, et on a pu relier cette
attention aux choses simples à son engagement communiste : refus du luxe, etc.
A ces objets quotidiens,
il prête une vie, parfois une âme.
En tout cas il enchante ces objets quotidiens.
Première phrase : adjectif mélioratif « merveilleuse » pour décrire la surface du pain.
Syllepse :
« merveilleuse », cela signifie à la fois « admirable » mais aussi « qui atteste la présence du surnaturel »
(Tzvetan Todorov).
Le merveilleux, c’est un genre d’histoires, qui consiste en la narration d’épisod es qui
échappent à la rationalité du monde « quotidien » justement.
Ponge fait donc d’un objet tout ce qu’il y a
de plus banal et naturel un objet qui au contraire relève du merveilleux et du surnaturel.
Pourtant, banalité du pain : On avait du reste dans tout le poème des marqueurs de cette banalité :
« sous la main », au sens propre et au sens figuré, indique que le pain est un objet proche – un outil
(d'après la catégorie heideggerienne du « sous -la- main » qui signifie « outil » dans Être et Temps,
Para graphes 16 -19).
Mais la banalité du pain n'existe vraiment dans le poème qu'après l'aposiopèse
finale : « Mais brisons -la : car le pain doit être dans notre bouche moins objet de respect que de
consommation.
» Le recours à la conjonction de coordination « mais » qui réfute tout ce qui a été dit
avant, et de la conjonction « car » donne un caractère argumentatif à cette fin : comme si le poète
reprenait ses esprits.
L’utilisation de l’adverbe comparatif « moins que… de… » suggère une sorte de
rappel à l’ordr e argumentatif, un retour de la rationalité par- delà le merveilleux : le poète reprend ses
esp rits, se réveille de son rêve.
Comme l’avait suggéré le « comme si » du premier paragraphe, le caractère enchanteur du pain n’est
qu’une fiction : le pain est bi en un objet de consommation.
C) De sa fabrication à sa consommation
C’est pourquoi tout un pan du poème s’occupe du passage de l’informe à la forme et de la forme à
l’informe – attrait pour la métamorphose que Ponge a peut -être trouvé chez Ovide et que l’ on retrouve
dans nombre des poèmes du Parti pris : La bougie, le papillon, le cageot, le mollusque, le coquillage, etc.
C’est ainsi que ce qui intéresse le pain, c’est moins ce qu’il est que comment il est produit et détruit.
« Ainsi donc une masse amorph e en train d'éructer fut glissée pour nous dans le four stellaire, où
durcissant elle s'est façonnée en vallées, crêtes, ondulations, crevasses ».
Le pain est comparé a de la
lave en train de durcir dans un volcan.
Le champ lexical de la montagne permet de poursuivre cette
métaphore filée : le pain, comme la montagne, a des vallées, des crêtes et des crevasses.
Noter le
déplacement métonymique : de la lave, produit dans le volcan (qui est une montagne), le pain devient la
montagne.
Accumulation qui mime le processus de fabrication – comme si l’on voyait le pain prendre
forme sous nos yeux.
Ces mots d'ailleurs choisis parce qu'ils miment le réel, on retrouve un rapport
mimétique entre le mot et la chose, caractéristique du Cratylisme, (les mots ressemblent au x choses
qu'ils représentent) et qui occupe souvent Ponge : « vallées » et « crevasses » ont un « v », comme un
trou entre deux montagnes, « ondulation » ondule, et « crête » à un « ^ » qui ressemble à une crête.
Par ailleurs, la production est déjà orien tée vers la consommation « fut glissée pour nous »,
consommation qui a lieu à la fin du poème avec l'aposiopèse : « Mais brisons -la : car le pain doit être.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- commentaire le pain francis ponge
- Le Pain Francis Ponge Commentaire
- commentaire le pain francis ponge
- Francis Ponge. Le pain. Commentaire
- Le pain de Francis Ponge