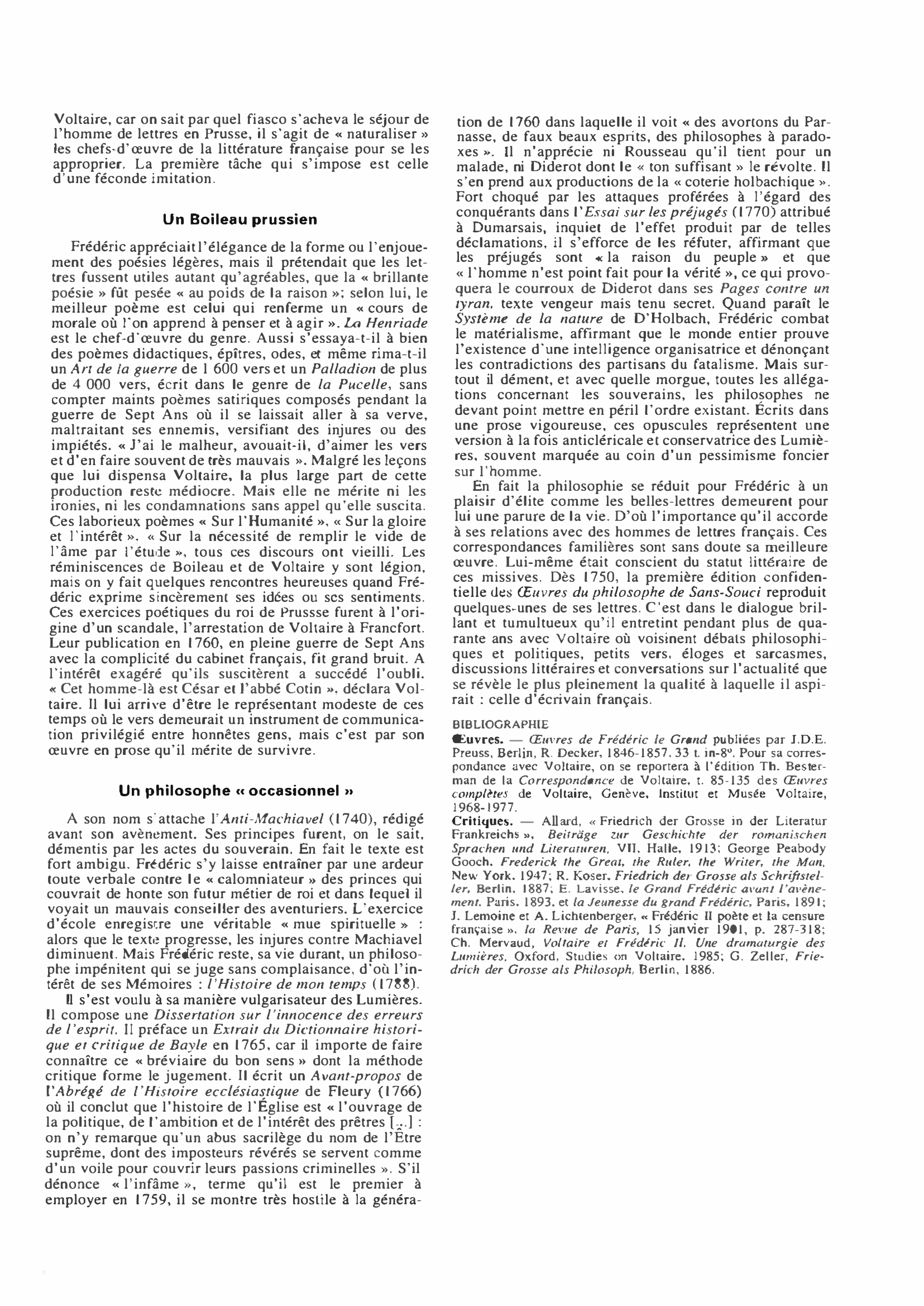FRÉDÉRIC II et la littérature
Publié le 05/12/2018

Extrait du document
FRÉDÉRIC II (1712-1786). Le roi de Prusse Frédéric le Grand s’est voulu obstinément homme de lettres de langue française, n’usant de l’allemand que pour les affaires courantes et composant en français poésie, mémoires, opuscules politiques et philosophiques, correspondances
familières. Le conquérant sans scrupule qui s’empara de la Silésie, « l’éternel boute-feu de l’Europe », qui joua gros jeu pendant la guerre de Sept Ans et recueillit sa part du gâteau lors du premier partage de la Pologne, le despote jaloux de son autorité, soupçonneux à l’égard de tous, qui s’était donné pour tâche d’être le « premier serviteur de l’État » et « l’âme de la Prusse », se double aussi, selon ses propres termes, d’un « philosophe déplacé » qui se dit politique par devoir et penseur par inclination.
Un Hohenzollern de culture française et classique
Sans doute entre-t-il dans ce goût pour les choses de l’esprit qu’afficha constamment le roi de Prusse quelque obscur désir de revanche. Le Roi-Sergent avait brimé les penchants de son fils dans lequel il voyait un petit maître aimant plus sa flûte et les livres que les plaisirs virils de la chasse et de la tabagie. Sans doute faut-il détecter quelque souci de réclame personnelle chez celui que des hommes de lettres appelèrent le « Salomon du Nord ». Mais une telle application à maîtriser les difficultés de la prosodie française, de si vastes lectures pour se tenir au courant de l’actualité littéraire et philosophique, une si évidente soif de relations intellectuelles que prouvent la création de son cercle de Potsdam et ses correspondances avec le marquis d’Argens, d’Alembert et surtout Voltaire, un si exigeant besoin d’écrire ne peuvent que s’enraciner au plus profond d’une personnalité. Car une grande ambition l'habite. Jugeant que l’Allemagne en est à « l’aurore des connaissances » et plus précisément « au point où se trouvaient les beaux-arts du temps de François Ier », persuadé que « l’étude réfléchie des auteurs classiques tant grecs que romains et français » est la seule voie de salut, il aurait voulu contribuer au progrès culturel de son pays, déplorant, au soir de sa vie, de n’avoir pu le faire, car il n’a été qu’un « être tracassé les deux tiers de sa course par des guerres continuelles ».
Le français reste pour lui la langue de culture. Frédéric-Guillaume ayant interdit à son fils l’étude du latin, il ne connaît la littérature ancienne qu’en traduction. Il en est de même pour quelques auteurs modernes, anglais ou italiens, ainsi de Machiavel qu’il ne lira pas dans le texte. Pour Wolff, il aura seulement la « curiosité » de regarder le texte allemand, se contentant de la version française établie à son usage par le baron de Suhm qui essaie en vain de l’intéresser à l’original. En 1780, il fit lire à l’Académie de Berlin un mémoire, De la littérature allemande, dans lequel il exécutait avec mépris tout ce qui s’écrivait en Allemagne. Et il n’est peut-être pas inutile de rappeler qu’en 1784, devant cette même assemblée, le Discours sur l’universalité de la langue française de Rivarol remporta un prix en même temps que la Dissertation allemande de Schwab.
L’horizon de son esprit est tout classique. Frédéric II s’est nourri des œuvres du siècle de Louis XIV, avec une prédilection certaine pour Racine et pour le législateur du Parnasse, se disant le disciple docile de « l'exact et sévère Boileau », ne craignant point d’accoler à son nom l’épithète de « divin ». Surtout il fut le lecteur assidu et émerveillé de Voltaire, apprenant par cœur les ouvrages du maître, tel chant de la Henriade ou telle tirade de tragédie, prétendant qu’il pourrait « servir de souffleur » lors de la représentation de ses pièces, exigeant communication de la Pucelle, méditant l’Histoire de Charles XII, le Siècle de Louis XIV, l’Essai sur les mœurs, appréciant articles de dictionnaire, libelles, contes et facéties, croyant que le tombeau de son écrivain préféré serait « celui du goût et des lettres », la fin d’un monde, celui qu’il avait compris et aimé. Faute de « posséder »
«
Voltaire,
car on sait par quel fiasco s'acheva le séjour de
l'homme de lettres en Prusse, il s'agit de «naturaliser»
les chefs-d' œuvre de la littérature française pour se les
approprier.
La première tâche qui s'impose est celle
d'une féconde imitation.
Un Boileau prussien
Frédéric appréciait l'élégance de la forme ou l'enjoue
ment des poésies légères, mais il prétendait que les let
tres fussent utiles autant qu'agréables, que la «brillante
poésie » fût pesée « au poids de la raison »; selon lui, le
meilleur poème est celui qui renferme un «cours de
morale où l'on apprend à penser et à agir».
La Henriade
est le chef-d'œuvre du genre.
Aussi s'essaya-t-il à bien
des poèmes didactiques, épîtres, odes, et même rima-t-il
un Art de La guerre de l 600 vers et un Palladion de plus
de 4 000 vers, écrit dans le genre de la Pucelle, sans
compter maints poèmes satiriques composés pendant la
guerre de Sept Ans où il se laissait aller à sa verve,
maltraitant ses ennemis, versifiant des injures ou des
impiétés.
«J'ai le malheur, avouait-il, d'aimer les vers
et d'en faire souvent de très mauvais >>.
Malgré les leçons
que lui dispensa Voltaire, la plus large pan de cette
production reste médiocre.
Mais elle ne mérite ni les
ironies, ni les condamnations sans appel qu'elle suscita.
Ces laborieux poèmes« Sur l'Humanité »,« Sur la gloire
et l'intérêt>>, , tous ces discours ont vieilli.
Les
réminiscences de Boileau et de Voltaire y sont légion,
mais on y fait quelques rencontres heureuses quand Fré
déric exprime sincèrement ses idées ou ses sentiments.
Ces exercices poétiques du roi de Prussse furent à l'ori
gine d'un scandale, l'arrestation de Voltaire à Francfort.
Leur publication en 1760, en pleine guerre de Sept Ans
avec la complicité du cabinet français, fit grand bruit.
A
l'intérêt exagéré qu'ils suscitèrent a succédé l'oubli.
« Cet homme-là est César et 1 'abbé Cotin>>, déclara Vol
taire.
Il lui arrive d'être le représentant modeste de ces
temps où le vers demeurait un instrument de communica
tion privilégié entre honnêtes gens, mais c'est par son
œuvre en prose qu'il mérite de survivre.
Un philosophe cc occasionnel ,
A son nom s· attache l' Anti-Machiavel ( 1740), rédigé
avant son avèm!ment.
Ses principes furent, on le sait,
démentis par les actes du souverain.
En fait le texte est
fort ambigu.
Frédéric s'y laisse entraîner par une ardeur
toute verbale contre le «calomniateur>> des princes qui
couvrait de honte son futur métier de roi et dans lequel il
voyait un mauvais conseiller des aventuriers.
L'exercice
d'école enregistre une véritable «mue spirituelle» :
alors que le texte! progresse, les injures contre Machiavel
diminuent.
Mais Frédéric reste, sa vie durant, un philoso
phe impénitent qui se juge sans complaisance, d'où l'in
térêt de ses Mémoires : l'Histoire de mon temps (1788).
Il s'est voulu à sa manière vulgarisateur des Lumières.
Il compose une Dissertation sur l'innocence des erreurs
de l'esprit.
11 préface un Extrait du Dictionnaire histori
que et critique de Bayle en 1765, car il importe de faire
connaître ce « bréviaire du bon sens >> dont la méthode
critique forme le jugement.
Il écrit un Avant-propos de
l'Abrégé de l'Histoire ecclésiastique de Fleury (1766)
où il conclut que l'histoire de l'Église est« l'ouvrage de
la politique, de l'ambition et de l'intérêt des prêtres (:.,.]:
on n'y remarque qu'un abus sacrilège du nom de l'Etre
suprême, dont des imposteurs révérés se servent comme
d'un voile pour couvrir leurs passions criminelles ».
S'il
dénonce «l'infâme>> , terme qu'il est le premier à
employer en 1759, il se montre très hostile à la généra- tion
de 1760 dans laquelle il voit «des avortons du Par
nasse, de faux beaux esprits, des philosophes à parado
xes>>.
Il n'apprécie ni Rousseau qu'il tient pour un
malade, ni Diderot dont le le révolte.
Il
s'en prend aux productions de la« coterie holbachique >>.
Fort choqué par les attaques proférées à l'égard des
conquérants dans 1 'Essai sur les préjugés ( 1770) attribué
à Dumarsais, inquiet de l'effet produit par de telles
déclamations, il s'efforce de les réfuter, affirmant que
les préjugés sont « la raison du peuple>> et que
« l'homme n'est point fait pour la vérité », ce qui provo
quera le courroux de Diderot dans ses Pages contre tm
ryran, texte vengeur mais tenu secret.
Quand paraît le
Système de la nature de D'Holbach, Frédéric combat
le matérialisme, affirmant que le monde entier prouve
l'existence d'une intelligence organisatrice et dénonçant
les contradictions des partisans du fatalisme.
Mais sur
tout il dément, et avec quelle morgue, toutes les alléga
tions concernant les souverains, les philosophes ne
devant point mettre en péril 1 'ordre existant.
Écrits dans
une prose vigoureuse, ces opuscules représentent une
version à la fois anticléricale et conservatrice des Lumiè
res, souvent marquée au coin d'un pessimisme foncier
sur l'homme.
En fait la philosophie se réduit pour Frédéric à un
plaisir d'élite comme les belles-lettres demeurent pour
lui une parure de la vie.
D'où l'importance qu'il accorde
à ses relations avec des hommes de lettres français.
Ces
correspondances familières sont sans doute sa meilleure
œuvre.
Lui-même était conscient du statut littéraire de
ces missives.
Dès 1750, la première édition confiden
tielle des Œuvres du philosophe de Sans-Souci reproduit
quelques-unes de ses lettres.
C'est dans le dialogue bril
lant et tumultueux qu'il entretint pendant plus de qua
rante ans avec Voltaire où voisinent débats philosophi
ques et politiques, petits vers, éloges et sarcasmes,
discussions littéraires et conversations sur l'actualité que
se révèle le plus pleinement la qualité à laquelle il aspi
rait : celle d'écrivain français.
BIBLIOGRAPHIE
Œuvres.
-Œuvres de Frédéric le Grand publiées par J.D.E.
Preuss, Berli n, R.
Decker, 1846-1857.
33t.
in-8•.
Pour sa corres
pondance avec Voltaire, on se reportera à l'édition Th.
Best er
man de la Correspondance de Voltaire, t.
85-135 des Œuvres
complètes de Voltaire, Genève, Institut et Musée Voltaire,
1968-1977.
Critiques.
-Allar d, « Friedrich der Grosse in der Literatur
Frankreichs >>, Beitrtige zur Geschichre der romanischen
Spr ach en und Literaruren, VIl, Halle, 1913; George Peabody
Gooch.
Frederick the Great, the Ru/er, the Writer, the Man,
New York, 1947; R.
Koser.
Friedrich der Grosse ais Schriftstel
/er.
Berlin , 1887; E.
Lavisse.
le Grand Frtdéric avanl /'avène
mellt, Paris.
1893, et la Jeunesse du grand Frtdtric, Paris, 1891;
J.
Lemoin e et A.
Lichtenberger, «Frédéric li poète et la censure
française».
la Revue de Paris, 15 ja n vi er 1901, p.
287-318;
Ch.
Mervaud, Vol ta ir e er Frédéric Il.
Une dramaturgie des
Lumières, Oxford, Studies on Voltaire, 1985; G.
Zeller, Frie
drich der Grosse ais Philosoph, Berlin, 1886..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Frédéric Gaussen, Le Monde Dimanche, 14 février 1982 (Littérature)
- Lettre de Voltaire au futur Frédéric II de Prusse datée du 26 août 1736 - Littérature
- Madame Bovary et la littérature sentimentale
- l'histoire de la littérature
- En quoi la littérature et le cinéma participent-ils à la construction de la mémoire de la Shoah ? (exemple du journal d'Hélène Berr)