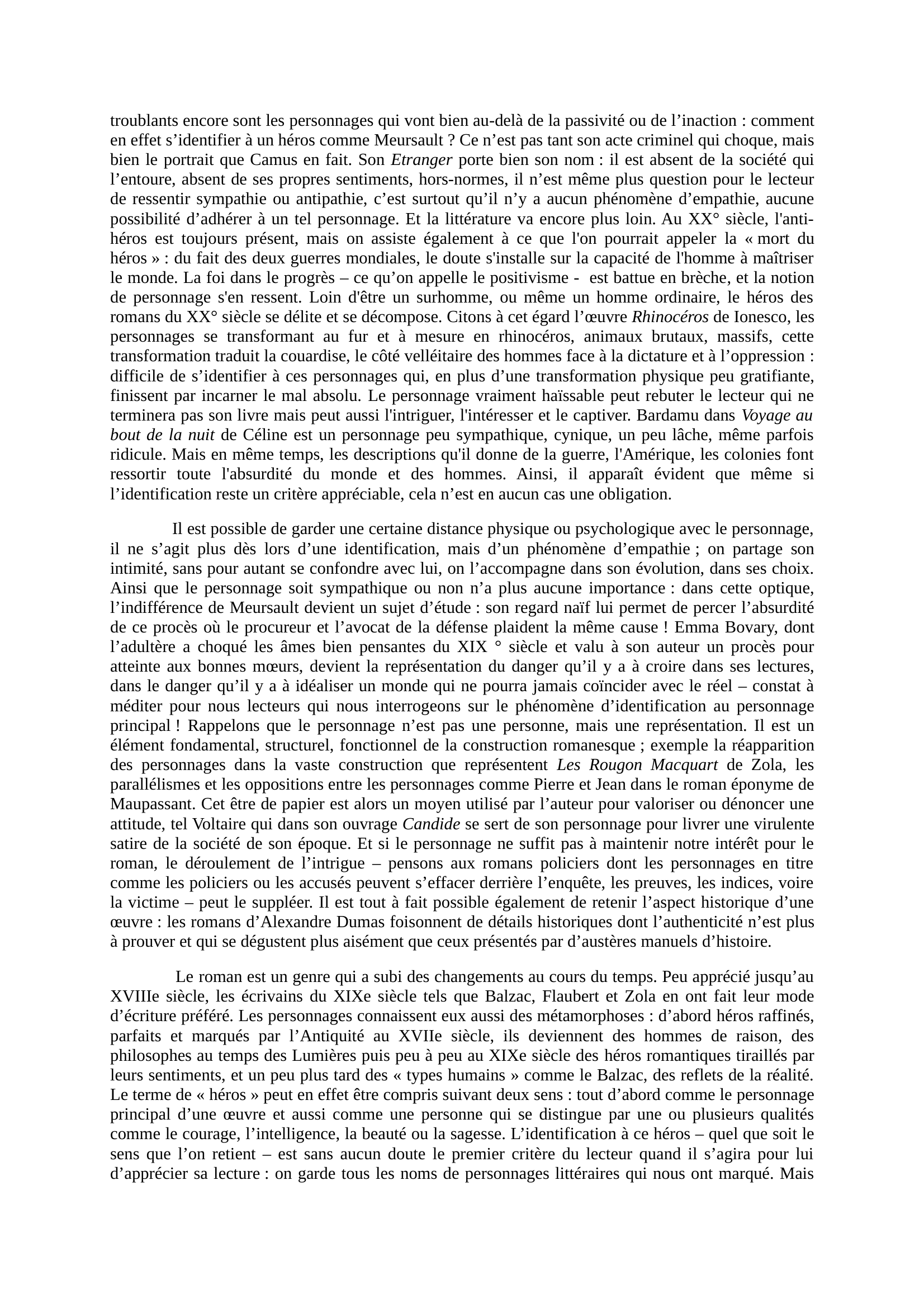héros
Publié le 30/04/2014

Extrait du document
«
troublants encore sont les personnages qui vont bien au-delà de la passivité ou de l’inaction : comment
en effet s’identifier à un héros comme Meursault ? Ce n’est pas tant son acte criminel qui choque, mais
bien le portrait que Camus en fait.
Son Etranger porte bien son nom : il est absent de la société qui
l’entoure, absent de ses propres sentiments, hors-normes, il n’est même plus question pour le lecteur
de ressentir sympathie ou antipathie, c’est surtout qu’il n’y a aucun phénomène d’empathie, aucune
possibilité d’adhérer à un tel personnage.
Et la littérature va encore plus loin.
Au XX° siècle, l'anti-
héros est toujours présent, mais on assiste également à ce que l'on pourrait appeler la « mort du
héros » : du fait des deux guerres mondiales, le doute s'installe sur la capacité de l'homme à maîtriser
le monde.
La foi dans le progrès – ce qu’on appelle le positivisme - est battue en brèche , et la notion
de personnage s'en ressent.
Loin d'être un surhomme, ou même un homme ordinaire, le héros des
romans du XX° siècle se délite et se décompose.
Citons à cet égard l’œuvre Rhinocéros de Ionesco, les
personnages se transformant au fur et à mesure en rhinocéros, animaux brutaux, massifs, cette
transformation traduit la couardise, le côté velléitaire des hommes face à la dictature et à l’oppression :
difficile de s’identifier à ces personnages qui, en plus d’une transformation physique peu gratifiante,
finissent par incarner le mal absolu.
Le personnage vraiment haïssable peut rebuter le lecteur qui ne
terminera pas son livre mais peut aussi l'intriguer, l'intéresser et le captiver.
Bardamu dans Voyage au
bout de la nuit de Céline est un personnage peu sympathique, cynique, un peu lâche, même parfois
ridicule.
Mais en même temps, les descriptions qu'il donne de la guerre, l'Amérique, les colonies font
ressortir toute l'absurdité du monde et des hommes.
Ainsi, il apparaît évident que même si
l’identification reste un critère appréciable, cela n’est en aucun cas une obligation.
Il est possible de garder une certaine distance physique ou psychologique avec le personnage,
il ne s’agit plus dès lors d’une identification, mais d’un phénomène d’empathie ; on partage son
intimité, sans pour autant se confondre avec lui, on l’accompagne dans son évolution, dans ses choix.
Ainsi que le personnage soit sympathique ou non n’a plus aucune importance : dans cette optique,
l’indifférence de Meursault devient un sujet d’étude : son regard naïf lui permet de percer l’absurdité
de ce procès où le procureur et l’avocat de la défense plaident la même cause ! Emma Bovary, dont
l’adultère a choqué les âmes bien pensantes du XIX ° siècle et valu à son auteur un procès pour
atteinte aux bonnes mœurs, devient la représentation du danger qu’il y a à croire dans ses lectures,
dans le danger qu’il y a à idéaliser un monde qui ne pourra jamais coïncider avec le réel – constat à
méditer pour nous lecteurs qui nous interrogeons sur le phénomène d’identification au personnage
principal ! Rappelons que le personnage n’est pas une personne, mais une représentation.
Il est un
élément fondamental, structurel, fonctionnel de la construction romanesque ; exemple la réapparition
des personnages dans la vaste construction que représentent Les Rougon Macquart de Zola, les
parallélismes et les oppositions entre les personnages comme Pierre et Jean dans le roman éponyme de
Maupassant.
Cet être de papier est alors un moyen utilisé par l’auteur pour valoriser ou dénoncer une
attitude, tel Voltaire qui dans son ouvrage Candide se sert de son personnage pour livrer une virulente
satire de la société de son époque.
Et si le personnage ne suffit pas à maintenir notre intérêt pour le
roman, le déroulement de l’intrigue – pensons aux romans policiers dont les personnages en titre
comme les policiers ou les accusés peuvent s’effacer derrière l’enquête, les preuves, les indices, voire
la victime – peut le suppléer.
Il est tout à fait possible également de retenir l’aspect historique d’une
œuvre : les romans d’Alexandre Dumas foisonnent de détails historiques dont l’authenticité n’est plus
à prouver et qui se dégustent plus aisément que ceux présentés par d’austères manuels d’histoire.
Le roman est un genre qui a subi des changements au cours du temps.
Peu apprécié jusqu’au
XVIIIe siècle, les écrivains du XIXe siècle tels que Balzac, Flaubert et Zola en ont fait leur mode
d’écriture préféré.
Les personnage s connaissent eux aussi des métamorphoses : d’abord héros raffinés,
parfaits et marqués par l’Antiquité au XVIIe siècle, ils deviennent des hommes de raison, des
philosophes au temps des Lumières puis peu à peu au XIXe siècle des héros roman tiques tiraillés par
leurs sentiments, et un peu plus tard des « types humains » comme le Balzac, des reflets de la réalité.
Le terme de « héros » peut en effet être compris suivant deux sens : tout d’abord comme le personnage
principal d’une œuvre et aussi comme une personne qui se distingue par une ou plusieurs qualités
comme le courage, l’intelligence, la beauté ou la sagesse.
L’identification à ce héros – quel que soit le
sens que l’on retient – est sans aucun doute le premier critère du lecteur quand il s’agira pour lui
d’apprécier sa lecture : on garde tous les noms de personnages littéraires qui nous ont marqué.
Mais.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Explication linéaire n°9 Madame Bovary: Dans quelle mesure cette rencontre amoureuse, bien que classique, est-elle magnifiée par le regard du héros ?
- Evolution des caractéristiques du héros de roman du XVII ème siècle au XXIème siècle
- Diptyque de latin : les héros - Tite Live Ab Urbe condita liber XXI, IV
- Un critique définit le héros cornélien de cette manière : “Des héros tout d’une pièce, immobiles et raides dans leurs grandes armures, artificieusement mis aux prises avec des événements extraordinaires et déployant des vertus presque surnaturelles ou des vices non moins monstrueux”. Qu’en pensez-vous ?
- SADKO. Il est un des principaux héros de l’épopée russe — Bylines