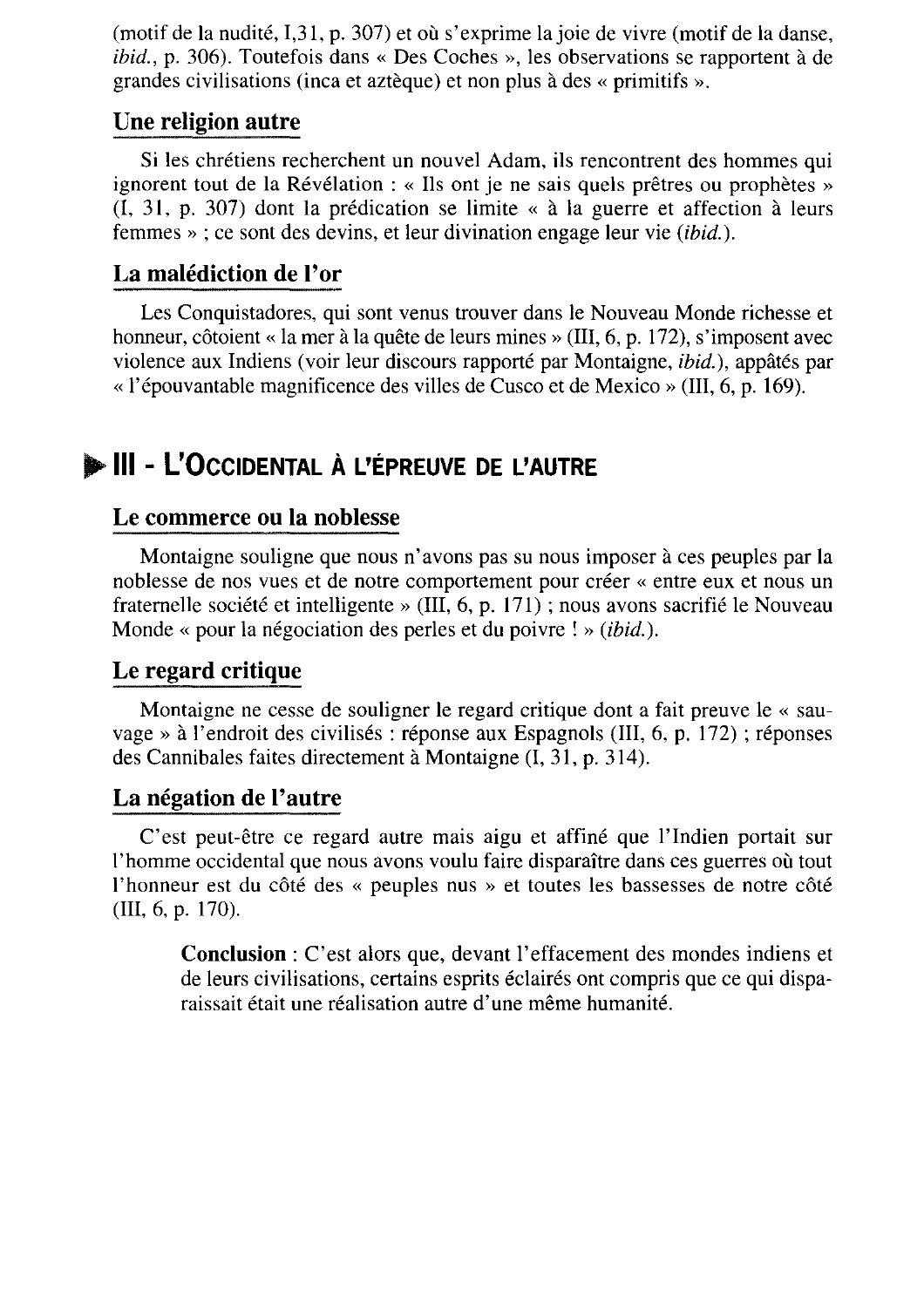Histoire et ethnographie
Publié le 02/08/2014

Extrait du document

Histoire et ethnographie
Dès le XIVe siècle, des cartes géographiques du monde sont établies, qui se rapprochent peu à peu de celles que nous utilisons et connaissons aujourd'hui : elles tiennent compte des connaissances de l'Antiquité et des premiers récits de voyageurs qui se rendaient en Asie. Mais elles mêlent aussi bien des connaissances de type scientifique que des croyances mythiques et des témoignages de marins qui se sont avancés, souvent acci¬dentellement, dans des zones de l'océan Atlantique encore inconnues. La géniale conviction de Christophe Colomb s'est fondée sur ces données pourtant précaires. C'est de cette découverte du Nouveau Monde, et de la rencontre de l'autre, mais surtout de sa déchéance, que va pouvoir naître enfin, à partir du XVIe siècle, ce que nous appelons l'esprit moderne.

«
(motif de la nudité, 1,31, p.
307) et où s'exprime la joie de vivre (motif de la danse, ibid., p.
306).
Toutefois dans « Des Coches », les observations se rapportent à de
grandes civilisations (inca et aztèque) et non plus à des« primitifs».
Une religion autre
Si les chrétiens recherchent un nouvel Adam, ils rencontrent des hommes qui
ignorent tout de la Révélation : « Ils ont je ne sais quels prêtres ou prophètes »
(1, 31, p.
307) dont la prédication se limite « à la guerre et affection à leurs
femmes» ; ce sont des devins, et leur divination engage leur vie (ibid.).
La malédiction de l'or
Les Conquistadores, qui sont venus trouver dans le Nouveau Monde richesse et
honneur, côtoient« la mer à la quête de leurs mines» (III, 6, p.
172), s'imposent avec
violence aux Indiens (voir leur discours rapporté par Montaigne,
ibid.), appâtés par
«l'épouvantable magnificence des villes de Cusco et de Mexico» (III, 6, p.
169).
flir-111 -L'OCCIDENTAL À L'ÉPREUVE DE L'AUTRE
Le commerce ou la noblesse
Montaigne souligne que nous n'avons pas su nous imposer à ces peuples par la
noblesse de nos vues et de notre comportement pour créer
« entre eux et nous un
fraternelle société et intelligente» (III, 6,
p.
171); nous avons sacrifié le Nouveau
Monde« pour la négociation des perles et du poivre ! »(ibid.).
Le regard critique
Montaigne ne cesse de souligner le regard critique dont a fait preuve le « sau vage» à l'endroit des civilisés: réponse aux Espagnols (III, 6, p.
172); réponses
des Cannibales faites directement à Montaigne
(1, 31, p.
314).
La négation de l'autre
C'est peut-être ce regard autre mais aigu et affiné que l'indien portait sur
l'homme occidental que nous avons voulu faire disparaître dans ces guerres où tout
!'honneur est du côté des « peuples nus » et toutes les bassesses de notre côté
(III, 6, p.
170).
Conclusion: C'est alors que, devant l'effacement des mondes indiens et
de leurs civilisations, certains esprits éclairés ont compris que ce qui dispa
raissait était une réalisation autre
d'une même humanité..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Cours d'histoire-géographie 2nd
- Histoire de l'esclavage
- Amy Dahan-Dalmedico et Jeanne Peiffer: Une histoire des mathématiques (résumé)
- Bill Bryson: Histoire de tout, ou presque ...
- Philippe Breton, Histoire de l'informatique (résumé et analyse)