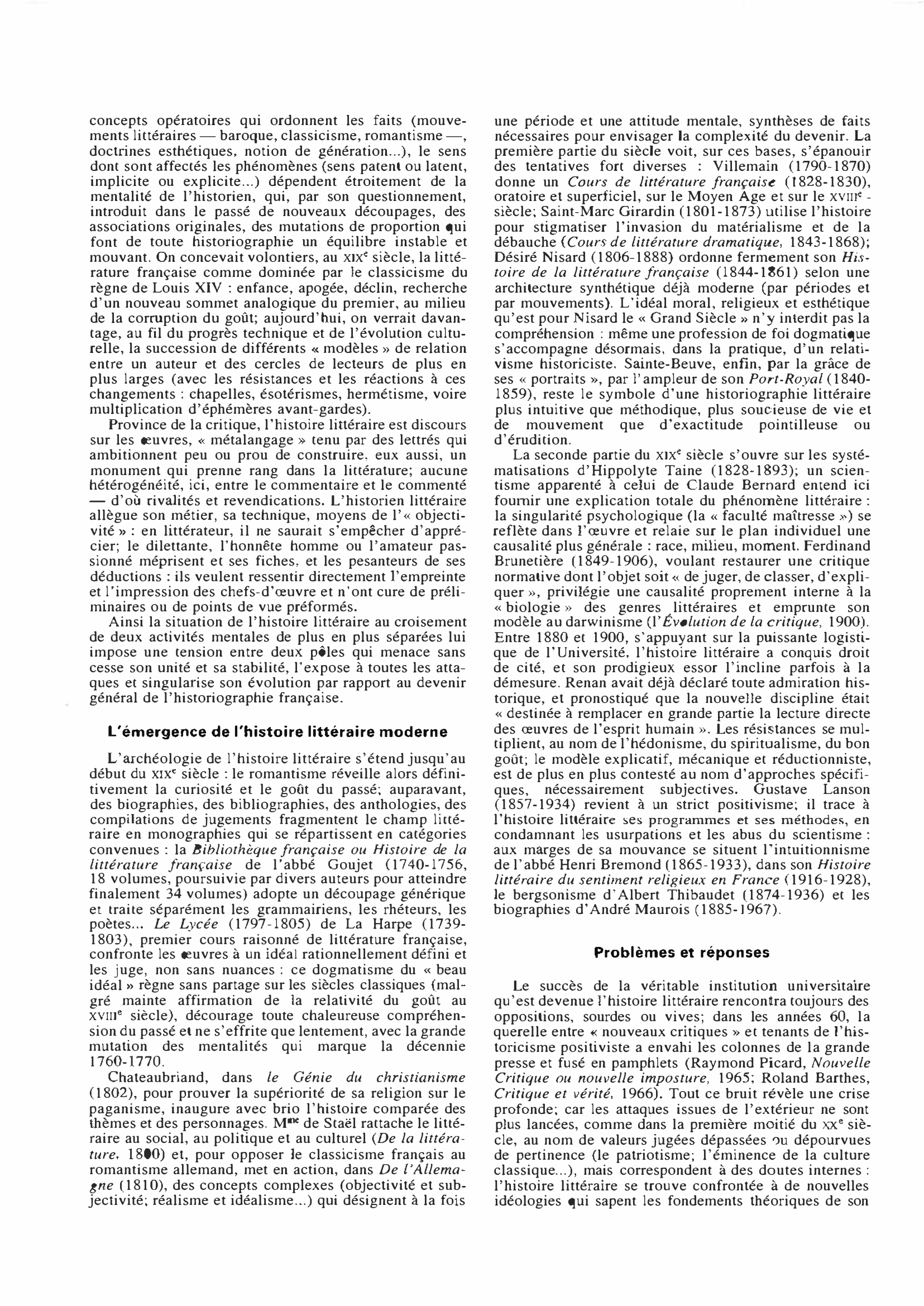HISTOIRE LITTÉRAIRE (Histoire de la littérature)
Publié le 15/12/2018

Extrait du document

HISTOIRE LITTÉRAIRE. La locution « histoire littéraire » n'acquiert sa signification actuelle d’« histoire de la littérature et du phénomène littéraire » qu’au cours du xviiie siècle. Quand on la rencontre auparavant, elle signifie « histoire ou chronique de la vie (biographie) et des ouvrages (bibliographie) des écrivains » (quels que soient ces écrivains; du passé ou contemporains, mathématiciens, physiciens, poètes ou romanciers...). C'est que la distinction moderne entre science et littérature n’existe pas encore : la « littérature » est généralement définie par les mots « érudition, doctrine », c'est-à-dire comme une connaissance profonde et méthodique du savoir transmis par les livres, et l’adjectif « littéraire », bien que né au xvie siècle, reste rare (il est enregistré en 1721 par le Dictionnaire de Trévoux). Les «lettres» (terme beaucoup plus usuel que « littérature ») désignent l’assimilation par l’esprit humain, et l’exposé écrit des
« sciences » qui signifient, elles, toute activité intellectuelle. Pour qu’« histoire littéraire » prenne son sens moderne, il faut donc que le découpage conceptuel et lexical change : peu à peu, au xviiie siècle, les mots « lettres », « belles-lettres » et « littérature » se spécialisent, par opposition à « sciences », pour désigner les œuvres où la fonction esthétique, le travail du langage l'emportent sur la référence précise, utilitaire — et bientôt mathématique — à la réalité objective. L’« histoire littéraire », avec beaucoup de lenteur, devient alors une chronique de la république des lettres (Bibliothèque anglaise ou Histoire littéraire de la Grande-Bretagne, Amsterdam, 1717-1728), puis, à peu près comme aujourd’hui, une histoire des littérateurs et des livres (Dom Rivet relayé par Dom Clémencet, Histoire littéraire de la France, 1733-1763, 12 volumes). Le sens actuel ne se fixe véritablement qu’au début du xixe siècle.
Après avoir conquis, au prix de durs affrontements et de mainte polémique, une place dominante aux dépens des anciennes « belles-lettres » et de l’ancestrale rhétorique, l'histoire littéraire s’est trouvée, à son tour, contestée par les modernes herméneutiques, psychanalyse et structuralisme, qui prétendent la réduire à un rôle accessoire et l’exclure de l’acte essentiel dont elle avait le monopole : dire le sens — ou les sens — du texte. Aussi le moment semble-t-il favorable à une redéfinition, à une rétrospective, et surtout à la prise de conscience de problèmes nouveaux.
Entre critique et histoire
L’histoire littéraire est un hybride, un sous-genre, issu du croisement de la critique littéraire et de l’histoire. La critique se propose d’expliquer et d’apprécier les ouvrages et les auteurs d'hier et d’aujourd’hui; l’histoire littéraire se spécialise dans l’examen des œuvres du passé. Elle rappelle, conserve et classe des phénomènes qui composent la vie des littératures : les écrivains et leurs productions; le public; les rapports entre l’auteur et le consommateur du livre. Elle en fournit des explications. Plus profondément, elle tente de les faire comprendre et même de les faire revivre, ou de postuler, sous l’amoncellement des faits, les normes ou les lois qui régissent leur structure et leur devenir. Comme l’écrit Gustave Lanson, « nos opérations principales consistent à connaître les textes littéraires, à les comparer pour distinguer l’individuel du collectif et l’original du traditionnel, à les grouper par genres, écoles et mouvements, à déterminer enfin le rapport de ces groupes à la vie intellectuelle, morale et sociale de notre pays, comme au développement de la littérature et de la civilisation européennes ».
Province de l’histoire, qui est mémoire du passé à l’intention du présent et rapport, souvent passionnel, aux grands ancêtres morts, l’histoire littéraire restreint son champ de recherche à un domaine particulier : mais situer les écrits dans leur contexte économique, social, politique et culturel, y voir les symptômes ou les signes d’une mentalité, d’une vision caractéristique du monde, ou le négatif du fait, les virtualités refoulées, l’intentionnalité secrète, c’est côtoyer — et quelquefois envahir — le territoire de l’historien proprement dit; c’est, en tout cas, emprunter les méthodes et les disciplines historiques : établissement des textes (étude comparative des manuscrits et des éditions, restitution d’états corrects ou définitifs et de leur genèse) et des événements (biographiques, sociaux, culturels, plus ou moins rangés en séries propres à un traitement statistique); détermination de causes (immédiates, conjoncturelles; lointaines, profondes, structurelles) ou, du moins, de facteurs qui conditionnent la vie littéraire au cours des âges. Cela exige sens critique, impartialité, sympathie; la réflexion moderne sur l’épistémologie historique a montré que les

«
concepts
opératoires qui ordonnent les faits (mouve
ments littéraires- baroque, classicisme, romantisme-,
doctrines esthétiques, notion de génération ...
), le sens
dont sont affectés les phénomènes (sens patent ou latent,
implicite ou explicite ...
) dépendent étroitement de la
mentalité de l'historien, qui, par son questionnement,
introduit dans le passé de nouveaux découpages, des
associations originales, des mutations de proportion qui
font de toute historiographie un équilibre instable et
mouvant.
On concevait volontiers, au XIX e siècle, la litté
rature française comme dominée par le classicisme du
règne de Louis XJV : enfance, apogée, déclin, recherche
d'un nouveau sommet analogique du premier, au milieu
de la corruption du goüt; aujourd'hui, on verrait davan
tage, au fil du progrès technique et de l'évolution cultu
relle, la succession de différents « modèles » de relation
entre un auteur et des cercles de lecteurs de plus en
plus larges (avec les résistances et les réactions à ces
changements : chapelles, ésotérismes, hermétisme, voire
multiplication d'éphémères avant-gardes).
Province de la critique, l'histoire littéraire est discours
sur les œuvres, « métalangage >> tenu par des lettrés qui
ambitionnent peu ou prou de construire, eux aussi, un
monument qui prenne rang dans la littérature; aucune
hétérogénéité, ici, entre le commentaire et le commenté
- d'où rivalités et revendications.
L'historien littéraire
allègue son métier, sa technique, moyens de l'« objecti
vité» : en littérateur, il ne saurait s'empêcher d'appré
cier; le dilettante, l'honnête homme ou l'amateur pas
sionné méprisent et ses fiches, et les pesanteurs de ses
déductions : ils veulent ressentir directement J'empreinte
et l'impression des chefs-d'œuvre et n'ont cure de préli
minaires ou de points de vue préformés.
Ainsi la situation de l'histoire littéraire au croisement
de deux activités mentales de plus en plus séparées lui
impose une tension entre deux pôles qui menace sans
cesse son unité et sa stabilité, l'expose à toutes les atta
ques et singularise son évolution par rapport au devenir
général de l'historiographie française.
L'émergence de l'histoire littéraire moderne
L'archéologie de l'histoire littéraire s'étend jusqu'au
début du xrx• siècle : le romantisme réveille alors défini
tivement la curiosité et le goût du passé; auparavant,
des biographies, des bibliographies, des anthologies, des
compilations de jugements fragmentent le champ litté
raire en monographies qui se répartissent en catégories
convenues : la Bibliothèque française ou Histoire de la
littérature française de l'abbé Goujet (1740-1756,
18 volumes, poursuivie par divers auteurs pour atteindre
finalement 34 volumes) adopte un découpage générique
et traite séparément les grammairiens, les rhéteurs, les
poètes...
Le Lycée (1797 -1805) de La Harpe (1739-
1803), premier cours raisonné de littérature française,
confronte les œuvres à un idéal rationnellement défini et
les juge, non sans nuances : ce dogmatisme du « beau
idéal » règne sans partage sur les siècles classiques (mal
gré mainte affirmation de la relativité du goüt au
XVIII e siècle), décourage toute chaleureuse compréhen
sion du passé et ne s'effrite que lentement, avec la grande
mutation des mentalités qui marque la décennie
1760-1770.
Chateaubriand, dans le Génie du christianisme
( 1802), pour prouver la supériorité de sa religion sur le
paganisme, inaugure avec brio l'histoire comparée des
thèmes et des personnages.
Mme de Staël rattache le litté
raire au social, au politique et au culturel (De la littéra
ture, 1800) et, pour opposer le classicisme français au
romantisme allemand, met en action, dans De t'Allema
gne (181 0), des concepts complexes (objectivité et sub
jectivité; réalisme et idéalisme ...
) qui désignent à la fois une
période et une attitude mentale, synthèses de faits
nécessaires pour envisager la complexité du devenir.
La
première partie du siècle voit, sur ces bases, s'épanouir
des tentatives fort diverses : Villemain (1790-1870)
donne un Cours de littérature française (1828-1830),
oratoire et superficiel, sur le Moyen Age et sur le XVIIIe -
siècle; Saint-Marc Girardin (1801-1873) utilise l'histoire
pour stigmatiser l'invasion du matérialisme et de la
débauche (Cours de littérature dramatique, 1843-1868);
Désiré Nisard (1806-1888) ordonne fermement son His
toire de la littérature française (1844-1861) selon une
architecture synthétique déjà moderne (par périodes et
par mouvements).
L'idéal moral, religieux et esthétique
qu'est pour Nisard le« Grand Siècle» n'y interdit pas la
compréhension : même une profession de foi dogmatique
s'accompagne désormais, dans la pratique, d'un relati
visme historiciste.
Sainte-Beuve, enfin, par la grâce de
ses « portraits >>, par 1' ampleur de son Port-Royal (1840-
1859), reste le symbole d'une historiographie littéraire
plus intuitive que méthodique, plus soucieuse de vie et
de mouvement que d'exactitude pointilleuse ou
d'érudition.
La seconde partie du XIX e siècle s'ouvre sur les systé
matisations d'Hippolyte Taine (1828-1893); un scien
tisme apparenté à celui de Claude Bernard entend ici
fournir une explication totale du phénomène littéraire :
la singularité psychologique (la « faculté maîtresse �>) se
reflète dans l'œuvre et relaie sur le plan individuel une
causalité plus générale : race, milieu, moment.
Ferdinand
Brunetière (1849-1906), voulant restaurer une critique
normative dont l'objet soit« de juger, de classer, d'expli
quer>> , privilégie une causalité proprement interne à la
« biologie >> des genres , littéraires et emprunte son
modèle au darwinisme (l'Evolution de la critique, 1900).
Entre 1880 et 1900, s'appuyant sur la puissante logisti
que de l'Université, l'histoire littéraire a conquis droit
de cité, et son prodigieux essor l'incline parfois à la
démesure.
Renan avait déjà déclaré toute admiration his
torique, et pronostiqué que la nouvelle discipline était
« destinée à remplacer en grande partie la lecture directe
des œuvres de l'esprit humain>>.
Les résistances se mul
tiplient, au nom de l'hédonisme, du spiritualisme, du bon
goût; le modèle explicatif, mécanique et réductionniste,
est de plus en plus contesté au nom d'approches spécifi
ques, nécessairement subjectives.
Gustave Lanson
(1857-1934) revient à un strict positivisme; il trace à
l'histoire littéraire ses programmes et ses méthodes, en
condamnant les usurpations et les abus du scientisme :
aux marges de sa mouvance se situent l'intuitionnisme
de l'abbé Henri Bremond (1865-1933), dans son Histoire
littéraire du sentiment religieux en France (1916-1928),
le bergsonisme d'Albert Thibaudet (1874-1936) et les
biographies d'André Maurois (1885-1967).
Problèmes et réponses
Le succès de la véritable institution universitaire
qu'est devenue l'histoire littéraire rencontra toujours des
oppositions, sourdes ou vives; dans les années 60, la
querelle entre «nouveaux critiques >> et tenants de 1 'his
toricisme positiviste a envahi les colonnes de la grande
presse et fusé en pamphlets (Raymond Picard, Nouvelle
Critique ou nouvelle imposture, 1965; Roland Barthes,
Critique et vérité, 1966).
Tout ce bruit révèle une crise
profonde; car les attaques issues de l'extérieur ne sont
plus lancées, comme dans la première moitié du xxe siè
cle, au nom de valeurs jugées dépassées ')U dépourvues
de pertinence (le patriotisme; l'éminence de la culture
classique ...
), mais correspondent à des doutes internes :
l'histoire littéraire se trouve confrontée à de nouvelles
idéologies qui sapent les fondements théoriques de son.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « L'étude de l'histoire littéraire est destinée à remplacer en grande partie la lecture directe des Oeuvres de l'esprit humain. » A cette affirmation de Renan, Lanson répond dans l'avant-propos de son Histoire de la Littérature française : « Je voudrais que cet ouvrage ne fournît pas une dispense de lire les Oeuvres originales, mais une raison de les lire, qu'il éveillât les curiosités au lieu de les éteindre. » Étudier ces deux jugements. ?
- INSTITUTION LITTÉRAIRE (Histoire de la littérature)
- LA MYSTIFICATION LITTÉRAIRE (Histoire de la littérature)
- L'ANNÉE LITTÉRAIRE (Histoire de la littérature)
- «Pourquoi n'y aurait-il pas en littérature comme dans l'ameublement des styles : un style Louis XIV, Louis XVI, etc. Et s'il faut bien que les fournisseurs satisfassent les consommateurs, comment n'en résulterait-il pas, dans une certaine mesure, une «modification de mentalité créatice» ? (J. Pommier, Questions de critique et d'histoire littéraire, 1945.) Commentez cette suggestion.