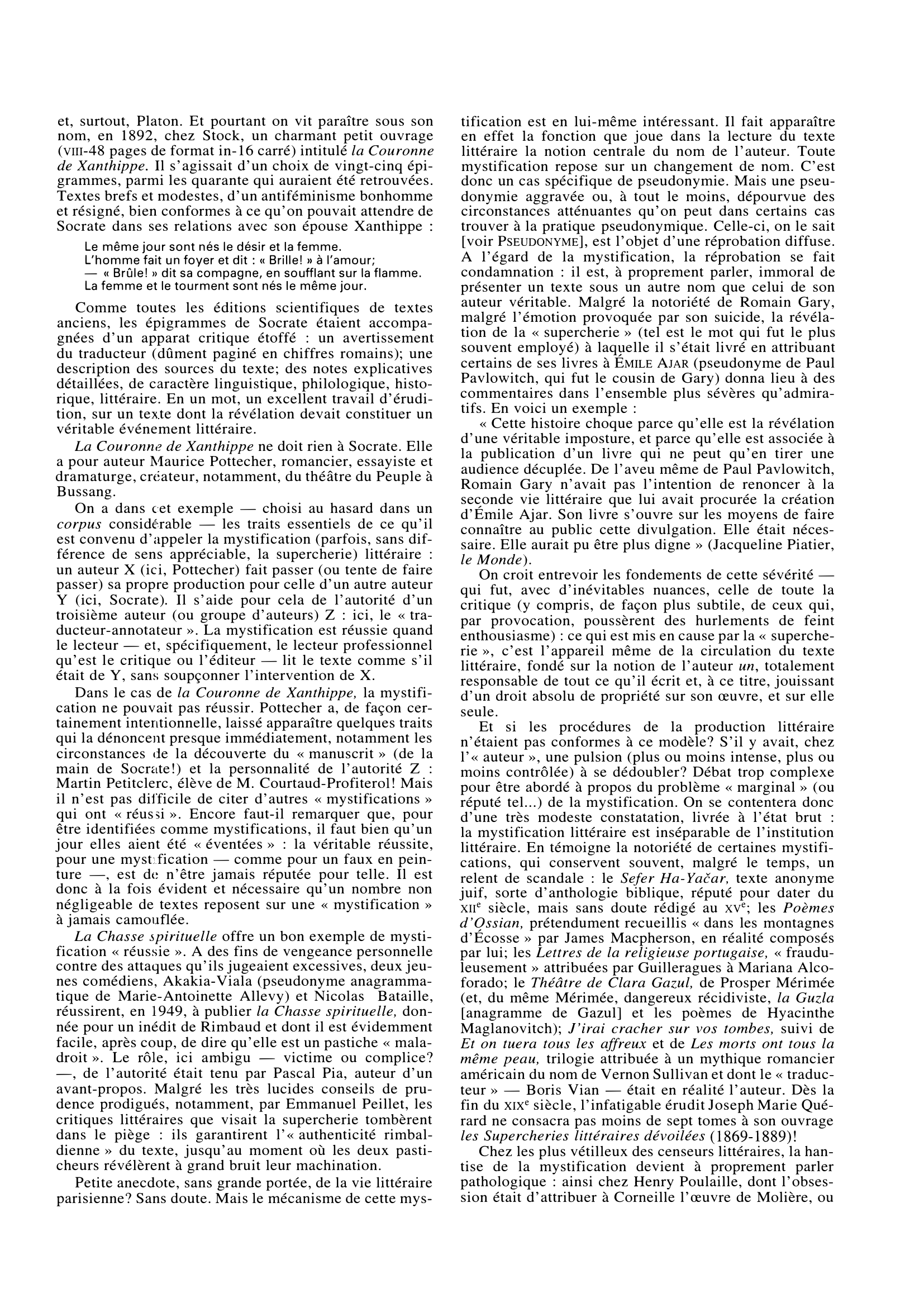LA MYSTIFICATION LITTÉRAIRE (Histoire de la littérature)
Publié le 24/11/2018

Extrait du document

MYSTIFICATION LITTÉRAIRE. Socrate, on le sait, n’a laissé aucun écrit. Ses pensées ne nous sont connues que par les œuvres de deux de ses disciples, Xénophon et, surtout, Platon. Et pourtant on vit paraître sous son nom, en 1892, chez Stock, un charmant petit ouvrage (viii-48 pages de format in-16 carré) intitulé la Couronne de Xanthippe. Il s’agissait d’un choix de vingt-cinq épi-grammes, parmi les quarante qui auraient été retrouvées. Textes brefs et modestes, d’un antiféminisme bonhomme et résigné, bien conformes à ce qu’on pouvait attendre de Socrate dans ses relations avec son épouse Xanthippe :
Le même jour sont nés le désir et la femme.
L'homme fait un foyer et dit : « Brille! » à l'amour;
— « Brûle! » dit sa compagne, en soufflant sur la flamme. La femme et le tourment sont nés le même jour.
Comme toutes les éditions scientifiques de textes anciens, les épigrammes de Socrate étaient accompagnées d’un apparat critique étoffé : un avertissement du traducteur (dûment paginé en chiffres romains); une description des sources du texte; des notes explicatives détaillées, de caractère linguistique, philologique, historique, littéraire. En un mot, un excellent travail d’érudition, sur un texte dont la révélation devait constituer un véritable événement littéraire.
La Couronne de Xanthippe ne doit rien à Socrate. Elle a pour auteur Maurice Pottecher, romancier, essayiste et dramaturge, créateur, notamment, du théâtre du Peuple à Bussang.
On a dans cet exemple — choisi au hasard dans un corpus considérable — les traits essentiels de ce qu’il est convenu d’appeler la mystification (parfois, sans différence de sens appréciable, la supercherie) littéraire : un auteur X (ici, Pottecher) fait passer (ou tente de faire passer) sa propre production pour celle d’un autre auteur Y (ici, Socrate). Il s’aide pour cela de l’autorité d’un troisième auteur (ou groupe d’auteurs) Z : ici, le « traducteur-annotateur ». La mystification est réussie quand le lecteur — et, spécifiquement, le lecteur professionnel qu’est le critique ou l’éditeur — lit le texte comme s’il était de Y, sans soupçonner l’intervention de X.
Dans le cas de la Couronne de Xanthippe, la mystification ne pouvait pas réussir. Pottecher a, de façon certainement intentionnelle, laissé apparaître quelques traits qui la dénoncent presque immédiatement, notamment les circonstances de la découverte du « manuscrit » (de la main de Socrate!) et la personnalité de l’autorité Z : Martin Petitclerc, élève de M. Courtaud-Profiterol! Mais il n’est pas difficile de citer d’autres « mystifications » qui ont «réussi». Encore faut-il remarquer que, pour être identifiées comme mystifications, il faut bien qu’un jour elles aient été « éventées » : la véritable réussite, pour une mystification — comme pour un faux en peinture —, est de n’être jamais réputée pour telle. Il est donc à la fois évident et nécessaire qu’un nombre non négligeable de textes reposent sur une « mystification » à jamais camouflée.
La Chasse spirituelle offre un bon exemple de mystification « réussie ». A des fins de vengeance personnelle contre des attaques qu’ils jugeaient excessives, deux jeunes comédiens, Akakia-Viala (pseudonyme anagramma-tique de Marie-Antoinette Allevy) et Nicolas Bataille, réussirent, en 1949, à publier la Chasse spirituelle, donnée pour un inédit de Rimbaud et dont il est évidemment facile, après coup, de dire qu’elle est un pastiche « maladroit ». Le rôle, ici ambigu — victime ou complice? —, de l’autorité était tenu par Pascal Pia, auteur d’un avant-propos. Malgré les très lucides conseils de prudence prodigués, notamment, par Emmanuel Peillet, les critiques littéraires que visait la supercherie tombèrent dans le piège : ils garantirent l’« authenticité rimbal-dienne » du texte, jusqu’au moment où les deux pasticheurs révélèrent à grand bruit leur machination.
Petite anecdote, sans grande portée, de la vie littéraire parisienne? Sans doute. Mais le mécanisme de cette mys
tification est en lui-même intéressant. Il fait apparaître en effet la fonction que joue dans la lecture du texte littéraire la notion centrale du nom de l’auteur. Toute mystification repose sur un changement de nom. C’est donc un cas spécifique de pseudonymie. Mais une pseu-donymie aggravée ou, à tout le moins, dépourvue des circonstances atténuantes qu’on peut dans certains cas trouver à la pratique pseudonymique.

«
et,
surtout, Platon.
Et pourtant on vit paraître sous son
nom, en 1892, chez Stock, un charmant petit ouvrage
(vm-48 pages de format in-16 carré) intitulé la Couronne
de Xanthippe.
Il s'agissait d'un choix de vingt-cinq épi
grammes, parmi les quarante qui auraient été retrouvées.
Textes brefs et modestes, d'un antiféminisme bonhomme
et résigné, bien conformes à ce qu'on pouvait attendre de
Socrate dans ses relations avec son épouse Xanthippe
Le même jour sont nés le désir et la femme.
L'homme fait un foyer et dit: « Brille! »à l'amour;
- « Brûle! >> dit sa compagne, en soufflant sur la flamme.
La femme et le tourment sont nés le même jour.
Comme toutes les éditions scientifiques de textes
anciens, les épigrammes de Socrate étaient accompa
gnées d'un apparat critique étoffé : un avertissement
du traducteur (dûment paginé en chiffres romains); une
description des sources du texte; des notes explicatives
détaillées, de caractère linguistique, philologique, histo
rique, littéraire.
En un mot, un excellent travail d'érudi
tion, sur un texte dont la révélation devait constituer un
véritable événement littéraire.
La Couronne de Xanthippe ne doit rien à Socrate.
Elle
a pour auteur Maurice Pottecher, romancier, essayiste et
dramaturge, créateur, notamment, du théâtre du Peuple à
Bussang.
On a dans cet exemple -choisi au hasard dans un
corpus considérable -les traits essentiels de ce qu'il
est convenu d'appeler la mystification (parfois, sans dif
férence de sens appréciable, la supercherie) littéraire :
un auteur X (ici, Pottecher) fait passer (ou tente de faire
passer) sa propre production pour celle d'un autre auteur
Y (ici, Socrate).
Il s'aide pour cela de l'autorité d'un
troisième auteur (ou groupe d'auteurs) Z : ici, le « tra
ducteur-annotateur>> .
La mystification est réussie quand
le lecteur -et, spécifiquement, le lecteur professionnel
qu'est le critique ou l'éditeur- lit le texte comme s'il
était de Y, sans soupçonner l'intervention de X.
Dans le cas de la Couronne de Xanthippe, la mystifi
cation ne pouvait pas réussir.
Pottecher a, de façon cer
tainement intentionnelle, laissé apparaître quelques traits
qui la dénoncent presque immédiatement, notamment les
circonstances de la découverte du « manuscrit >> (de la
main de Socrate!) et la personnalité de l'autorité Z :
Martin Petitclerc, élève de M.
Courtaud-Profiterai! Mais
il n'est pas difficile de citer d'autres «mystifications>>
qui ont «réussi>> .
Encore faut-il remarquer que, pour
être identifiées comme mystifications, il faut bien qu'un
jour elles aient été > : la véritable réussite,
pour une myst;Jication -comme pour un faux en pein
ture -, est de n'être jamais réputée pour telle.
Il est
donc à la fois évident et nécessaire qu'un nombre non
négligeable de textes reposent sur une >
à jamais camouflée.
La Chasse spirituelle offre un bon exemple de mysti
fication .
A des fins de vengeance personnelle
contre des attaques qu'ils jugeaient excessives, deux jeu
nes comédiens, Akakia-Viala (pseudonyme anagramma
tique de Marie-Antoinette Allevy) et Nicolas Bataille,
réussirent, en 1949, à publier la Chasse spirituelle, don
née pour un inédit de Rimbaud et dont il est évidemment
facile, après coup, de dire qu'elle est un pastiche > .
Le rôle, ici ambigu -victime ou complice?
-, de l'autorité était tenu par Pascal Pia, auteur d'un
avant-propos.
Malgré les très lucides conseils de pru
dence prodigués, notamment, par Emmanuel Peillet, les
critiques littéraires que visait la supercherie tombèrent
dans le piège : ils garantirent l'> du texte, jusqu'au moment où les deux pasti
cheurs révélèrent à grand bruit leur machination.
Petite anecdote, sans grande portée, de la vie littéraire
parisienne? Sans doute.
Mais le mécanisme de cette mys- tification
est en lui-même intéressant.
Il fait apparaître
en effet la fonction que joue dans la lecture du texte
littéraire la notion centrale du nom de 1' auteur.
Toute
mystification repose sur un changement de nom.
C'est
donc un cas spécifique de pseudonymie.
Mais une pseu
donymie aggravée ou, à tout le moins, dépourvue des
circonstances atténuantes qu'on peut dans certains cas
trouver à la pratique pseudonymique.
Celle-ci, on le sait
[voir PsEUDONYME], est l'objet d'une réprobation diffuse.
A 1' égard de la mystification, la réprobation se fait
condamnation : il est, à proprement parler, immoral de
présenter un texte sous un autre nom que celui de son
auteur véritable.
Malgré la notoriété de Romain Gary,
malgré l'émotion provoquée par son suicide, la révéla
tion de la « supercherie >> (tel est le mot qui fut le plus
souvent employé) à laq yelle il s'était livré en attribuant
certains de ses livres à EMILE AJAR (pseudonyme de Paul
Pavlowitch, qui fut le cousin de Gary) donna lieu à des
commentaires dans l'ensemble plus sévères qu'admira
tifs.
En voici un exemple :
> (Jacqueline Piatier,
le Monde).
On croit entrevoir les fondements de cette sévérité -
qui fut, avec d'inévitables nuances, celle de toute la
critique (y compris, de façon plus subtile, de ceux qui,
par provocation, poussèrent des hurlements de feint
enthousiasme) : ce qui est mis en cause par la > , c'est l'appareil même de la circulation du texte
littéraire, fondé sur la notion de l'auteur un, totalement
responsable de tout ce qu'il écrit et, à ce titre, jouissant
d'un droit absolu de propriété sur son œuvre, et sur elle
seule.
Et si les procédures de la production littéraire
n'étaient pas conformes à ce modèle? S'il y avait, chez
l'> , une pulsion (plus ou moins intense, plus ou
moins contrôlée) à se dédoubler? Débat trop complexe
pour être abordé à propos du problème > (ou
réputé tel...) de la mystification.
On se contentera donc
d'une très modeste constatation, livrée à l'état brut :
la mystification littéraire est inséparable de l'institution
littéraire.
En témoigne la notoriété de certaines mystifi
cations, qui conservent souvent, malgré le temps, un
relent de scandale : le Sefer Ha-Yacar, texte anonyme
juif, sorte d'anthologie biblique, réputé pour dater du
xn e siècle, mais sans doute rédigé au xve; les Poèmes
d'Ossian, prétendument recueillis «dans les montagnes
d' Écosse>> par James Macpherson, en réalité composés
par lui; les Lettres de la religieuse portugaise, > attribuées par Guilleragues à Mariana Alco
forado; le Théâtre de Clara Gazul, de Prosper Mérimée
(et, du même Mérimée, dangereux récidiviste, la Guzla
[anagramme de Gazul] et les poèmes de Hyacinthe
Maglanovitch); J'irai cracher sur vos tombes, suivi de
Et on tuera tous les affreux et de Les morts ont tous la
même peau, trilogie attribuée à un mythique romancier
américain du nom de Vernon Sullivan et dont le« traduc
teur>> -Boris Vian -était en réalité l'auteur.
Dès la
fin du X!Xe siècle, l'infatigable érudit Joseph Marie Qué
rard ne consacra pas moins de sept tomes à son ouvrage
les Supercheries littéraires dévoilées (1869-1889)!
Chez les plus vétilleux des censeurs littéraires, la han
tise de la mystification devient à proprement parler
pathologique : ainsi chez Henry Poulaille, dont l' obses
sion était d'attribuer à Corneille l'œuvre de Molière, ou.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « L'étude de l'histoire littéraire est destinée à remplacer en grande partie la lecture directe des Oeuvres de l'esprit humain. » A cette affirmation de Renan, Lanson répond dans l'avant-propos de son Histoire de la Littérature française : « Je voudrais que cet ouvrage ne fournît pas une dispense de lire les Oeuvres originales, mais une raison de les lire, qu'il éveillât les curiosités au lieu de les éteindre. » Étudier ces deux jugements. ?
- INSTITUTION LITTÉRAIRE (Histoire de la littérature)
- HISTOIRE LITTÉRAIRE (Histoire de la littérature)
- L'ANNÉE LITTÉRAIRE (Histoire de la littérature)
- Que pensez-vous de cette remarque d'Albert Thibaudet : «La littérature française apparaît comme une succession d'empires dont chacun est renversé par une guerre littéraire ou une révolution, et auquel un autre empire succède.» (Histoire de la littérature française, de 1789 à nos jours)