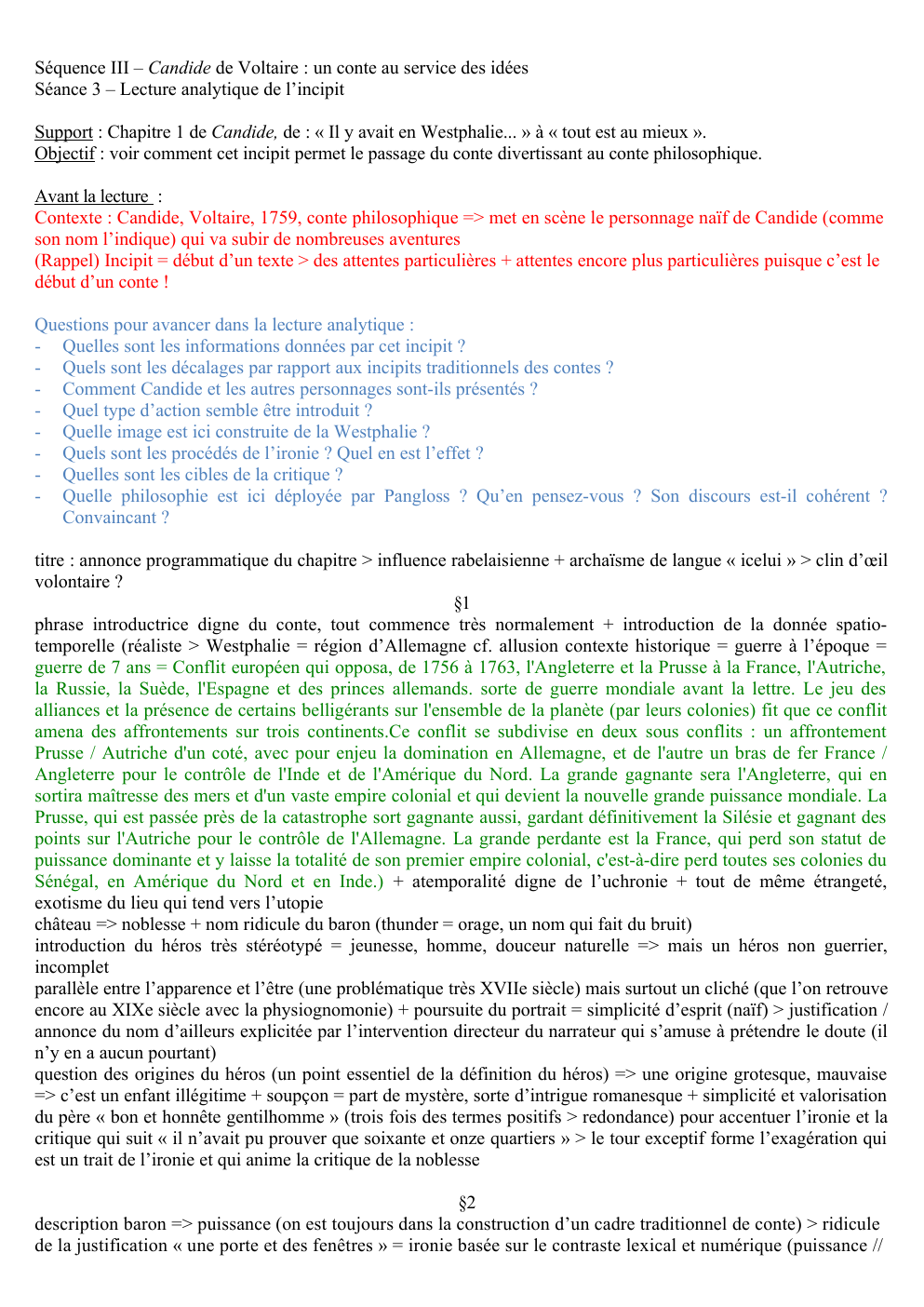Incipit Candide Voltaire chapitre 1
Publié le 10/01/2023
Extrait du document
«
Séquence III – Candide de Voltaire : un conte au service des idées
Séance 3 – Lecture analytique de l’incipit
Support : Chapitre 1 de Candide, de : « Il y avait en Westphalie...
» à « tout est au mieux ».
Objectif : voir comment cet incipit permet le passage du conte divertissant au conte philosophique.
Avant la lecture :
Contexte : Candide, Voltaire, 1759, conte philosophique => met en scène le personnage naïf de Candide (comme
son nom l’indique) qui va subir de nombreuses aventures
(Rappel) Incipit = début d’un texte > des attentes particulières + attentes encore plus particulières puisque c’est le
début d’un conte !
Questions pour avancer dans la lecture analytique :
- Quelles sont les informations données par cet incipit ?
- Quels sont les décalages par rapport aux incipits traditionnels des contes ?
- Comment Candide et les autres personnages sont-ils présentés ?
- Quel type d’action semble être introduit ?
- Quelle image est ici construite de la Westphalie ?
- Quels sont les procédés de l’ironie ? Quel en est l’effet ?
- Quelles sont les cibles de la critique ?
- Quelle philosophie est ici déployée par Pangloss ? Qu’en pensez-vous ? Son discours est-il cohérent ?
Convaincant ?
titre : annonce programmatique du chapitre > influence rabelaisienne + archaïsme de langue « icelui » > clin d’œil
volontaire ?
§1
phrase introductrice digne du conte, tout commence très normalement + introduction de la donnée spatiotemporelle (réaliste > Westphalie = région d’Allemagne cf.
allusion contexte historique = guerre à l’époque =
guerre de 7 ans = Conflit européen qui opposa, de 1756 à 1763, l'Angleterre et la Prusse à la France, l'Autriche,
la Russie, la Suède, l'Espagne et des princes allemands.
sorte de guerre mondiale avant la lettre.
Le jeu des
alliances et la présence de certains belligérants sur l'ensemble de la planète (par leurs colonies) fit que ce conflit
amena des affrontements sur trois continents.Ce conflit se subdivise en deux sous conflits : un affrontement
Prusse / Autriche d'un coté, avec pour enjeu la domination en Allemagne, et de l'autre un bras de fer France /
Angleterre pour le contrôle de l'Inde et de l'Amérique du Nord.
La grande gagnante sera l'Angleterre, qui en
sortira maîtresse des mers et d'un vaste empire colonial et qui devient la nouvelle grande puissance mondiale.
La
Prusse, qui est passée près de la catastrophe sort gagnante aussi, gardant définitivement la Silésie et gagnant des
points sur l'Autriche pour le contrôle de l'Allemagne.
La grande perdante est la France, qui perd son statut de puissance dominante et y laisse la totalité de son premier empire colonial, c'est-à-dire perd toutes ses colonies du Sénégal, en Amérique du Nord et en Inde.) + atemporalité digne de l’uchronie + tout de même étrangeté, exotisme du lieu qui tend vers l’utopie château => noblesse + nom ridicule du baron (thunder = orage, un nom qui fait du bruit) introduction du héros très stéréotypé = jeunesse, homme, douceur naturelle => mais un héros non guerrier, incomplet parallèle entre l’apparence et l’être (une problématique très XVIIe siècle) mais surtout un cliché (que l’on retrouve encore au XIXe siècle avec la physiognomonie) + poursuite du portrait = simplicité d’esprit (naïf) > justification / annonce du nom d’ailleurs explicitée par l’intervention directeur du narrateur qui s’amuse à prétendre le doute (il n’y en a aucun pourtant) question des origines du héros (un point essentiel de la définition du héros) => une origine grotesque, mauvaise => c’est un enfant illégitime + soupçon = part de mystère, sorte d’intrigue romanesque + simplicité et valorisation du père « bon et honnête gentilhomme » (trois fois des termes positifs > redondance) pour accentuer l’ironie et la critique qui suit « il n’avait pu prouver que soixante et onze quartiers » > le tour exceptif forme l’exagération qui est un trait de l’ironie et qui anime la critique de la noblesse §2 description baron => puissance (on est toujours dans la construction d’un cadre traditionnel de conte) > ridicule de la justification « une porte et des fenêtres » = ironie basée sur le contraste lexical et numérique (puissance // Séquence III – Candide de Voltaire : un conte au service des idées Séance 3 – Lecture analytique de l’incipit une porte) + suite de la description ridicule => une tapisserie, même => exagération de la syntaxe contraste avec le ridicule numérique + il n’a pas une vraie meute (meute dans le besoin => tournure comique), tous les éléments de noblesse et liés à la vénerie sont extraits ici de la bassesse, de la pauvreté => image ridicule, critique dans une construction parallèle ternaire + respectabilité du personnage quelque peu ridicule > d’autant plus que le personnage est un conteur > activité non noble, non digne d’un baron + référence métatextuelle > conte pour faire rire = Candide ? §3 Madame la baronne => relative comique, exagération, formule détournée (plus de 120 kg) + ironie / comique = respect vient de la grosseur => critique noblesse + dignité ridicule du personnage qui lui attire tout de même le respect ridicule du nom de la fille + stéréotype de la jeune + beauté nuancée => bigarrure, grosseur => termes qui conviennent mieux à un rôti suite introduction de tous les personnages (fils) + précepteur enfin = Pangloss (en grec, qui parle tout le temps, à tort et à travers) > ironie du terme « oracle » exagération ridicule => critique + naïveté de Candide, emploi hypocoristique de « petit » => attire la pitié, l’affection du lecteur sur le personnage §4 nom de l’enseignement de Pangloss = néologisme, invention comique de Voltaire > le son / terme « nigo » (nigaud) résonne surtout => critique de cette philosophie à rallonge qui ne veut rien dire et qui mélange tout + critique de Liebniz (philosophe allemand fin 17e siècle, théodicée = justice de Dieu > Dieu a tout prévu, l’homme ne peut saisir l’intégralité du tableau et comprendre pourquoi le mal existe => Voltaire veut enlever Dieu de l’équation philosophique) + concept de Leibniz = cause à effet > déterminisme, une logique écrasante qui ne peut être contredite (mais Voltaire va la pousser jusqu’au ridicule) + « meilleur des mondes possibles » parodie de Liebniz par Voltaire => c’est cette idée d’une harmonie préétablie insaisissable par l’homme > il faut se contenter de ce qu’on a, de ce qu’on ne peut comprendre, de ce que Dieu a décidé => tout est pour le mieux => ironie (exagération du superlatif répété, structure binaire, contraste avec le ridicule de la description précédente) et critique de la noblesse et de l’optimisme + meilleur des mondes => forme de paradis terrestre, d’utopie/uchronie §5 insertion discours direct => parole de Pangloss qui illustre parfaitement son nom = trop long, dans ts les sens, incompréhensible => exposé qui ne prouve rien => non-sens, absence de force argumentative = critique emploi présent gnomique, pronom indéfini « tout » répété => proverbe = aucune valeur argumentative + aspect normatif des tournures impersonnelles parodie de syllogisme (Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel => deux prémisses, une conclusion) => vacuité, fausseté du raisonnement, ridicule des exemples trouvés => une argumentation qui se détruit de l’intérieur + malgré les connecteurs logiques > aucun lien + toutes les apparences du discours raisonné, mais aucun argument Tout est bien > tout est au mieux => une fausse argumentation philosophique pour aboutir à une question de lexique/syntaxe => vers le superlatif absolu, l’exagération => vers passivité absolu devant le mal, le déterminisme passage de l’optimisme au fatalisme absolu. Étude.... »
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Candide, Voltaire, Chapitre I (Incipit)
- VOLTAIRE, Candide : chapitre 1 (incipit)
- CANDIDE, Voltaire, chapitre 1 : l'incipit
- Incipit de Candide ou l'optimisme (chapitre 1) de Voltaire
- Chapitre 19 de Candide de Voltaire : De quel manière Voltaire dénonce-t-il l’esclavage ?