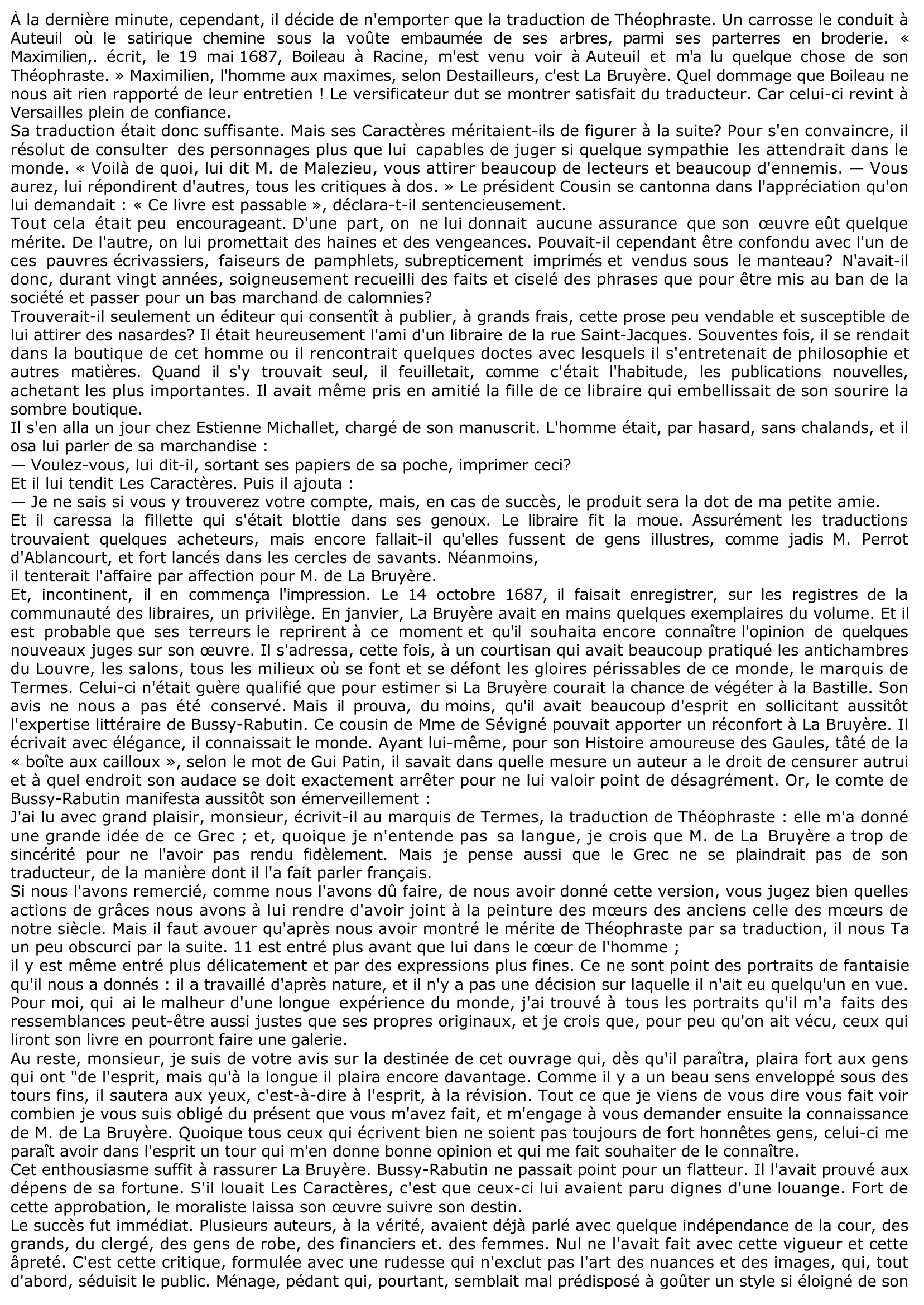LA BRUYÈRE GENTILHOMME DE M. LE DUC - LES « CARACTÈRES »
Publié le 07/07/2011

Extrait du document
Il est tout à fait improbable que M. le Duc ait utilisé La Bruyère durant les mois, durant l'année même qui suivit la mort du prince de Condé. Comme l'avait souhaité son père, il était devenu, avant tout, courtisan. 11 ne quittait guère l'entourage du roi. Il y remplissait ces devoirs puérils auxquels on a peine à croire aujourd'hui que des hommes sensés aient pu consacrer leurs journées. En dehors des moments où il flagornait Sa Majesté, volontiers, soit avec Mgr le dauphin, soit avec quelques seigneurs folâtres, il s'abandonnait à la débauche. Sa tendresse pour Mlle de Nantes, sa femme, n'avait jamais été très ardente. Elle s'affaiblissait peu à peu. Il papillonnait autour des demoiselles d'honneur de Mme la dauphine, auxquelles il offrait, pour distraire leur désœuvrement, de ces livres graveleux que lançaient, à travers le monde, les presses clandestines de Hollande. De son côté, Mme la Duchesse, délaissée, peu encline à se plaindre, plus désireuse peut-être de se venger, tournait vers son cousin le prince François-Louis de Conti la piètre sentimentalité dont elle était animée.
«
À la dernière minute, cependant, il décide de n'emporter que la traduction de Théophraste.
Un carrosse le conduit àAuteuil où le satirique chemine sous la voûte embaumée de ses arbres, parmi ses parterres en broderie.
«Maximilien,.
écrit, le 19 mai 1687, Boileau à Racine, m'est venu voir à Auteuil et m'a lu quelque chose de sonThéophraste.
» Maximilien, l'homme aux maximes, selon Destailleurs, c'est La Bruyère.
Quel dommage que Boileau nenous ait rien rapporté de leur entretien ! Le versificateur dut se montrer satisfait du traducteur.
Car celui-ci revint àVersailles plein de confiance.Sa traduction était donc suffisante.
Mais ses Caractères méritaient-ils de figurer à la suite? Pour s'en convaincre, ilrésolut de consulter des personnages plus que lui capables de juger si quelque sympathie les attendrait dans lemonde.
« Voilà de quoi, lui dit M.
de Malezieu, vous attirer beaucoup de lecteurs et beaucoup d'ennemis.
— Vousaurez, lui répondirent d'autres, tous les critiques à dos.
» Le président Cousin se cantonna dans l'appréciation qu'onlui demandait : « Ce livre est passable », déclara-t-il sentencieusement.Tout cela était peu encourageant.
D'une part, on ne lui donnait aucune assurance que son œuvre eût quelquemérite.
De l'autre, on lui promettait des haines et des vengeances.
Pouvait-il cependant être confondu avec l'un deces pauvres écrivassiers, faiseurs de pamphlets, subrepticement imprimés et vendus sous le manteau? N'avait-ildonc, durant vingt années, soigneusement recueilli des faits et ciselé des phrases que pour être mis au ban de lasociété et passer pour un bas marchand de calomnies?Trouverait-il seulement un éditeur qui consentît à publier, à grands frais, cette prose peu vendable et susceptible delui attirer des nasardes? Il était heureusement l'ami d'un libraire de la rue Saint-Jacques.
Souventes fois, il se rendaitdans la boutique de cet homme ou il rencontrait quelques doctes avec lesquels il s'entretenait de philosophie etautres matières.
Quand il s'y trouvait seul, il feuilletait, comme c'était l'habitude, les publications nouvelles,achetant les plus importantes.
Il avait même pris en amitié la fille de ce libraire qui embellissait de son sourire lasombre boutique.Il s'en alla un jour chez Estienne Michallet, chargé de son manuscrit.
L'homme était, par hasard, sans chalands, et ilosa lui parler de sa marchandise :— Voulez-vous, lui dit-il, sortant ses papiers de sa poche, imprimer ceci?Et il lui tendit Les Caractères.
Puis il ajouta :— Je ne sais si vous y trouverez votre compte, mais, en cas de succès, le produit sera la dot de ma petite amie.Et il caressa la fillette qui s'était blottie dans ses genoux.
Le libraire fit la moue.
Assurément les traductionstrouvaient quelques acheteurs, mais encore fallait-il qu'elles fussent de gens illustres, comme jadis M.
Perrotd'Ablancourt, et fort lancés dans les cercles de savants.
Néanmoins,il tenterait l'affaire par affection pour M.
de La Bruyère.Et, incontinent, il en commença l'impression.
Le 14 octobre 1687, il faisait enregistrer, sur les registres de lacommunauté des libraires, un privilège.
En janvier, La Bruyère avait en mains quelques exemplaires du volume.
Et ilest probable que ses terreurs le reprirent à ce moment et qu'il souhaita encore connaître l'opinion de quelquesnouveaux juges sur son œuvre.
Il s'adressa, cette fois, à un courtisan qui avait beaucoup pratiqué les antichambresdu Louvre, les salons, tous les milieux où se font et se défont les gloires périssables de ce monde, le marquis deTermes.
Celui-ci n'était guère qualifié que pour estimer si La Bruyère courait la chance de végéter à la Bastille.
Sonavis ne nous a pas été conservé.
Mais il prouva, du moins, qu'il avait beaucoup d'esprit en sollicitant aussitôtl'expertise littéraire de Bussy-Rabutin.
Ce cousin de Mme de Sévigné pouvait apporter un réconfort à La Bruyère.
Ilécrivait avec élégance, il connaissait le monde.
Ayant lui-même, pour son Histoire amoureuse des Gaules, tâté de la« boîte aux cailloux », selon le mot de Gui Patin, il savait dans quelle mesure un auteur a le droit de censurer autruiet à quel endroit son audace se doit exactement arrêter pour ne lui valoir point de désagrément.
Or, le comte deBussy-Rabutin manifesta aussitôt son émerveillement :J'ai lu avec grand plaisir, monsieur, écrivit-il au marquis de Termes, la traduction de Théophraste : elle m'a donnéune grande idée de ce Grec ; et, quoique je n'entende pas sa langue, je crois que M.
de La Bruyère a trop desincérité pour ne l'avoir pas rendu fidèlement.
Mais je pense aussi que le Grec ne se plaindrait pas de sontraducteur, de la manière dont il l'a fait parler français.Si nous l'avons remercié, comme nous l'avons dû faire, de nous avoir donné cette version, vous jugez bien quellesactions de grâces nous avons à lui rendre d'avoir joint à la peinture des mœurs des anciens celle des mœurs denotre siècle.
Mais il faut avouer qu'après nous avoir montré le mérite de Théophraste par sa traduction, il nous Taun peu obscurci par la suite.
11 est entré plus avant que lui dans le cœur de l'homme ;il y est même entré plus délicatement et par des expressions plus fines.
Ce ne sont point des portraits de fantaisiequ'il nous a donnés : il a travaillé d'après nature, et il n'y a pas une décision sur laquelle il n'ait eu quelqu'un en vue.Pour moi, qui ai le malheur d'une longue expérience du monde, j'ai trouvé à tous les portraits qu'il m'a faits desressemblances peut-être aussi justes que ses propres originaux, et je crois que, pour peu qu'on ait vécu, ceux quiliront son livre en pourront faire une galerie.Au reste, monsieur, je suis de votre avis sur la destinée de cet ouvrage qui, dès qu'il paraîtra, plaira fort aux gensqui ont "de l'esprit, mais qu'à la longue il plaira encore davantage.
Comme il y a un beau sens enveloppé sous destours fins, il sautera aux yeux, c'est-à-dire à l'esprit, à la révision.
Tout ce que je viens de vous dire vous fait voircombien je vous suis obligé du présent que vous m'avez fait, et m'engage à vous demander ensuite la connaissancede M.
de La Bruyère.
Quoique tous ceux qui écrivent bien ne soient pas toujours de fort honnêtes gens, celui-ci meparaît avoir dans l'esprit un tour qui m'en donne bonne opinion et qui me fait souhaiter de le connaître.Cet enthousiasme suffit à rassurer La Bruyère.
Bussy-Rabutin ne passait point pour un flatteur.
Il l'avait prouvé auxdépens de sa fortune.
S'il louait Les Caractères, c'est que ceux-ci lui avaient paru dignes d'une louange.
Fort decette approbation, le moraliste laissa son œuvre suivre son destin.Le succès fut immédiat.
Plusieurs auteurs, à la vérité, avaient déjà parlé avec quelque indépendance de la cour, desgrands, du clergé, des gens de robe, des financiers et.
des femmes.
Nul ne l'avait fait avec cette vigueur et cetteâpreté.
C'est cette critique, formulée avec une rudesse qui n'exclut pas l'art des nuances et des images, qui, toutd'abord, séduisit le public.
Ménage, pédant qui, pourtant, semblait mal prédisposé à goûter un style si éloigné de son.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dissertation : D'après votre lecture des caractères de La Bruyère et d’autres moralistes que vous avez lus, peut-on dire que “tous les hommes se valent”, ou émerge t’il des différences entre les personnes et les caractères ? Vous développerez vos impressions de lecture en vous appuyant sur des exemples précis.
- La Bruyère, les Caractères (étude littéraire)
- commentaire: De la cour de La bruyère in les "Caractères"
- « Des Caractères » de La Bruyère Passage du Livre IX, « Des Grands »
- Les Caractères, La Bruyère (1688-1696) / Chapitre IX, « Des Grands » / « Pamphile »